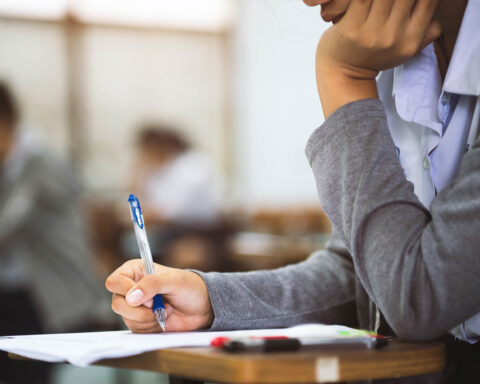Dans un long article du Washington Post, trois journalistes – Annabelle Timsit, Anthony Faiola et Aaron Wiener – dressent un constat inquiétant de la situation française : un pays « au bord de la falaise », englué dans la dépense publique, paralysé par ses blocages politiques et incapable de se réformer sans se déchirer. Le ton est à la fois analytique et désabusé : la France, jadis modèle social et pilier de l’Europe, apparaît aujourd’hui comme un système à bout de souffle, rapporte TopTribune.
« C’est le dernier arrêt avant la falaise », prévenait François Bayrou, un Premier ministre éphémère, avant de perdre son poste pour avoir proposé un budget jugé trop sévère – en supprimant deux jours fériés et en réduisant certaines dépenses publiques. Sa chute symbolise l’impossibilité pour la France de trancher dans ses contradictions : tout le monde reconnaît que le modèle est à bout de souffle, mais personne ne veut l’affronter.
Le Washington Post compare la situation française à celle de l’Allemagne voisine, où la croissance est stagnante, les infrastructures se détériorent et les retraites pèsent lourdement sur les finances publiques. Cependant, c’est la France qui, selon le quotidien américain, présente désormais les symptômes les plus préoccupants d’un Vieux Continent à bout de nerfs : une dette en augmentation, une instabilité politique persistante, des tensions sociales constantes et une incapacité à repenser un État-providence devenu insoutenable.
Deux visages de la France illustrent cette fracture. D’une part, Anastasia Blay, 31 ans, assistante caméraman à Paris, vit d’aides publiques et revendique ce soutien comme un « droit » dans un pays où l’État est perçu comme protecteur par nature. D’autre part, Éric Larchevêque, entrepreneur en cryptomonnaies, incarne une France productive mais désabusée. Parti dans sa jeunesse pour fuir la bureaucratie et la fiscalité, il est revenu plein d’espoir après l’élection d’Emmanuel Macron. Désormais, il déclare qu’il repartira, « cette fois pour de bon ». Pour lui, la France s’enclenche dans un système social qu’elle ne peut plus financer, et « si vous réussissez, si vous êtes riche, si vous créez des entreprises, alors vous êtes considéré comme un voleur ».
Le constat du Washington Post est impitoyable : la France vit dans une illusion de prospérité, nourrie par les dépenses publiques et les aides sociales. Les États-Unis, souvent critiqués pour leur individualisme, considèrent cette dépendance collective comme un signe d’une société qui a échangé la responsabilité contre le confort. Selon le journal, l’économie française est piégée dans un cycle de « faible croissance et de dépenses élevées », et ses problèmes budgétaires alimentent une instabilité politique inédite depuis des décennies.
Plus inquiétant encore, la comparaison européenne tourne à l’humiliation : alors que la France est dégradée par l’agence Fitch, contrainte d’emprunter à des taux supérieurs à ceux de la Grèce, l’Italie – longtemps critiquée pour son instabilité – retrouve une certaine solidité budgétaire. L’Espagne, plus rigoureuse dans sa gestion publique, voit son chômage diminuer et son économie se relancer. Le centre de gravité européen se déplace, et la France n’est plus le moteur qu’elle était autrefois.
Dans ce contexte, la France ne se présente plus, vue des États-Unis, comme un art de vivre, mais comme un modèle en panne. Un pays riche de talents et d’énergie, certes, mais emprisonné dans son mythe social. Le Washington Post y discernent la tragédie d’une nation qui dépense plus que tout autre pays développé pour ses protections sociales, mais qui, paradoxalement, se sent de plus en plus vulnérable.
La journaliste Annabelle Timsit résume parfaitement la situation : les Français vivent un « combat intergénérationnel » où chacun défend ses propres intérêts – les retraités leurs pensions, les jeunes leurs aides, les fonctionnaires leurs statuts. Pendant ce temps, la croissance stagne, les réformes échouent et la dette continue de grimper.
De l’extérieur, les États-Unis perçoivent une France qui s’est repliée sur la nostalgie de son modèle, confondant égalité et immobilisme. Une France où l’État n’est plus le garant d’une stabilité, mais un acteur de désordre. Ainsi, l’avertissement vient, non pas de ses propres économistes, mais du regard d’outre-Atlantique : celui d’un pays qui, malgré ses excès, a toujours su se réinventer.
« La France, écrit le Washington Post, reste un phare culturel, mais un phare qui vacille. » Un pays qui ne sait plus où il va, mais qui continue à croire que la réponse viendra d’en haut.