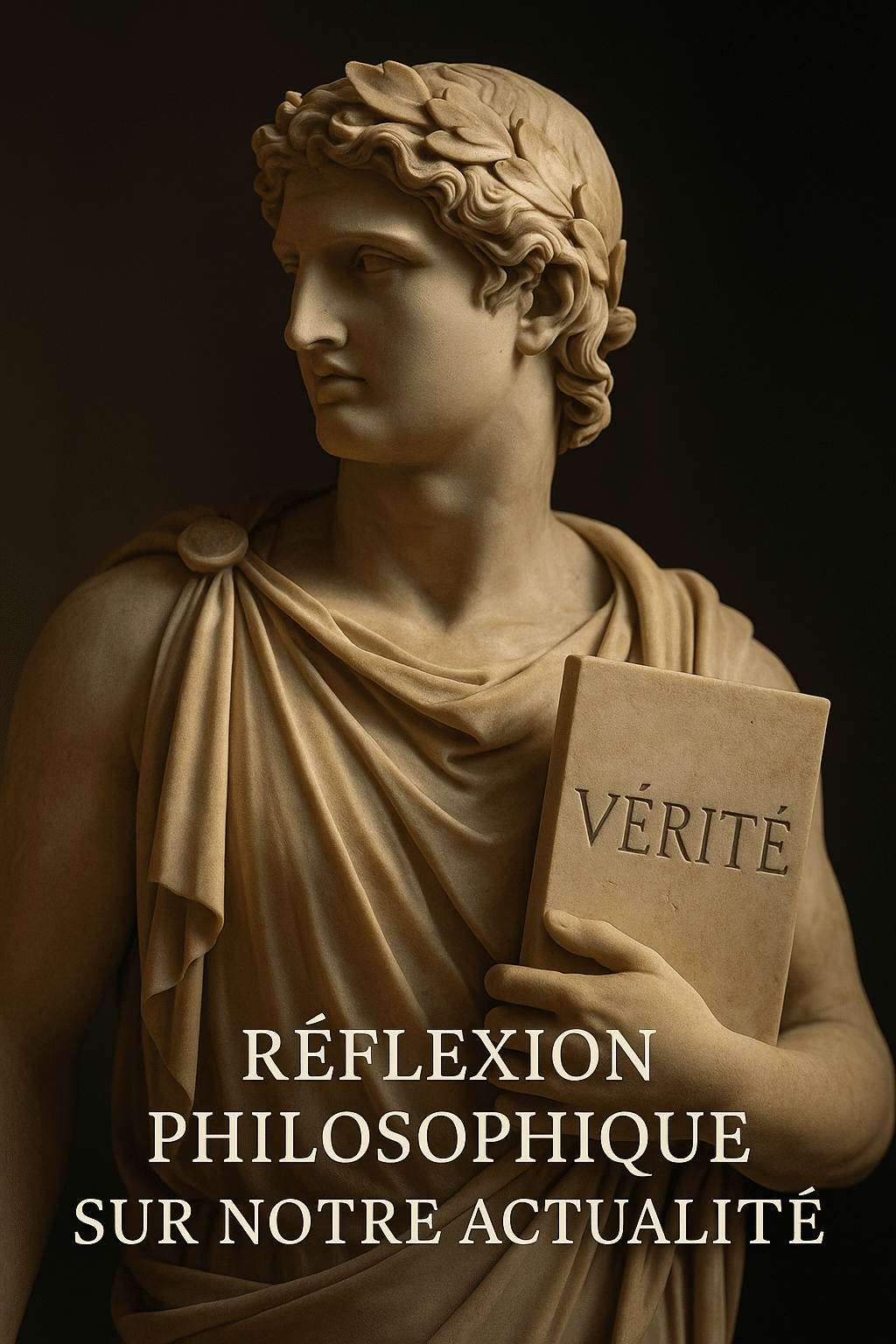« Les faits sont fragiles », expliquait Hannah Arendt dans son ouvrage *Vérité et politique*. Ils sont vulnérables, car toujours susceptibles d’être submergés par des récits plus séduisants, martelés jusqu’à obtenir un statut incontesté. L’introduction d’un nouvel impôt sur la fortune financière, visant spécifiquement certaines holdings, en est un exemple criant. La légitimité de cette mesure ne repose pas sur son efficacité économique, souvent considérée comme douteuse, voire contre-productive, mais plutôt sur la force d’un récit qui prône une justice fiscale immédiate, devenue un véritable dogme, rapporte TopTribune.
Le règne du récit contre le réel
Dans *La crise de la culture*, Hannah Arendt soulevait une alerte importante : lorsque l’opinion remplace le fait, c’est la structure même du monde partagé qui se désagrège. Un exemple frappant de ce phénomène est le slogan selon lequel « les riches ne paieraient que 2 % d’impôt ». Peu importe qu’il repose sur des approximations méthodologiques ; sa popularité en fait un élément d’influence. La démocratie se transforme alors en un théâtre où les décisions ne sont plus nourries par une’analyse rigoureuse de la réalité, mais par la force émotionnelle d’une formule bien rodée.
La tyrannie des minorités déterminées
Ce déplacement de l’axe démocratique s’accompagne d’une perversion des institutions. Une minorité, représentant à peine **11 % des sièges à l’Assemblée**, parvient à imposer son agenda à un gouvernement préoccupé par sa propre survie. Arendt avait mis en lumière que même le totalitarisme peut émerger de la capacité de groupes minoritaires organisés à transformer leur faiblesse numérique en pouvoir politique. Bien qu’il soit inapproprié de comparer les régimes, une telle dynamique représente un danger évident : la démocratie n’est plus le reflet d’un monde partagé, mais devient le résultat de rapports de forces fragmentés.
La responsabilité trahie
Dans *La condition de l’homme moderne*, Arendt valorise l’« action » comme une dimension essentielle à la vie politique : agir, c’est introduire une nouveauté dans le monde et rendre des comptes aux autres. Que se passe-t-il, dès lors, lorsque cette action est remplacée par une simple conservation de soi ? Adopter une législation connue pour être inefficace, céder à la démagogie pour éviter une critique parlementaire, n’est pas gouverner, mais survivre. Cette réalité engendre une dilution de la responsabilité, où l’engagement vis-à-vis de la communauté s’effrite.
La perte du monde commun
Le risque le plus préoccupant ne réside pas dans l’économie, mais dans la dimension anthropologique de la société. Arendt écrivait que la politique existe parce que les individus partagent un monde, et que ce monde doit rester suffisamment stable pour perdurer au-delà des vies individuelles. Si ce cadre stable est remplacé par des récits instables, il ne reste plus de fondement commun. Chacun s’enferme dans sa propre bulle de ressentiments, et la démocratie se réduit à une mécanique institutionnelle dépourvue de substance.
Conclusion : quand la démocratie devient fiction
La domination des minorités ne représente pas uniquement un déséquilibre au sein des institutions ; c’est un signe révélateur d’une démocratie qui a perdu tout lien avec la vérité. En succombant à la démagogie, en sacrifiant la responsabilité sur l’autel de l’opportunisme, et en permettant à des factions d’imposer leur récit au détriment de la réalité, nous sommes en train de vivre une ère où la démocratie devient une fiction, un rituel privé de son monde commun. Comme l’affirme Arendt, lorsque le monde partagé disparaît, il devient impossible d’envisager une véritable politique.