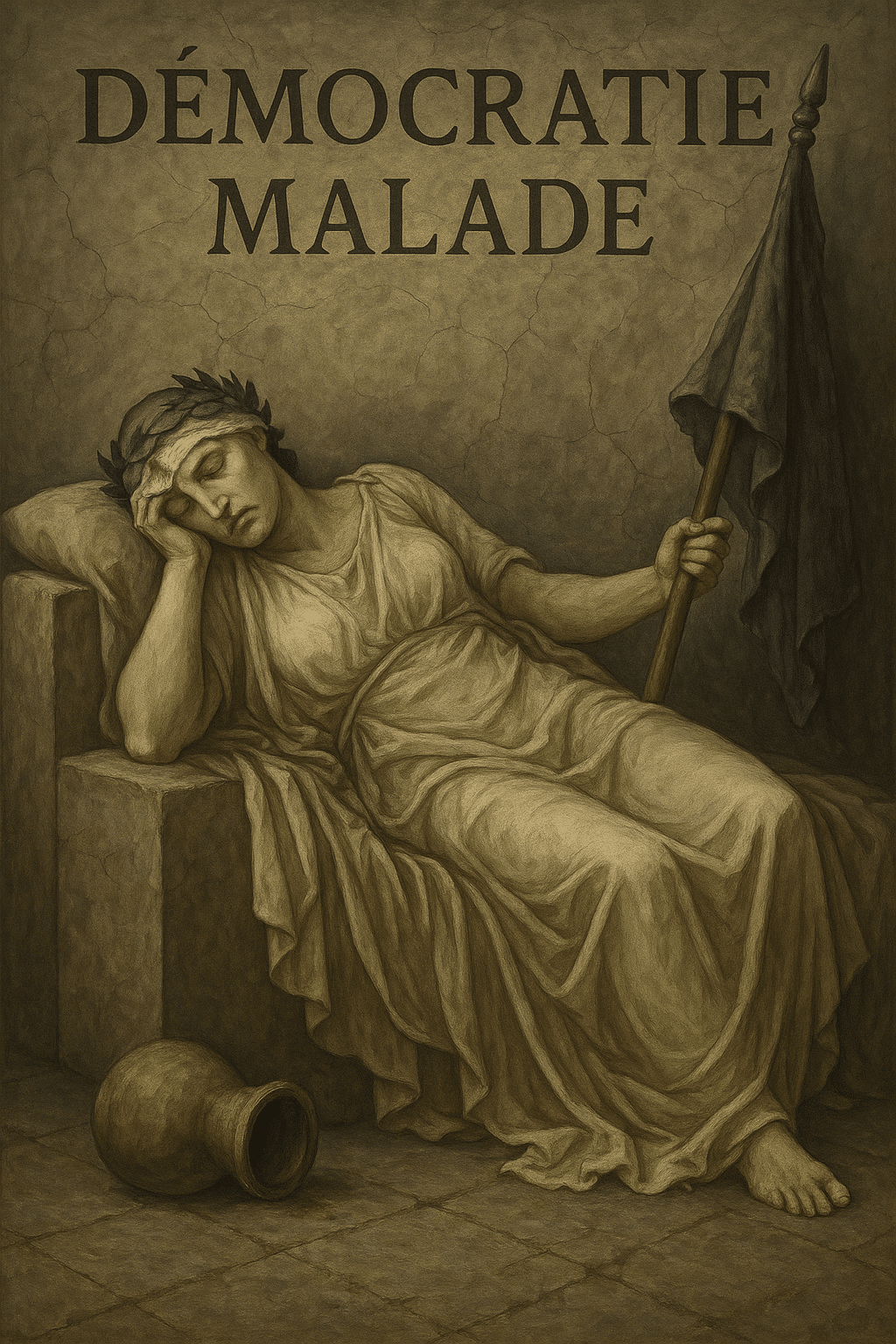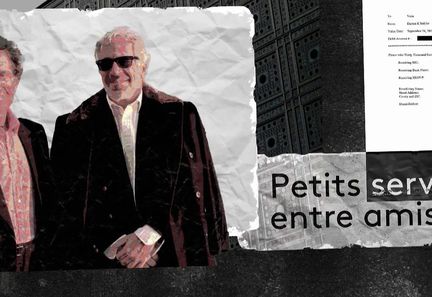I. La posture politicienne : séduire plutôt que résoudre
De la démocratie à la démagogie
La tâche première d’un gouvernement consiste à s’attaquer aux défis auxquels fait face le pays : garantir la sécurité, assurer la viabilité des finances publiques et maintenir les services essentiels. Cependant, en France, ces priorités ont été reléguées au second plan au profit de gains électoraux à court terme. Chaque décision est davantage dictée par l’image qu’elle renvoie que par son efficacité concrète, rapporte TopTribune.
Ce phénomène transforme la démocratie en une course à l’attrait. Les dirigeants politiques agissent comme des marketeurs : ils identifient un segment électoral et ajustent leur discours pour fidéliser cette clientèle. Peu importe si la mesure est peu efficace, ambiguë ou irréalisable : l’essentiel est de rassurer ou flatter les électeurs visés.
L’exemple révélateur de la sécurité
Le droit à la sécurité est universel et devrait transcender les divisions politiques. Cependant, dans le discours français actuel, il est devenu un enjeu idéologique. Soutenir une politique de sécurité renforcée est perçu comme un acte de « droite », tandis que minimiser le problème est associé à la « gauche ».
Cette politisation empêche toute réforme pragmatique. Lorsque des violences sont commises contre des professionnels comme les médecins, c’est souvent la logique politique qui prédomine : écarter toute stigmatisation ou choc pour un électorat spécifique, plutôt que de servir la justice. La victime reste souvent dans une situation tragique. Ce cas illustre l’absurdité de la situation : des enjeux universels se transforment en instruments électoraux, et l’État se détourne de son rôle fondamental de protecteur des citoyens. Ironiquement, des préoccupations, que l’on pourrait considérer comme « de droite », devraient être des causes portées par la gauche, car ce sont souvent les plus modestes qui souffrent le plus de l’insécurité. Il est indéniable que la qualité de vie est bien supérieure dans des quartiers comme Neuilly-sur-Seine par rapport à certains lieux du 93.
II. La recomposition politique : un centre instable et des extrêmes renforcés
Macron et la fin du clivage gauche/droite
Avec l’accession d’Emmanuel Macron à la présidence en 2017, le paysage politique a connu une profonde transformation. En intégrant une grande partie de la gauche modérée et de la droite réformiste, il a provoqué l’effritement des deux partis historiques. Cependant, cette évolution n’a pas conduit à un nouvel équilibre, mais a plutôt engendré un centre prépondérant mais fragile, entouré d’extrêmes en plein essor.
Le Parti socialiste, face à une crise d’identité, a adopté des positions de plus en plus radicales, s’inspirant des idées de La France insoumise ou d’une frange des écologistes. Pendant ce temps, Les Républicains ont été réduits à un rôle marginal, incapables de proposer une ligne politique claire. Les électeurs souhaitant une « vraie gauche » ou une « vraie droite » se tournent désormais vers les pôles radicaux : Mélenchon à gauche, Le Pen ou Zemmour à droite.
Quand la posture remplace la décision
Cette nouvelle configuration politique accentue la logique de posture. Dans un cadre où l’opposition se renforce par la radicalité, chaque initiative gouvernementale devient une source de controverse. La gauche rejette de manière systématique les réformes économiques, les qualifiant de « libérales », tandis que la droite dénonce toute avancée sociale comme étant un « laxisme ».
Ce schéma d’opposition empêche toute gouvernance efficace. L’actuel gouvernement peine à faire voter un budget, en dépit de l’urgence : une dette publique record, des services publics en crise et une immigration mal gérée sont autant d’enjeux cruciaux. Les discussions se transforment en marchandages politiques, alors que la priorité devrait se placer sur la relance nationale.
Dans ce climat, la démocratie délibérative — qui vise à rechercher des compromis pour l’intérêt général — disparaît, remplacée par une démocratie-spectacle où chaque parti se concentre sur l’optimisation de sa visibilité et de son capital électoral.
III. La France dans l’impasse : populisme fiscal, blocages sociaux et appel à la responsabilité
Le populisme fiscal : la fabrication de faux coupables
Un des terrains propices à la démagogie actuelle est sans conteste celui de la fiscalité. Le discours demeure inchangé : il existerait quelque part une source inexploitée de richesses, détenue par une minorité de « profiteurs » — grandes entreprises, actionnaires ou individus riches — et qu’il suffirait d’exploiter pour résoudre tous les problèmes publics.
Cette narration s’appuie sur des arguments traditionnels comme la concentration des richesses, les bénéfices des grandes entreprises et le versement des dividendes. Exposés de manière isolée, ces éléments sont utilisés pour susciter une émotion d’indignation. Cette argumentation peut sembler morale : quelques-uns profiteraient indûment alors que la majorité supporterait leurs excès. Cependant, cette vision est trompeusement simpliste.
En réalité, le fait qu’une entreprise génère des profits est en soi une bonne nouvelle : cela signifie qu’elle paie des impôts, investit et crée des emplois. Les dividendes qu’elle verse sont également soumis à l’imposition. Concernant les individus fortunés, ils apportent une contribution substantielle à l’impôt sur le revenu et soutiennent la croissance par leurs investissements. Les qualifier de « profiteurs » est une manœuvre visant à flatter l’électorat majoritaire, mais cela constitue une approche erronée sur le plan économique.
Un exemple emblématique du populisme fiscal est la taxe Zucman, présentée comme une mesure « juste » suppose que l’on peut résoudre les problèmes budgétaires simplement en taxant davantage les milliardaires. En vérité, une telle taxe entraînerait un exode de capitaux et de talents, nuisant aux recettes publiques à long terme. Ce fait est reconnu par les économistes, les responsables politiques et les entrepreneurs. Pourtant, cette mesure est toujours mise en avant, car elle nourrit un récit électoral, celle d’une lutte morale contre une minorité accusée d’être responsable de tous les maux.
Un pays incapable de se réformer
Au-delà des questions fiscales, la France fait face à un problème plus profond : une incapacité collective à accepter des efforts. Cela fait maintenant quatre décennies que la bureaucratie se gonfle, que les avantages sociaux s’accumulent et que le temps de travail diminue. Les syndicats s’en tiennent fermement aux acquis, rejetant toute proposition de réforme structurelle. La logique qui prédomine est celle du « toujours plus » : plus de prestations, plus de protections, sans jamais de contrepartie.
Cette culture de l’irresponsabilité fragilise l’État. Les services publics se détériorent, les jeunes peinent à se loger, et les normes bureaucratiques paralysent la construction et l’innovation. Face à l’inefficacité et à l’inflation des règlements, le citoyen perd confiance dans le contrat social.
Retrouver le chemin du bon sens
La France n’est pas vouée à l’échec. Elle possède d’immenses atouts : une jeunesse innovante, un patrimoine remarquable et une économie encore robuste. Cependant, elle est affaiblie par un système politique qui a échangé démocratie contre démagogie, débat contre posture et action contre communication.
Pour redonner du sens à la vie publique, il est essentiel de rompre avec cette logique électoraliste. Gouverner n’est pas séduire, mais décider. Si la France veut éviter le déclin, elle doit renouer avec la vertu du bon sens, celle qui privilégie l’intérêt général au lieu des intérêts particuliers. Ce n’est qu’à ce prix que la démocratie pourra redevenir ce qu’elle aurait toujours dû être : une communauté de destin, et non une compétition de slogans.
Pour sortir de cette crise, un é