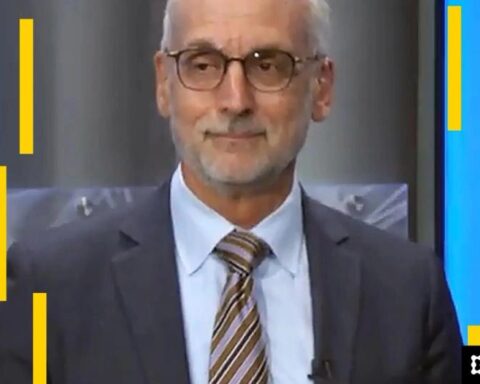La guerre des douze jours : une rupture dans l’équilibre du Moyen-Orient
Durant une période de seulement douze jours, un conflit intense a redéfini les dynamiques au sein du Moyen-Orient. Le 12 juin, Israël a ouvert un nouveau front contre l’Iran, poursuivant ses opérations prévues contre des groupes tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, qui constituent des éléments centraux de l’« axe de la résistance ». Cette escalade de la violence a engendré des échanges de frappes quasi quotidiens et particulièrement meurtriers, avec un bilan tragique de 1 054 décès en Iran, tandis qu’Israël a compté 28 pertes humaines, selon les estimations d’une ONG, rapporte TopTribune.
Le conflit a connu un point de basculement le 22 juin, lorsque les États-Unis, sous l’administration de Donald Trump, ont décidé d’intervenir militairement. Avec le déploiement de 125 avions, dont sept bombardiers furtifs B-2, Washington a déclenché une attaque surprise visant trois installations nucléaires en Iran. En réponse, Téhéran a riposté en ciblant une base militaire américaine située au Qatar, augmentant ainsi les craintes d’une réaction en chaîne qui pourrait élargir le conflit à toute la région.
Après deux jours de tensions exacerbées, le président américain a proposé un cessez-le-feu, bien que des frappes sporadiques aient continué à être rapportées. Dans ce contexte tumultueux, chaque acteur impliqué a revendiqué une forme de victoire : Israël et les États-Unis soutiennent avoir significativement retardé le programme nucléaire iranien – une affirmation qui reste controversée et difficile à vérifier – tandis que l’Iran met en avant la résilience de ses forces et se vante de la supposée faiblesse israélienne.
Le régime des Mollahs, bien qu’affaibli, parvient à maintenir son autorité après ces douze jours de conflit. Cependant, la population civile exprime des craintes croissantes face à un possible resserrement des mesures répressives à l’intérieur du pays, alors que des appels à la résistance demeurent audibles.
Cette situation délicate est aussi illustrée par un dessin humoristique brésilien représentant Donald Trump et Benyamin Netanyahou engagés dans une dangereuse « roulette nucléaire », lançant des missiles dans l’espoir de frapper les sites nucléaires iraniens, tout en soulignant l’incertitude des conséquences de leurs actions.
Thiago Lucas, un historien né en 1987 à Recife, illustre cette réalité complexe à travers ses travaux. Diplômé de l’Université Fédérale de Pernambuco, il a approfondi ses recherches sur la caricature comme une forme de discours critique sur les défis que représente « l’industrie de la sécheresse » dans le nord-est du Brésil. Son intérêt pour la caricature a émergé dès l’adolescence, lorsqu’il s’est passionné pour les dessins publiés dans la presse locale de l’État de Pernambuco. Pour lui, aborder le monde par le biais de l’humour graphique constitue une forme de résistance et d’engagement face à un univers marqué par les inégalités et l’exclusion.