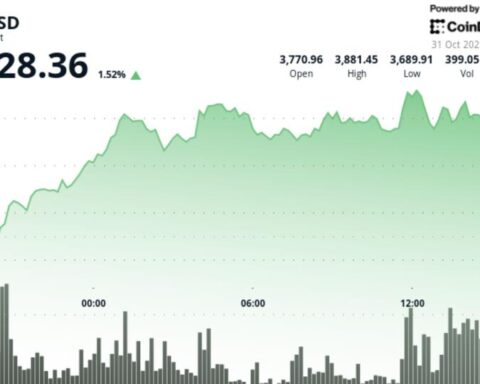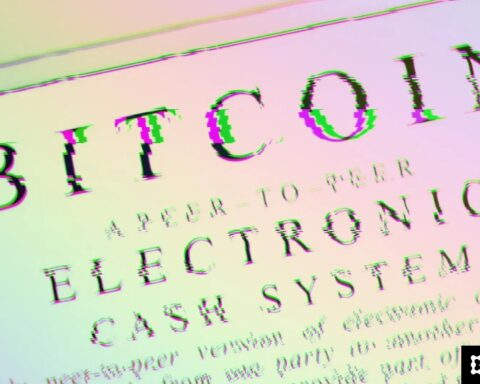Les tensions internationales concernant la menace nucléaire sont à nouveau sur le devant de la scène. Le président américain, Donald Trump, a annoncé le 28 octobre la reprise des essais nucléaires militaires par les États-Unis. Ce message, partagé sur le réseau social Truth Social, ne précise ni la date ni le lieu des essais, laissant craindre des répercussions sur la sécurité mondiale, rapporte TopTribune.
Historiquement, entre les années 1960 et 1990, les pays souhaitant tester leur capacité militaire ont privilégié des zones désertiques. Cela inclut le Sahara algérien pour la France, ainsi que les îles de Mururoa et de Fangataufa en Polynésie française, le Nevada pour les États-Unis, et le site de Semipalatinsk au Kazakhstan pour l’ex-URSS.
La mise en place de normes de sécurité
Dès les premiers essais nucléaires français en 1957, la question de la localisation des tests s’est posée. Bien que la France cherchait à développer son arsenal atomique, elle avait également la nécessité de garantir la sécurité. Des normes de sécurité ont ainsi été mises en place pour limiter les impacts environnementaux des tirs et prévenir les incidents humains.
Le régime habituel des vents et des prévisions météorologiques étaient rigoureusement examinés avant chaque test. La Commission Consultative de Contrôle (CCC) établissait également des zones de sécurité pour les populations autour des sites d’essai, structures basées sur les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), en tenant compte de l’irradiation prévisible.
Selon un rapport parlementaire de février 2002, « la dose maximale admissible annuelle était fixée par la CCS à 15 mSv en 1960 puis 5 mSv à partir de 1961 ». Ces chiffres sont aujourd’hui jugés excessifs par les experts, l’Autorité de la sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) indiquant que la dose sans danger est désormais estimée à 1 mSv par an, bien qu’un Français soit exposé en moyenne à 4,5 mSv chaque année.
Une mésestimation des retombées atmosphériques
Les sites choisis pour les essais qui se trouvaient initialement à 100 ou 150 km des villes les plus proches ne transmettaient pas une image fidèle des dangers auxquels les populations étaient exposées. De nombreux campements, notamment durant les essais en Algérie, se trouvaient à moins de 30 km des zones de test, avec des retombées mesurées à plus de 200 km.
« C’était insuffisant, et nous le savons aujourd’hui », déclare Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire pour Greenpeace France. « Les essais nucléaires ne sont que des explosions atomiques. Les conséquences sont mesurables, et une augmentation de la radioactivité ambiante a été observée non seulement à la suite des essais français mais aussi des autres pays ».
Au cours de cette période, l’exposition de certaines populations à la radioactivité résultant des essais était considérée comme inévitable, mettant en péril les vies de ceux qui vivaient à proximité des sites de lancement.
La planète « saupoudrée » de produits radioactifs
« La population sans le savoir est devenue un sujet d’expérimentation. Lors des essais, le danger réel n’était pas communiqué. Les militaires ont également été utilisés comme cobayes. En Algérie, certains ont été envoyés au centre des explosions nucléaires, ce qui a coûté la vie à beaucoup », souligne une activiste de Greenpeace, insistant sur le caractère profondément colonialiste du nucléaire militaire.
Les nuages radioactifs échappent aux frontières, et leur trajectoire imprévisible a contaminé d’autres territoires. Geneviève Baumont, experte de l’Institut de recherche pour la sûreté nucléaire (IRSN), note que « des milliers de tir dans l’hémisphère nord dans les années 1960 ont contaminé les sols. Par exemple, certains vins de cette époque contiennent des produits de fission liés aux bombes atmosphériques ». Une situation alarmante qui démontre l’ampleur de la contamination radioactive planétaire.
La radioactivité contenue dans des cavités
Pour ne pas renforcer ce constat troublant, la France a décidé au début des années 1960 de déplacer les essais nucléaires souterrains vers les montagnes algériennes. Ces sites étaient choisis pour leur altitude et pour leur éloignement des populations.
Un rapport de 2002 précise que certains sites étaient dotés d’entrées de galeries conçues pour contenir les matériaux radioactifs produits. Cependant, quatre des treize essais souterrains dans le Hoggar entre 1961 et 1966 n’auraient pas été complètement confinés. Par la suite, des essais ont également eu lieu dans les lagons polynésiens entre 1975 et 1991.
Des modèles simulés en laboratoire
Depuis les derniers essais français de 1996, un retour vers des simulations en laboratoire a été effectué pour des raisons évidentes de sécurité. « Aujourd’hui, nous avons les technologies nécessaires pour simuler la fusion nucléaire et tester les capacités d’une bombe sans nécessiter d’essais réels », explique Geneviève Baumont.
Le centre CEA-Cesta, près de Bordeaux, dédié à la conception des têtes nucléaires françaises, a développé diverses armes nucléaires en laboratoire. Pour Pauline Boyer, « il serait incroyable, aujourd’hui, avec les connaissances actuelles sur la radioactivité, de reprendre des essais nucléaires ».
Avec 8 milliards d’habitants sur la planète et des écosystèmes déjà menacés, tout nouvel essai pourrait causer des dégâts irréversibles.
Une interdiction complète des essais nucléaires
En tout, la France a réalisé 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996, tandis que plus de 2 000 essais ont été menés dans le monde entre 1945 et 2017. Un traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) a été signé par 187 pays, dont les États-Unis, en 1996 à New York. Ce traité, peu contraignant, usufruit cependant d’un moratoire international, sans qu’aucun pays signataire n’ait osé briser cet engagement depuis sa signature.