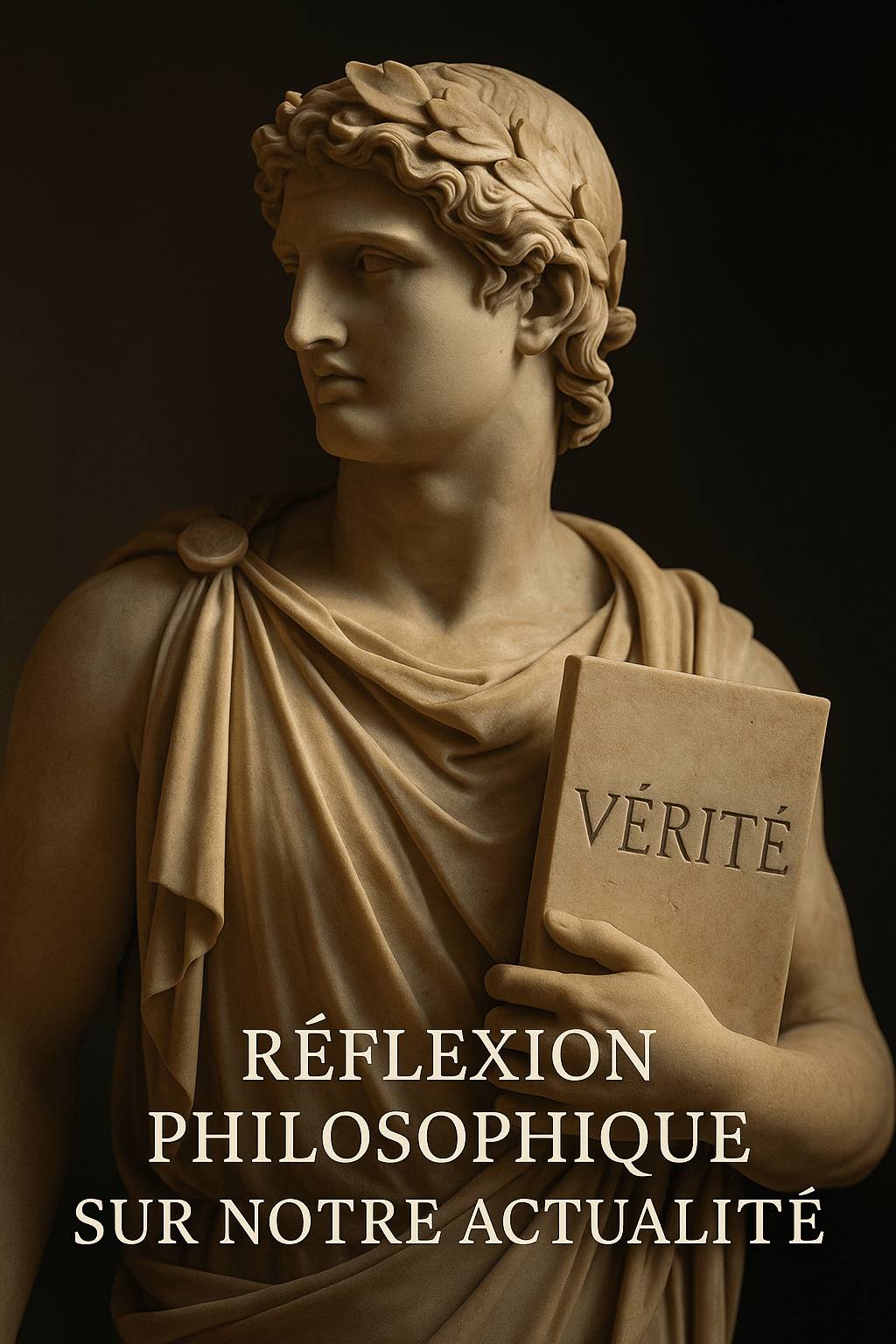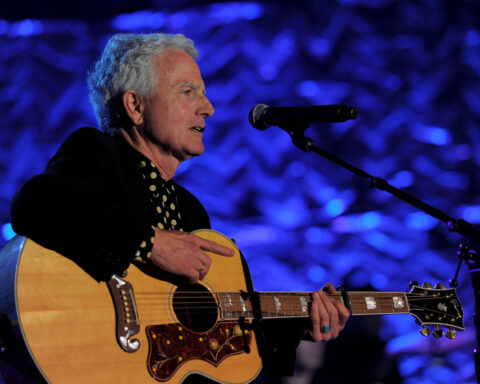Alors que la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a mentionné la possibilité d’un nouvel impôt sur les successions, il est crucial de se poser la question : qu’est-ce qu’hériter ? Et surtout, qu’est-ce que posséder ? Taxer l’héritage, au-delà d’un simple geste fiscal, touche à un lien invisible qui unit la liberté, la responsabilité et la mémoire, rapporte TopTribune.
I. La propriété, symbole de liberté
La propriété, selon les mots de Locke, émerge lorsque l’individu combine son travail avec la substance du monde. Il ne s’agit pas seulement d’argent, mais de dignité. L’individu s’empare de la réalité car il y investit son effort, sa sueur et sa détermination. Ainsi, la propriété devient la manifestation tangible de la liberté. Hegel y voit la première expression de l’esprit libre, où l’idée de liberté prend forme concrète. Posséder ne consiste pas à accumuler, mais à habiter le monde comme un acteur responsable de ses transformations. De plus, Chantal Delsol ajouterait que la propriété représente un enracinement, une manière d’exister dans le temps. Posséder, c’est reconnaître l’héritage du passé tout en se préparant pour l’avenir. Cela implique une continuité morale, pas simplement un plaisir matériel. Taxer ce lien, c’est le fragiliser ; c’est percevoir la propriété comme un privilège, plutôt que comme une responsabilité. C’est ignorer que la liberté n’existe que lorsque se manifestent des actions concrètes : travailler, construire, transmettre.
II. L’héritage, prolongement du vouloir humain
Hériter ne se limite pas à recevoir ; c’est s’inscrire dans la continuité du désir. Transmettre n’est pas un acte aléatoire ; c’est prolonger un projet, maintenir une fidélité, honorer une mémoire. Lorsque l’État impose un impôt sur les successions au nom de l’égalité, il réduit ce geste à une simple mécanique de redistribution. L’héritage n’est pas un produit du hasard, ni une « chose tombée du ciel » : c’est le résultat d’une existence, le prolongement d’un effort personnel, la marque d’une responsabilité. Tocqueville identifiait déjà le risque que présente la passion pour l’égalité, qui peut menacer la liberté. L’individu moderne, en quête de justice, est souvent prêt à renoncer à ses droits tant qu’il est traité de manière égalitaire. Mais que reste-t-il d’une société où la transmission est suspecte ? Comte-Sponville le formule différemment : la fraternité n’a de sens que si elle repose sur la liberté. Une égalité dépourvue de mérite et de gratitude ne peut être considérée comme juste ; elle devient un système fondé sur l’envie.
III. La dégradation de la civilisation du lien
Chaque civilisation repose sur la continuité du don et du contre-don : ce que je reçois, je le transmets. Éliminer la transmission, c’est interrompre cette chaîne et réduire l’existence à un instant éphémère. L’égalitarisme contemporain engendre cet « homme sans héritage » évoqué par Chantal Delsol : déraciné, sans mémoire, il existe dans un présent éternel de revendication. Au contraire, l’homme attaché à la propriété vit dans la durée, conscient de ce qu’il doit à ceux qui l’ont précédé et à ceux qui viendront après lui. Taxer l’héritage, ce n’est pas uniquement un prélèvement financier : c’est instaurer une suspicion morale envers le legs, comme si donner devenait une injustice, comme si aimer à travers le temps constituait une faute. La propriété n’est pas une inégalité ; elle établit un lien. Une société qui rompt ce lien est vouée à s’effacer. Car une civilisation ne périt pas à cause de la pauvreté, mais lorsqu’elle cesse de croire en la transmission.