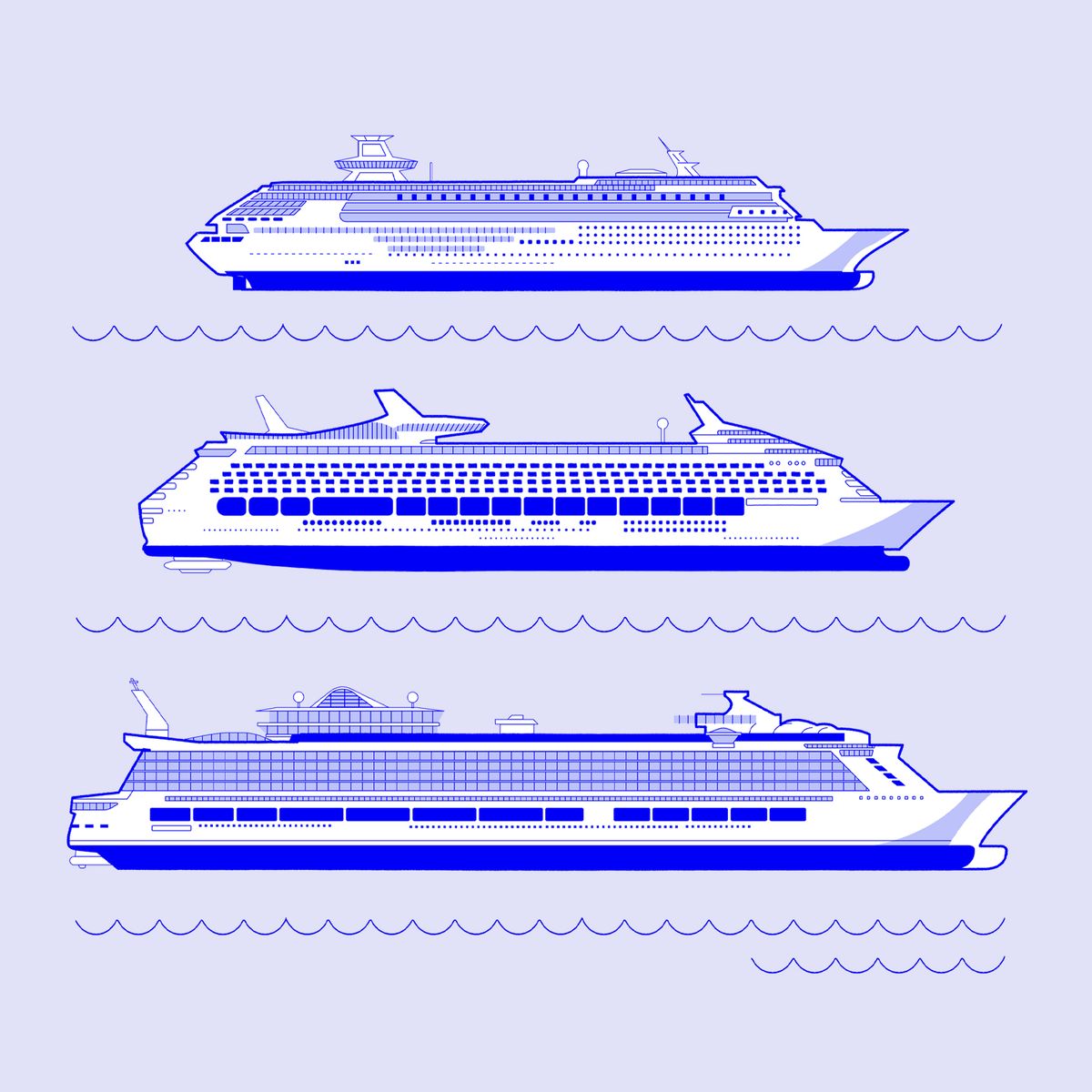Quand la planète tourisme s’est arrêtée de tourner au printemps 2020, rien ne laissait présager que le « monde d’après » ressemblerait à ce point au « monde d’avant ». Dans les airs, l’aviation a retrouvé en 2024 une activité comparable à celle précédant la pandémie de Covid-19. Dans les mers, les croisières ont même vu leur nombre d’adeptes exploser. En 2023, ils étaient 6,8% plus nombreux qu’en 2019, selon le dernier rapport de l’Association internationale des compagnies de croisières (Clia).
Avec 31,7 millions de passagers, les croisières ont accueilli sur l’année dix fois plus de vacanciers flottants qu’à la fin des années 1980, quand la célèbre série télé La Croisière s’amuse s’achevait. « Il y a encore de la place pour plus de croissance », flairait le représentant des professionnels de la croisière dans une interview de 1989. Mais la planète bleue peut-elle seulement tolérer ces « monstres des mers », selon le terme employé par Christian Estrosi ?
Avant d’accueillir la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan du 9 au 13 juin, le maire de Nice profitait de l’escale du Norwegian Epic (et de ses 4 000 passagers) en rade de Villefranche-sur-Mer pour promettre sur le réseau social X l’interdiction au 1er juillet des navires de plus de 2 500 occupants dans ses eaux cristallines, l’élu invoquant une pollution dangereuse et des retombées économiques moindres sur la terre ferme.
Une expansion que rien n’arrête
Mais en dépit des critiques, ces immenses hôtels flottants vivent bel et bien leurs meilleures années – au détriment de leur aire de jeux, l’océan, toujours plus fragilisé par les pollutions en tout genre et le réchauffement climatique. « Dans le secteur du tourisme, l’activité des croisières est celle qui connaît la croissance la plus rapide », observe Fanny Pointet, responsable du transport maritime chez Transport&Environnement, une ONG européenne qui milite pour des transports propres.
« Depuis les années 2000, les bateaux de croisière sont deux fois plus nombreux et aussi deux fois plus gros. »
Fanny Pointet, spécialiste du transport maritime
Ce gigantisme a fait l’objet d’un rapport de l’ONG en 2014, année de mise en service de l’Icon of the Seas, dernier-né de la flotte XXL de la compagnie Royal Caribbean. Ces « méga paquebots » y sont rebaptisés « Cruisezillas », mélange de « cruise » (croisière en anglais) et de Godzilla, le monstre radioactif japonais qui se cure les dents avec des chalutiers.
Avec ses dimensions (364 mètres de long) et sa jauge (de quoi loger 5 610 vacanciers et 2 350 membres d’équipage), l’Icon of the Seas écrase le premier « méga bateau de croisière » de la compagnie, lancé dans les années 1990. LeSovereign of the Seas, géant de l’époque, mesurait 268 m de long (soit près de 100 mètres de moins) et pouvait recevoir 2 650 passagers, servis par 825 membres d’équipage.
Sur les sept nouveaux navires de croisière mis à l’eau en 2024, cinq dépassent très largement ces anciennes jauges records, selon le dernier rapport de l’Association internationale des compagnies de croisières. Quant au douze paquebots qui démarrent leur activité en 2025, ils affichent une capacité moyenne de 3 245 passagers.
« Si on continue sur cette même courbe de croissance, le risque, c’est que des bateaux de croisière qui peuvent accueillir presque 10 000 personnes ne deviennent la norme dans quelques décennies. »
Fanny Pointet, spécialiste du transport maritime
D’autant que toutes les grandes compagnies (Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line, MSC…) s’y mettent, rivalisant dans la démesure. « En 2050, un bateau de croisière classique pourrait faire huit fois la taille du Titanic« , avertit Fanny Pointet. Avec quand même plus de restaurants et surtout plus de toboggans (six dans l’Icon of the Seas).
Des villes sur l’eau au détriment des océans
Car dans la plupart des croisières, les prestations du paquebot importent autant, voire plus, que les destinations visitées, expliquent les professionnels du tourisme. « Ce qui plaît aux Français dans les croisières, c’est la qualité du service, le côté ‘tout compris’, l’abondance d’activités, de nourriture, de spectacles, de boutiques », listait le directeur du cabinet Protourisme, Didier Arino, interrogé par l’AFP en mars. Les vacanciers aiment « l’effet ‘wahou’, le gigantisme », remarquait-il, en notant que l’argument écologique « peut refroidir une partie de la clientèle qui se sent coupable ». « Surtout dans des villes comme Marseille », où l’accès au port des paquebots divise collectifs d’habitants et professionnels du secteur.
Même s’ils ne représentent qu’une goutte d’eau à l’échelle de l’économie maritime (quelques centaines de navires à travers le monde, responsable de 3% du total des émissions du transport maritime en 2022, selon l’OCDE), les paquebots de croisières « sont ceux qui émettent individuellement le plus de gaz à effet de serre », relève Fanny Pointet, qui cite les prestations à bord, de plus en plus variées et souvent énergivores. Patinoires, vagues artificielles, cinémas, restaurants… « Rien que des frigos, de la clim, etc. Cela consomme énormément de carburant. »
/2025/06/05/cleanshot-2025-06-05-at-15-28-40-2x-1-68419c07e6de8619366387.png)
Selon le Conseil international des transports propres (ICCT), un ONG basée aux Etats-Unis, un vacancier qui s’offre une croisière de cinq jours et 2 000 km à bord d’un des navires les moins polluants émet le temps de son séjour sur l’eau plus du double de CO2 (500 kg de CO2) qu’un touriste qui a pris l’avion vers son lieu de villégiature et a passé le même nombre de jours dans un hôtel 4 étoiles « à terre » (235 kg de CO2).
Les croisières bientôt persona non grata ?
Comme l’ensemble du secteur du transport maritime, les croisiéristes abandonnent progressivement le fioul lourd, afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de se conformer aux règles de plus en plus strictes de l’Organisation maritime internationale et de l’Union européenne. Veillant à leur image de marque, les compagnies communiquent abondamment sur le passage de leur flotte au gaz naturel liquéfié (GNL). Fanny Pointet pointe « un argument de vente qui relève du greenwashing ».
Et pour cause, l’extraction, le stockage et l’utilisation du GNL sur tout le cycle de vie du navire entraînent des fuites de méthane, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 28 fois supérieur au CO2. Même si brûler du GNL émet quelque 25% de CO2 en moins dans l’atmosphère en comparaison avec les carburants autrefois utilisé, plus il y a de navires utilisant du GNL, plus les émissions de méthane augmentent, « et moins il y a de bénéfice pour le climat à utiliser du GNL, quel que soit le moteur utilisé », calculait une étude de 2020 du Conseil international des transports propres.
Se promener sur la Méditerranée ou dans les Bahamas à bord d’une ville flottante génère par ailleurs le même type de pollutions que ce que l’on retrouve dans une cité de la terre ferme : déchets, eaux usées, pollutions de l’air… En 2023, l’ONG Transport&Environnement a ainsi calculé que l’explosion de l’activité des croisiéristes après le Covid-19 s’était traduite en Europe par un bond des émissions d’oxyde de soufre (+9%), d’oxyde d’azote (+18%) et de particules fines PM2,5 (+25%).
« Malgré l’introduction du plafond d’émissions de soufre par l’organisme maritime des Nations unies en 2020, les 218 navires de croisière européens ont émis plus d’oxydes de soufre qu’un milliard de voitures en 2022, soit 4,4 fois plus que l’ensemble des voitures du continent », alerte l’ONG. A Marseille, les 75 bateaux de croisière qui ont accosté cette année-là ont émis deux fois plus d’oxyde de soufre que l’ensemble des presque 370 000 voitures immatriculées dans la ville, selon les calculs de l’ONG.
Pour limiter cette pollution lors d’escales qui peuvent durer plusieurs jours, tous les navires de plus de 5 000 tonnes de jauge brute (croisières y compris) accostant dans un port européen devront, d’ici 2030, se raccorder à l’électricité fournie sur place. Un autre défi logistique pour les villes portuaires qui, de plus en plus, décident de limiter le nombre de bateaux de croisières autorisés à jeter l’ancre, via des taxes, des jauges et des interdictions pures et simples.
Alors que les locaux dénoncent les nuisances attribuées au surtourisme, comme ces dernières années à Venise (Italie), Dubrovnik (Croatie) ou Amsterdam (Pays-Bas), quel avenir pour les géants des mers, de plus en plus gros et de plus en plus chargés ? Vont-ils renoncer à certaines destinations, faute de pouvoir approcher des côtes, quitte à ne plus du tout rejoindre la terre ferme ? En annonçant à la presse début avril ses ambitions pour les cinq prochaines années, la compagnie américaine Carnival n’envisageait pas de réduire la voilure : en juillet, elle inaugurera un nouveau complexe de vacances privé sur l’île de Grand Bahama, exclusivement réservée aux passagers de la compagnie, décrit le site spécialisé Marine Executives. Un complexe similaire au large du Honduras sera aussi étendu. Pour les compagnies maritimes engagées dans la course au gigantisme, pourquoi ne pas poursuivre sa croisière sur la terre ferme ?