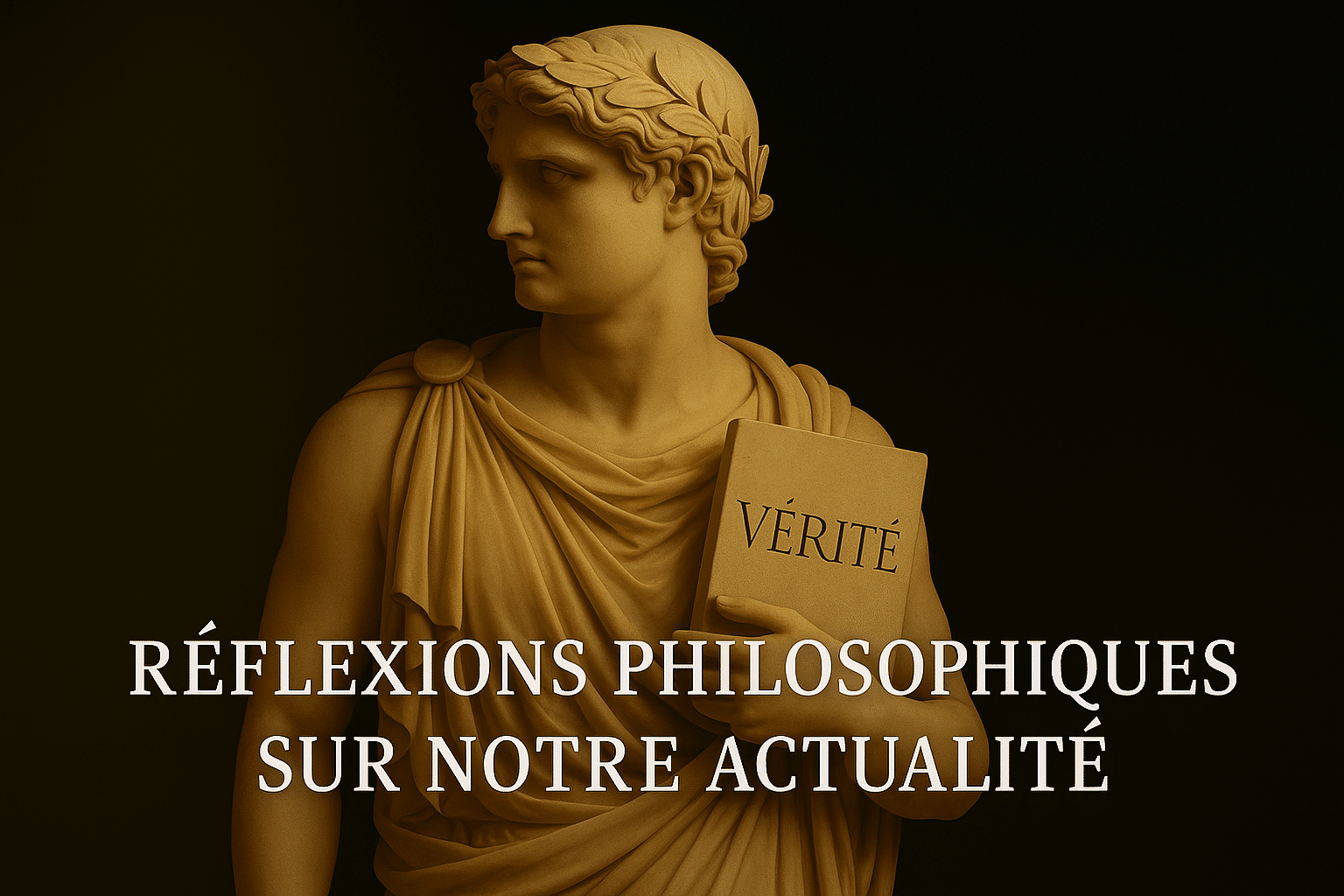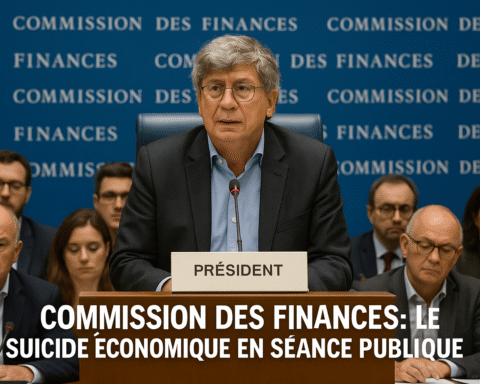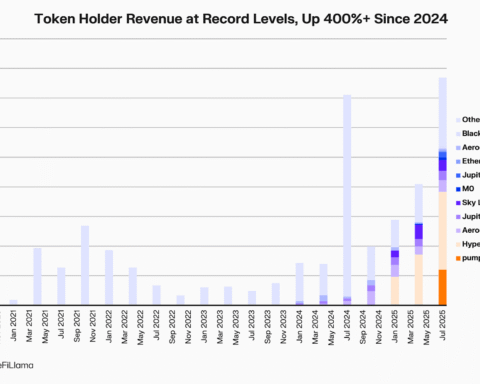Les démocraties s’effondrent lorsque la loi se transforme en morale. L’impôt, initialement conçu comme un devoir civique, devient alors un outil de jugement moral. Ce changement s’illustre par le cri « Taxez les riches » : la République passe de l’administration à la punition des citoyens. Ce glissement moral, qui se cache derrière le prétexte de l’égalité, trahit le principe du droit : il va à l’encontre de la Déclaration de 1789, qui établit que la contribution doit être fondée sur la proportionnalité et la propriété sur la liberté. Lorsque la morale pénètre dans la fiscalité, la liberté s’évapore du domaine du droit, rapporte TopTribune.
I. La propriété, socle de la liberté moderne
La Déclaration de 1789 ne crée pas la propriété, mais la reconnaît comme un fait fondamental. « La propriété étant un droit inviolable et sacré », affirme l’article 17 — non pour glorifier le propriétaire, mais pour établir la définition même de la liberté. Être libre, c’est pouvoir disposer de soi et des fruits de son travail ; c’est agir dans le monde avec responsabilité. Ainsi, la propriété est une continuité qui lie l’individu à ses créations, héritages, et transmissions. Toute atteinte à cette propriété constitue une atteinte à la liberté, car elle fragilise l’intégrité personnelle. Cet article fixe une limite à tout pouvoir : nul ne peut être dépossédé de son bien, excepté pour des raisons d’utilité publique, et ceci sous réserve d’une juste indemnité préalable. Ce texte dépasse le cadre juridique pour s’affirmer comme fondement moral. Il insiste sur le fait que la loi n’est juste que lorsqu’elle se fixe des limites et que l’État est légitime uniquement s’il renonce à l’absolutisme. Si la propriété n’est plus protégée, le droit s’effondre et la liberté disparaît.
II. L’impôt : du lien civique à la morale punitive
L’article 13 de la Déclaration précise : « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Cette conception de l’impôt en fait un devoir civique, un acte de solidarité, plutôt qu’un instrument de réprobation. Le citoyen participe parce qu’il fait partie de la communauté, pas parce qu’il doit expier une faute. Cependant, la République moderne a introduit la morale dans la fiscalité. Le slogan « Taxez les riches », omniprésent lors des manifestations et dans certaines chansons engagé, symbolise ce changement. L’impôt ne sert plus à financer l’État, mais à évaluer les individus ; il ne s’agit plus de répartir équitablement la charge, mais de réorienter des parcours de vie. Cette intrusion morale représente une rupture conceptuelle. Elle contredit l’article 13, qui base l’impôt sur la proportion, et l’article 17, car en décrivant la richesse comme une faute, elle justifie l’expropriation. L’égalité recherchée devient matérielle plutôt que politique : il ne s’agit plus d’assurer des droits identiques, mais de réduire les disparités en touchant à la propriété elle-même. Taxer le stock de richesse s’attaque à la racine même du droit, confondant redistribution et saisie. En prétendant rétablir l’égalité, on efface la liberté.
III. Le glissement de la démocratie vers la morale d’État
Les démocraties contemporaines s’illusionnent en croyant pouvoir moraliser l’économie sans remettre en question le droit. Elles pensent que la justice fiscale peut remplacer la justice politique. Mais lorsqu’une majorité décide de « faire payer les riches » pour corriger les inégalités, elle sort du cadre républicain pour entrer dans celui du moralisme. La démocratie devient alors le pouvoir du nombre contre le droit. C’est ainsi que la majorité détermine la richesse acceptable, le patrimoine tolérable, et le revenu légitime, transformant le vote en un instrument de spoliation et pervertissant le consentement. La République commence à gouverner par la morale et à sanctionner au nom de la vertu. Or, cette vertu imposée par la loi n’est plus morale ; elle devient une forme de contrôle. Lorsque la fiscalité cesse d’être un moyen et devient une fin, et qu’elle prétend purifier la société en frappant ceux qui possèdent, elle quitte le domaine politique pour s’insérer dans une logique totalitaire. Car le totalitarisme débute par le refus de la limite : il ne supporte pas que quelque chose échappe au pouvoir. La propriété, le travail, la transmission : tout doit être soumis à la morale de l’État. En cela, la « justice fiscale » moderne trahit l’esprit de 1789. L’impôt ne devrait pas viser à rendre tous les hommes égaux, mais à leur permettre de rester libres ensemble. La République se fonde non sur la jalousie, mais sur des limites ; non sur la morale corrective, mais sur la responsabilité. Le respect de cette limite est essentiel pour préserver les droits humains aujourd’hui.
Conclusion
La République a été bâtie sur la distinction entre loi et morale, entre droit et vertu. En confondant ces notions, elle risque de compromettre la liberté qu’elle prétend défendre. La fiscalité n’est pas destinée à corriger les âmes, mais à favoriser le bien commun. Lorsque l’impôt devient un outil de punition, le citoyen perd toute liberté. Rétablir la juste mesure de l’impôt, c’est reconquérir la dignité du droit.