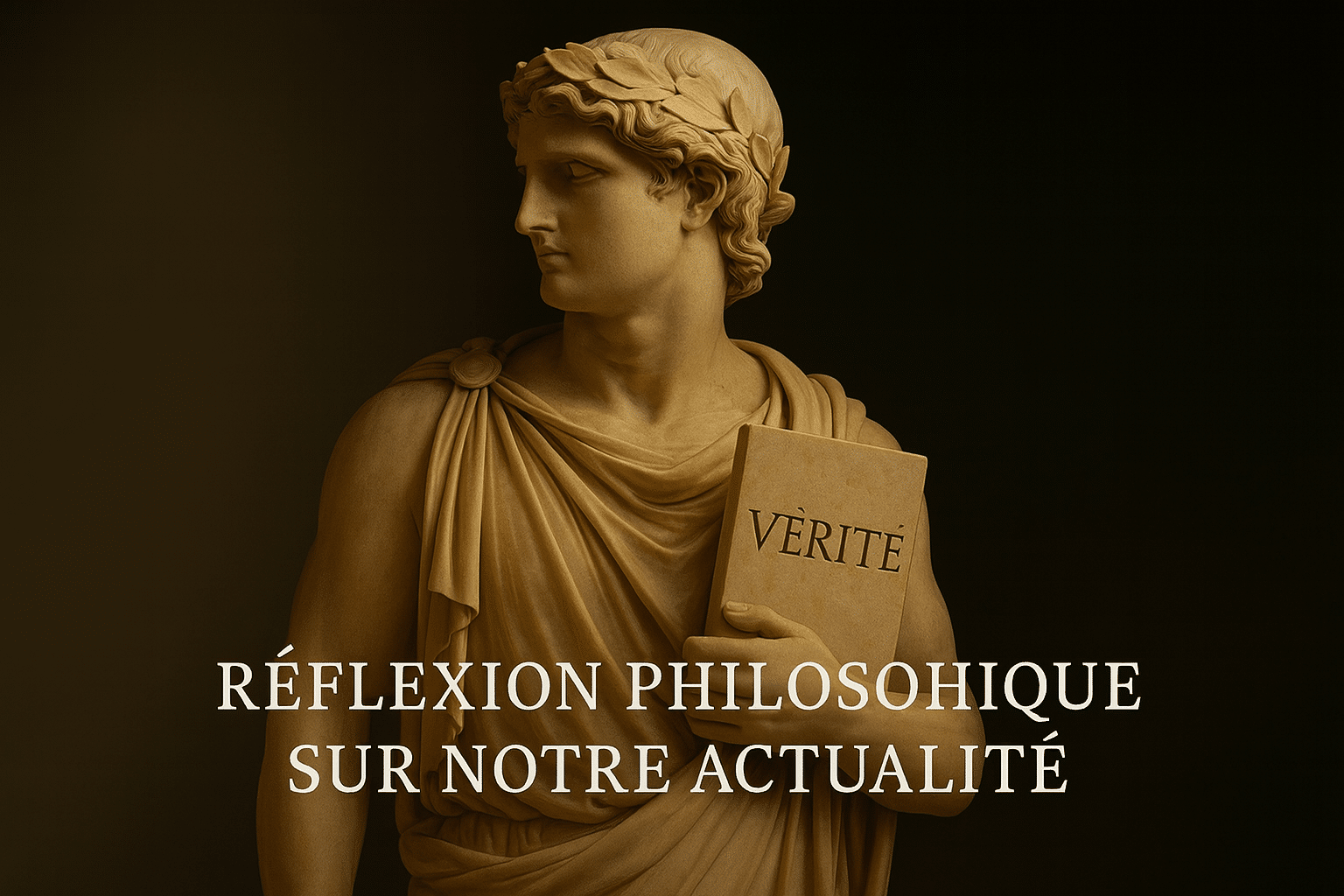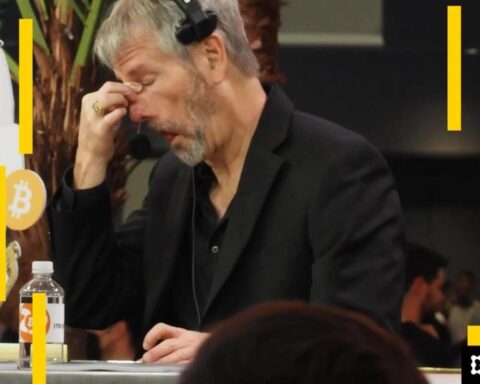La politique, autrefois conçue comme l’art de la responsabilité, est désormais perçue comme un calcul machiavélique. En France, chaque décision paraît dictée non par l’intérêt général, mais par des considérations électorales. Au fil des renoncements et des facilités, le pays s’enfonce dans un déclin dont personne ne se sent responsable, rapporte TopTribune.
La démocratie représentative repose sur une promesse éthique : confier à quelques-uns le soin d’agir pour le bien commun. Ce pouvoir, pour être considéré légitime, nécessite une véritable responsabilité. Gouverner, c’est répondre non seulement aux citoyens, mais aussi à l’histoire. Être responsable signifie accepter que chaque décision, même la plus anodine, entraîne une série d’effets dont l’impact va bien au-delà de l’instant présent. Aristote avait déjà mis en garde contre le basculement de la démocratie vers la démagogie : lorsque gouverner le peuple se transforme en le flatter, la démagogie prend le dessus. Le véritable leader ne cherche pas seulement l’approbation, mais anticipe ; il ne gouverne pas pour être adoré, mais pour être utile. La capacité d’un homme d’État à se projeter dans l’avenir pour agir à long terme fait la différence entre le politique et le véritable dirigeant. Ainsi, gouverner implique parfois d’affronter des vérités désagréables et de faire comprendre que la liberté exige des efforts, et que la prospérité ne se conquiert pas sans discipline. Pourtant, au moment où la politique s’acoquine avec la communication, cette exigence morale s’efface de plus en plus. L’action publique s’apparente alors à un simple exercice de communication, où l’on gouverne pour l’image et non pour les résultats.
De la vertu politique au triomphe de la démagogie
Pour que la démocratie perdure, elle requiert de la vertu ; elle s’appuie sur la clairvoyance des dirigeants et la maturité des citoyens. Mais lorsque la quête de popularité prévaut sur l’authenticité, la politique devient un théâtre d’illusions. Le passage du septennat au quinquennat a accentué cette dérive : chaque mandat n’est plus qu’un compte à rebours, avec des décisions devenues des calculs stratégiques. L’art du long terme est relégué au profit de la gestion immédiate. Le rôle du politique n’est plus d’éclairer, mais de rassurer. Ce contexte a favorisé l’émergence des trois promesses fondamentales de la démagogie moderne : travailler moins, gagner plus et faire payer les autres. Ces mythes, répétés durant deux décennies, résument la transformation de la responsabilité en populisme. Travailler moins signifie refuser l’effort et ignorer la fragilité de nos équilibres économiques. Cette tendance se manifeste dans la réforme des retraites et le temps de travail, avec l’idée fallacieuse que la prospérité peut perdurer sans contribution. Gagner plus flatte l’envie, promettant des gains sans explication sur leurs origines, tandis que faire payer les autres représente la plus grande forme de lâcheté politique, déléguant la charge de la justice aux plus favorisés, accusés d’être les sources des maux du pays. Ainsi, nous assistons à un remplacement progressif de l’éthique de la responsabilité par une idéologie de la facilité.
Le court terme comme horizon politique
Cette mentalité à court terme ne se traduit pas uniquement par des slogans ; elle structure l’ensemble des décisions. Les partis politiques, en tant qu’organisations, se consacrent avant tout à leur propre survie, créant ainsi un système de reproduction fondé sur les intérêts individuels de ses membres, dans le cadre de promesses de postes et carrières. Dès lors, une mesure impopulaire ne menace pas seulement une élection, mais l’existence même de l’organisation. L’impopularité devient synonyme de danger, et les réformes audacieuses sont souvent considérées comme des suicides politiques. Cela engendre un cercle vicieux : chaque décision doit plaire, rassurer, ménager, sans jamais froisser. Or, une démocratie gouvernée par la peur de déplaire ne saurait que naviguer de compromis en reculs. Prenons exemple sur la fiscalité : augmenter l’impôt pour les plus riches semble juste et populaire à court terme, mais la réalité est bien plus complexe. Les conséquences à long terme, telles que la fuite des capitaux ou l’exode des talents, sont souvent ignorées. Ce que l’on gagne à court terme peut se perdre en prospérité future. L’illusion du présent repose sur une myopie délibérée, où seuls les effets visibles sont considérés. Cette gouvernance à court terme engendre un déclin silencieux, érodant la confiance et la cohésion sociale, tout en créant un faux sentiment de justice.
L’irresponsabilité individuelle : quand décider ne coûte plus rien
Mais l’irresponsabilité ne se limite pas aux structures : elle s’étend aux individus, ceux qui votent et adoptent des lois en pleine connaissance des conséquences, sans jamais en subir réellement les effets. C’est le paradoxe contemporain d’un pouvoir qui semble gouverner sans être tenu de rendre des comptes. Certaines décisions, prises au nom de la bienveillance ou de la tolérance, ont conduit à des conséquences tragiques. Qui se souvient des parlementaires ayant rendu presque impossible l’expulsion d’étrangers sous OQTF ? Les affaires tragiques, comme celle de Lola Daviet, assassinée à Paris, mettent en lumière les vies perdues à cause de choix politiques. Pourtant, aucun décideur ne se sent responsable des répercussions de ses actes. L’oubli collectif efface les fautes, et l’irresponsabilité devient la norme. À cela s’ajoute la lâcheté des partis politiques, paralysés par la peur des scandales et incapables d’agir face à des situations déjà insoutenables. On préfère l’immobilisme à la prise de décision, évitant la stigmatisation en laissant prospérer des conditions dramatiques. Ainsi, gouverner ne coûte plus rien sur le plan moral ou symbolique, et c’est l’ensemble de la démocratie qui s’en trouve affaiblie, affectée par une combinaison d’irresponsabilité individuelle et de lâcheté collective.
Conclusion
La dégradation de la France ne découle pas seulement de problèmes économiques ou industriels, mais également d’un effacement moral. Une classe politique a renoncé à gouverner pour privilégier sa propre longévité, et un peuple a cessé d’exiger la vérité. Gouverner implique d’anticiper et d’assumer ses choix. Une démocratie encline à l’émotion immédiate perd non seulement sa raison, mais aussi sa mémoire. Il ne lui reste que le droit de se lamenter, sans plus aucune responsabilité. Retrouver la grandeur de la France exige du courage : celui de faire face à la réalité, de choisir la vérité plutôt que la facilité, et de réaliser que la liberté n’a jamais été acquise sans un effort considérable.