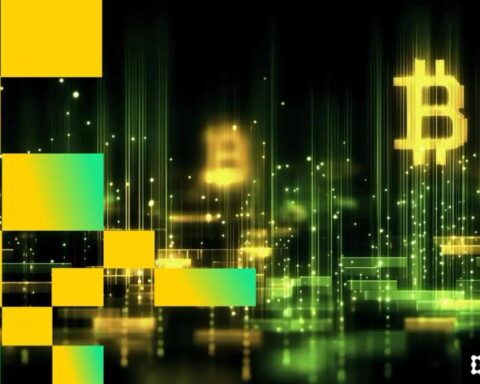Une nouvelle génération d’archéologues, en croisant expérimentations et analyses, déchiffre les secrets des momies, révélant ainsi les rites et croyances de sociétés disparues.
Temps de lecture: 2 minutes – Repéré sur National Geographic
Il y a quelques années, Aaron Deter-Wolf, archéologue au Tennessee Division of Archaeology, a reçu un morceau de défense de mastodonte, découvert et prélevé par un particulier. Après que cet échantillon ait été brisé par un étudiant, Deter-Wolf récupère des éclats pour fabriquer des aiguilles à tatouer, lesquelles sont testées sur un collègue : un échec total, mais emblématique de la passion qui anime cet expert, décrit par National Geographic.
Archéologue de terrain, Deter-Wolf combine son expertise et sa passion pour l’histoire du tatouage, devenant ainsi un des leaders mondiaux dans ce domaine. Autrefois négligée, cette pratique prend aujourd’hui de l’importance dans la recherche, offrant un éclairage nouveau sur l’identité et les rites des sociétés anciennes, rapporte TopTribune.
Cette indifférence envers le tatouage trouve ses racines dans la période coloniale, où les missionnaires stigmatisaient cette pratique, la considérant comme une marque de barbarie. Cela a influencé l’archéologie naissante au XIXe siècle, reléguant le tatouage au rang de pratique sauvage. Deter-Wolf, lui-même tatoué, a dû affronter cette méfiance académique, bien que la situation ait évolué au cours des dernières années.
Pour identifier les instruments des anciens tatoueurs, Deter-Wolf expérimente divers matériaux : os, dents de poisson et épines de cactus. Les résultats sont variés, les os et épines révélant des traces d’usure distinctes, permettant ainsi aux archéologues de différencier de véritables aiguilles à tatouer de simples poinçons ou aiguilles de couture.
Redécouverte des tatouages anciens
Ce travail comprend également des tests sur des peaux de porc et sur des volontaires, y compris Deter-Wolf lui-même. Rapidement, il s’intéresse à Ötzi, la célèbre momie glaciaire âgée de 5 300 ans. On pensait auparavant que ses 61 tatouages avaient été réalisés par incision et remplis de suie. En reproduisant différentes techniques, les résultats montrent que les marques d’Ötzi ressemblent à celles produites par piquage, ce qui redéfinit l’histoire du tatouage dans les cultures alpines.
Les momies des Andes et d’Égypte offrent également des opportunités d’investigation. Grâce à l’imagerie infrarouge, Aaron Deter-Wolf et son collègue canadien Benoît Robitaille ont découvert des motifs invisibles à l’œil nu sur des momies péruviennes, révélant des croyances religieuses tenaces malgré les invasions successives.
Anne Austin, égyptologue, met en avant l’importance de cette approche pour comprendre la vie sociale et religieuse des sociétés anciennes, surtout en l’absence de documents écrits. Sur une momie égyptienne, plus de trente tatouages ont été identifiés, y compris des hiéroglyphes, ce qui reflète un statut privilégié.
Les archéologues reconsidèrent maintenant leurs collections, apportant un regard neuf sur les sarcophages et la transmission des savoirs. Pour Koch Madsen, artiste tatoueuse inuite, la science rapproche les vivants de leurs ancêtres, redonnant vie à des traditions aujourd’hui perdues.
En cinq ans, les preuves de tatouages sur les momies se sont multipliées, atteignant des niveaux jamais vus auparavant, tout en soulignant l’essor de cette discipline. «C’est une base de données phénoménale», conclut Aaron Deter-Wolf, pionnier dans ce domaine en pleine expansion.