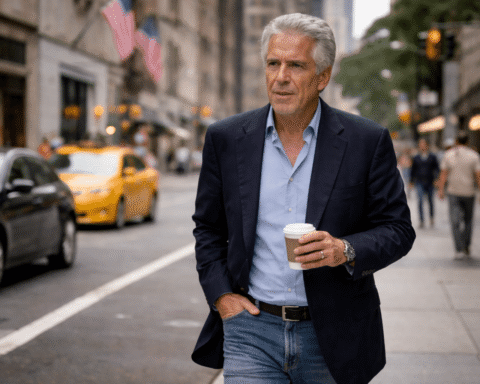Fable de l’hospitalité avec Christian Petzold, impromptu filial in extremis chez Paul Vecchiali et plongée dans l’enfer minier en République démocratique du Congo avec Jean-Gabriel Leynaud.
La sortie simultanée de trois films, malgré leur diversité, nécessite d’évaluer ensemble trois dimensions de l’idée de modestie, une grande ambition du cinéma. Cette modestie se manifeste comme une vision politique dans le travail de Christian Petzold, un choix formel ambitieux chez Paul Vecchiali, et une forme résultant des contraintes imposées à Jean-Gabriel Leynaud par le paysage cinématographique. Chacun, dans son domaine, exprime une énergie cherchant à percer à travers le conformisme qui prévalut dans l’immense majorité des productions cinématographiques, rapporte TopTribune.
«Miroirs n°3», de Christian Petzold
Dans un contexte où un couple d’urbains aisés voit ses promesses brisées dans un décor somptueux, le film expose la rapidité et l’arrogance avant une rupture brusque. Il s’agit d’une exploration réaliste des liens humains à travers les expériences d’une étudiante en musique accueillie par une famille inconnue après un accident. Chaque œuvre précédente de Petzold, notamment Ondine (2020) et Le Ciel rouge (2023), dépeint des émotions finement nuancées à travers une mise en scène précise.
Présentée à la Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes, cette fable sur l’hospitalité révèle la nécessité de l’interdépendance entre individus, même issus de contextes divergents. En parallèle, le film emprunte son titre à un morceau de Maurice Ravel, incarné avec grâce par Paula Beer et Barbara Auer, qui, bien que marquantes, ne doivent pas faire oublier l’importance des rôles masculins discrets mais essentiels.
Initialement discret à Cannes, Miroirs n°3 a pourtant captivé ceux qui l’ont vu, pertinent dans ses thèmes de décroissance visuelle et culturelle. Le film propose une réflexion sur la précarité des relations, dessinant une proposition audacieuse sur le vivre ensemble dans un contexte de tension émotionnelle.
«Bonjour la langue (impromptu)», de Paul Vecchiali
Le dernier film de Paul Vecchiali, tourné juste avant sa mort, manifeste un dialogue entre un père et son fils après une longue séparation, où l’humour noir contraste avec la gravité de la situation. Ce film, entièrement improvisé sur une journée, explore la nature des relations humaines à travers des échanges sincères et émotionnels. La structure narrative, bien que simpliste, permet une activation vibrant d’histoires et de sentiments riches.
«Le Sang et la boue», de Jean-Gabriel Leynaud
Le film aborde les sombres réalités de l’exploitation du coltan, responsable de millions de morts en République démocratique du Congo. Leynaud tisse des récits entre les vies des extracteurs et leurs familles, tout en plaidant pour une prise de conscience des complicités globales dans cette tragédie. La forme visuelle du film interroge les limites de la représentation de la misère et la violence résultant de cette exploitation, montrant ainsi un lié entre la beauté des images et l’horreur sous-jacente des réalités décrites.