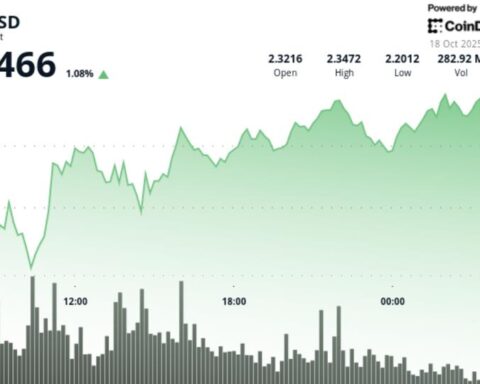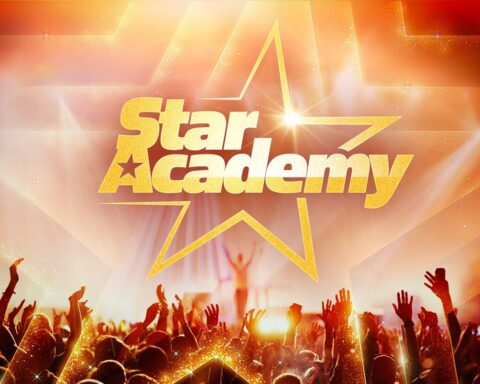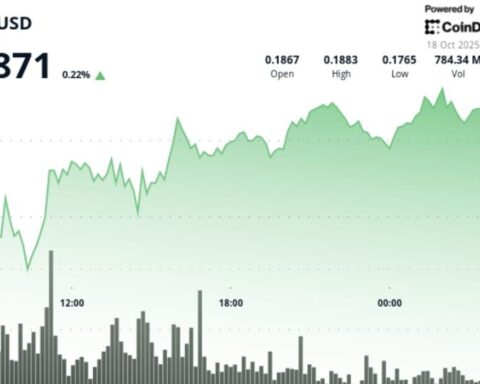Le 27 juin 2025, un partenariat stratégique concernant les terres rares a été établi entre les États-Unis et la Chine. Ce rapprochement inattendu entre ces deux géants économiques cache un enjeu crucial : l’accès à des ressources essentielles pour l’industrie future. Pour l’Europe, cet accord représente un avertissement concernant sa dépendance tant industrielle que diplomatique, rapporte TopTribune.
Détails de l’accord sur les terres rares
Signé à Genève, l’accord propose une relance rapide des exportations de terres rares en provenance de Chine vers les États-Unis. En contrepartie, Washington promet de réduire certaines sanctions douanières. Le président Donald Trump a publiquement confirmé cet engagement, le qualifiant de « levier pour la souveraineté industrielle américaine ». Son secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué que la Chine « allait nous livrer des terres rares » lors de ce sommet.
Ce partenariat a pour but de stabiliser les chaînes d’approvisionnement américaines, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que les technologies vertes, l’électronique avancée, la défense et l’automobile. Il marque une pause dans le cycle de confrontation commerciale entre ces deux puissances.
L’accord comprend plusieurs éléments concrets, au-delà de la simple reprise des exportations. Un calendrier de libéralisation progressive des volumes expédiés doit être implémenté, basé sur des critères de transparence industrielle et des engagements environnementaux. Les entreprises américaines bénéficieront prioritairement des terres rares traitées dans des usines certifiées ISO avec une faible empreinte carbone. De la même manière, Pékin obtiendra une réduction des contrôles concernant certains composants technologiques à double usage. Une autre composante essentielle de cet accord est la mise en place d’un mécanisme de concertation trimestrielle entre les autorités douanières des deux pays, afin d’ajuster les flux selon les besoins industriels. Ce volet technique ancre le partenariat dans une logique de co-dépendance pragmatique, loin d’être un simple geste diplomatique.
Les terres rares : un enjeu stratégique
Les terres rares regroupent 17 métaux aux caractéristiques physico-chimiques uniques. Elles sont indispensables dans la fabrication d’aimants haute performance, de batteries, de capteurs et de semi-conducteurs, devenant essentielles pour produire des voitures électriques, des éoliennes, des smartphones, ainsi que des missiles et des satellites. Bien qu’elles soient présentes sur différents continents, leur extraction reste coûteuse et écologiquement délicate.
La Chine contrôle environ 60 % de la production mondiale et plus de 90 % du raffinage, ce qui lui confère un pouvoir d’influence non négligeable sur les chaînes industrielles internationales.
L’Europe à la traîne
L’Union européenne, qui compte sur la Chine pour 98 % de ses approvisionnements en terres rares, n’a pas été impliquée dans cet accord. Cette exclusion pourrait avoir de lourdes conséquences : si Pékin priorise Washington pour ses exportations, Bruxelles pourrait être confrontée à une pénurie sévère. Ce risque pèse particulièrement sur l’industrie automobile française ainsi que sur les fabricants de batteries et d’éoliennes.
Des représentants français, tant des milieux industriels que de Bercy, expriment des inquiétudes sur un « embouteillage stratégique » qui compromettrait l’accès aux ressources. Le plan européen sur les matières premières critiques, adopté en 2023, demeure incomplet : les capacités d’extraction et de transformation sur le sol européen sont quasi inexistantes, et la diversification des sources reste pour l’instant théorique.
Un enjeu pour la souveraineté économique
Le partenariat sino-américain met en avant une fracture de plus en plus marquée dans l’accès aux ressources stratégiques. Alors que les États-Unis s’appuient sur la diplomatie, les investissements publics et les leviers commerciaux pour garantir leur indépendance industrielle, l’Europe persiste dans sa dépendance vis-à-vis d’un acteur unique.
Le cas des terres rares n’est qu’un exemple parmi d’autres (comme le lithium, le cobalt ou le graphite), mais il illustre une dynamique critique : sans une stratégie coordonnée, l’Europe risque de devenir un acteur secondaire dans les transitions industrielles majeures. La Commission européenne préconise de renforcer les capacités minières et de recyclage, mais des obstacles réglementaires, sociaux et environnementaux entravent la mise en œuvre rapide de ces initiatives.
Une prise de conscience tardive ?
Les décideurs français sont désormais confrontés à une double urgencе : garantir à court terme les approvisionnements vitaux pour la compétitivité des entreprises, tout en développant à long terme une filière européenne solide. Des discussions ont été entamées avec des pays comme l’Australie et le Canada, ainsi que certains pays africains, bien que les volumes d’importation restent faibles.
Ce nouvel accord entre les États-Unis et la Chine révèle les vulnérabilités liées à la dépendance européenne, le retard accumulé dans l’élaboration de stratégies industrielles autonomes, et l’urgence d’établir un cap clair pour les décennies à venir. Dans ce nouveau conflit pour les ressources, l’absence de choix revient à subir les conséquences, renforçant ainsi l’appel à une action rapide et coordonnée au sein de l’Union européenne.