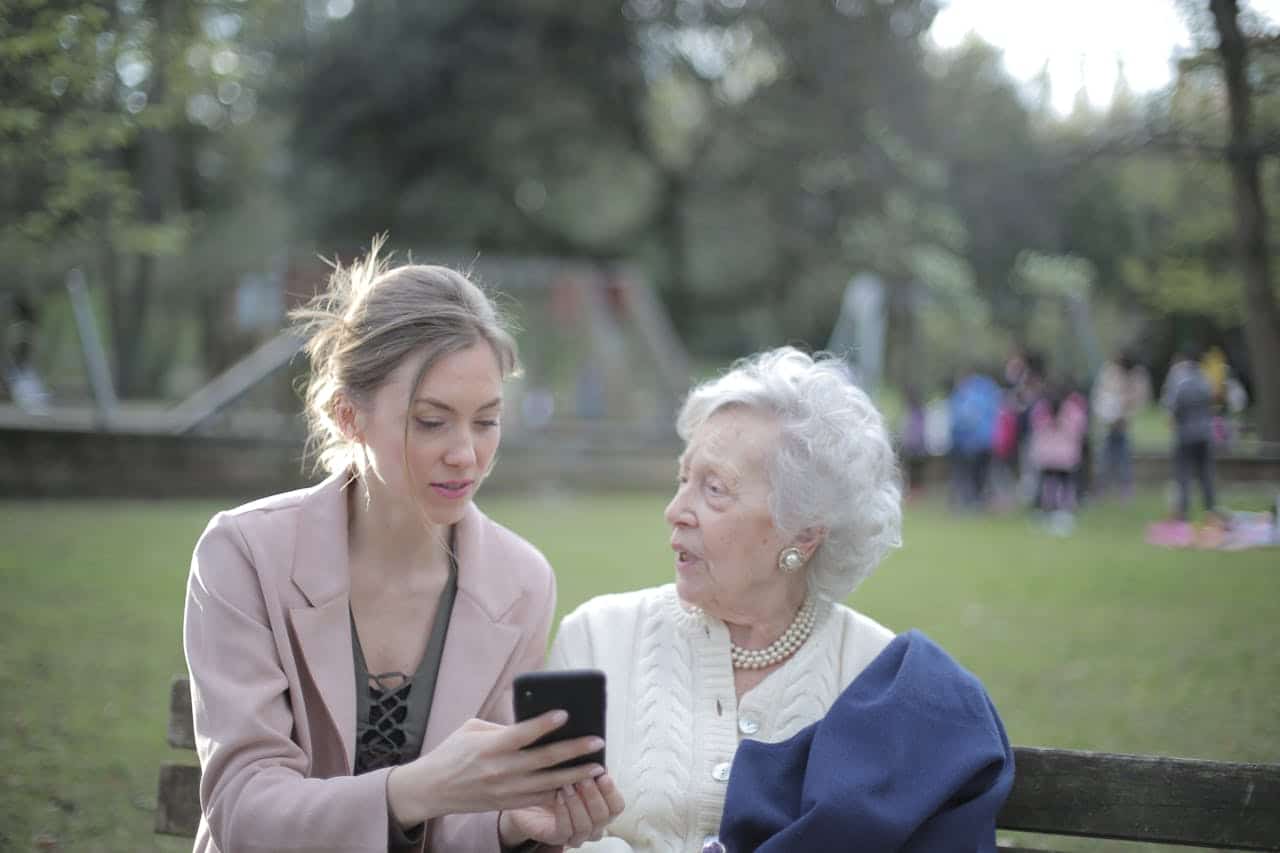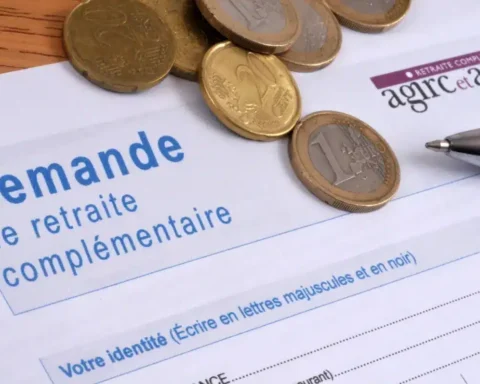Un signal d’alarme sur la confiance économique
Les résultats d’un récent sondage mettent en lumière un changement significatif dans la perception des retraites en France. En effet, environ 75 % des Français estiment que le système par répartition, qui est essentiel pour le financement social, est voué à disparaître d’ici 2050. De plus, plus de 70 % des répondants avancent qu’il « se sera détérioré » dès 2035. Cette méfiance ne se limite pas uniquement aux questions sociales : elle traduit un inquiétude croissante concernant la capacité de la France à maintenir son modèle de redistribution à long terme, rapporte TopTribune.
Ce diagnostic arrive à un moment où le système de retraite présente déjà des signes de faiblesse. Selon le Conseil d’orientation des retraites (COR), un déficit de 1,7 milliard d’euros en 2024 est prévu, représentant –0,1 % du PIB. Sans réformes structurelles, ce déséquilibre pourrait atteindre –0,2 % en 2030 et monter jusqu’à –1,4 % du PIB en 2070. Le ratio démographique, qui a chuté à 1,7 cotisant pour chaque retraité, continue de se dégrader, ce qui entraîne inéluctablement une augmentation du coût pour chaque actif. Les économistes prévoient qu’une adaptation sera inévitable, que ce soit à travers une augmentation des cotisations, un relèvement de l’âge de départ à la retraite ou une diminution des pensions.
Une équation budgétaire de plus en plus fragile
Les dépenses de retraite pour 2024 s’élèvent à 407 milliards d’euros, représentant 13,9 % du PIB, comme le rapporte le Cercle de l’épargne. Bien que les recettes (cotisations et transferts) soient similaires, elles devraient chuter à 12,8 % du PIB d’ici 2070. Une telle divergence, si elle se confirme, pourrait engendrer un manque à gagner de plus de 30 milliards d’euros par an en tenant compte de l’inflation actuelle. Par conséquent, les ajustements prévus par la réforme de 2023 — recul de l’âge légal à 64 ans et 43 annuités de cotisations — risquent de ne pas suffire pour compenser les tendances démographiques à l’œuvre.
Un autre élément déterminant est l’indexation des retraites sur l’inflation, qui vise à préserver le pouvoir d’achat des retraités. En période d’inflation, chaque point peut entraîner plus de 4 milliards d’euros de dépenses supplémentaires pour le régime de base. En 2023, le nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse a augmenté de 4,6 %, atteignant 732 000 personnes, reflétant la pression croissante sur les systèmes de solidarité. Ce dispositif, bien qu’il protège les individus les plus vulnérables, met à mal la viabilité budgétaire à moyen terme.
Le facteur générationnel : perception et rationalité économique
La défiance révélée par le sondage présente des disparités significatives selon les groupes d’âge. D’après l’Institut Montaigne, 49 % des personnes de 65 ans et plus soutiennent la réforme, tandis que seulement 28 % des 25-34 ans en voient les avantages. Les séniors perçoivent cette réforme comme un moyen de sauvegarde, alors que les jeunes actifs expriment des doutes quant à leur capacité à bénéficier d’un régime par répartition à l’avenir. Ce scepticisme est alimenté par des carrières plus irrégulières et des revenus instables, rendant difficile l’atteinte des 43 années de cotisations exigées.
Cette fracture générationnelle se traduit également sur le plan économique : les ménages âgés, possesseurs d’épargne et de biens, sont en faveur des politiques de stabilisation, tandis que les jeunes, souvent plus endettés, perçoivent la réforme des retraites comme une répercussion de la charge intergénérationnelle. Ce clivage a aussi des implications macroéconomiques, avec des données de la Drees indiquant que la pension moyenne de droit direct est de 1 666 € bruts (1 541 € nets), mais sa pérennité nécessite une croissance de la productivité d’au moins 1 % par an, un objectif que la France n’a pas réussi à atteindre depuis plus d’une décennie.
Une réforme structurelle aux effets politiques et financiers durables
La réforme des retraites de 2023, qui est actuellement en cours de mise en œuvre, met en lumière le dilemme entre les nécessités budgétaires et l’acceptation sociale. Concernant l’ensemble des actifs nés après 1961, cela concerne près de 28 millions de personnes. Pour le gouvernement, cette réforme est cruciale pour assurer la viabilité du système, bien que l’on puisse remettre en question son efficacité. Le COR anticipe un retour à l’équilibre aux alentours de 2035-2037 dans les meilleures projections, tandis qu’un déficit pourrait se prolonger jusqu’à 2050 dans le scénario le plus pessimiste.
Au-delà de l’impact social direct, les répercussions économiques sont significatives. Le financement des retraites représente actuellement environ 60 % des prélèvements sociaux en France. Ainsi, tout déséquilibre durable influence directement la dette publique, qui est estimée à 110,6 % du PIB en 2025. Pour les investisseurs, la soutenabilité du système français constitue un indicateur clé de confiance souveraine : la perception d’un modèle en exhaustion n’est plus simplement une question sociale, elle se transforme en un enjeu économique et structurel.