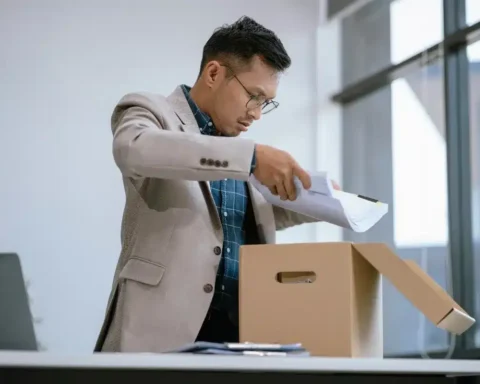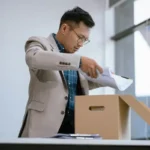Dans une démarche visant à optimiser le budget 2026, François Bayrou et sa ministre du Travail prévoient de diminuer les coûts liés à un dispositif qui permet aux salariés de bénéficier des allocations chômage, souvent critiqué pour favoriser des démissions ou des licenciements déguisés, rapporte TopTribune.
1 Quel est le cadre actuel de la rupture conventionnelle ?
Établi en 2008, ce mécanisme visait à offrir plus de flexibilité sur le marché du travail, servant d’alternative aux licenciements et aux démissions par une rupture à l’amiable. Ce système avait pour objectif de minimiser les risques pour l’employeur, qui évite des conflits juridiques, tout en permettant au salarié de conserver ses droits à l’assurance-chômage, contrairement à ce qui se passe après une démission.
Pour bénéficier de cette procédure, le salarié doit être en contrat à durée indéterminée (CDI). Le processus comprend au moins un entretien préalable, suivi de la rédaction d’une convention spécifiant les modalités de rupture, incluant la date et le montant de l’indemnité de rupture. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle légale prévue pour un licenciement. Après la signature, les parties disposent d’un droit de rétractation de quinze jours, et la convention doit ensuite être homologuée par les autorités compétentes. Il est important de noter que cette démarche ne peut être imposée par un des partis, garantissant ainsi le respect du consentement mutuel.
2 Quels changements pourraient découler de la réforme ?
Dans le cadre de la révision de l’assurance-chômage, le gouvernement vise des économies publiques estimées entre 2 et 4 milliards d’euros sur le long terme, notamment pour la période 2026-2029. Astrid Panosyan-Bouvet a évoqué une réévaluation des conditions d’admissibilité et de la durée d’indemnisation pour tous les demandeurs d’emploi, tout en se concentrant sur les modalités d’indemnisation des ruptures conventionnelles.
Une des pistes envisagées serait d’allonger le délai de carence, c’est-à-dire le laps de temps entre la rupture du contrat et le début des versements d’allocations chômage. Ce délai, qui varie en fonction du montant des indemnités de rupture perçues par le salarié, pourrait aller de quelques jours à plusieurs mois. Un allongement de ce délai pourrait rendre moins attrayant ce dispositif, tout en réduisant son coût pour l’État. « La carence est une option parmi d’autres » , a expliqué la ministre lors d’un entretien.
3 Comment le gouvernement soutient-il son projet ?
Suite aux déclarations budgétaires de François Bayrou, Astrid Panosyan-Bouvet a souligné qu’il était « objectivement constaté de nombreux abus » dans le recours aux ruptures conventionnelles, tant du côté des employés que des entreprises, insinuant que cette pratique pourrait servir à masquer des démissions ou des licenciements.
Le gouvernement s’appuie sur une étude de la Dares, l’agence de statistiques du ministère du Travail, de 2018, indiquant que la majorité des ruptures conventionnelles avaient remplacé des démissions (environ 75 % de 2012 à 2017) et dans une moindre mesure, des licenciements économiques (entre 10 et 20 %). Seuls 5 à 15 % des départs pourraient ne pas s’être produits sans ce dispositif.
Un autre rapport publié par des économistes en 2019 affirme que l’apparition de ruptures conventionnelles entraînerait une hausse des licenciements, soulignant qu’elles s’ajoutent aux départs plutôt que de les remplacer.
Dans son interview, la ministre du Travail a également noté que certaines personnes utiliseraient les allocations chômage comme un « revenu de confort », en particulier des travailleurs hautement qualifiés qui ne se précipitent pas à reprendre une activité. Elle a proposé aux partenaires sociaux de « réajuster le système » afin de revenir à son objectif initial d’« un filet de sécurité ».
4 Quel est le coût du dispositif chaque année ?
Pour l’année 2024, près de 515 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été enregistrées, contre 315 000 en 2015, montrant ainsi une augmentation de l’utilisation de ce dispositif, bien que les chiffres se soient stabilisés depuis 2022. La démarche reste moins courante que les démissions (1,85 million en 2024) et les licenciements (583 000).
En 2022, le montant des allocations versées aux bénéficiaires d’une rupture conventionnelle s’élevait à 9 milliards d’euros, représentant environ 28 % des allocations totales, bien que seulement 25 % des allocataires en bénéficient. Ce phénomène s’explique par le fait que ces bénéficiaires ont des salaires plus élevés que la moyenne, entraînant des indemnités également plus élevées.
5 Quelles sont les réactions des syndicats et organisations patronales ?
Après que la ministre du Travail a tenté d’engager un dialogue avec les syndicats sur la réforme de l’assurance-chômage, seules la CFDT et la CFTC ont répondu présent. Marylise Léon, présidente de la CFDT, a qualifié ces propositions de « carnage total pour les demandeurs d’emploi », tandis que Denis Gravouil, de la CGT, a qualifié ce projet d’« absolument inacceptable ». Ils ont tous deux exprimé leur désaccord face à toute volonté de renforcer les conditions liées aux ruptures conventionnelles, arguant que ces dernières sont souvent considérées comme des licenciements déguisés.
D’un autre côté, certains représentants du patronat conviennent que, bien que les ruptures conventionnelles aient procuré un certain apaisement, elles pourraient aussi conduire à des abus. Jean-Eudes Tesson, président de l’Unédic, a noté que ces ruptures pourraient remplacer des démissions, entraînant des coûts supplémentaires pour les employeurs et pour le système d’assurance-chômage. Les petites entreprises, selon Eric Chevée, vice-président de la CPME, ressentent par ailleurs que certains employés pourraient en profiter indûment.