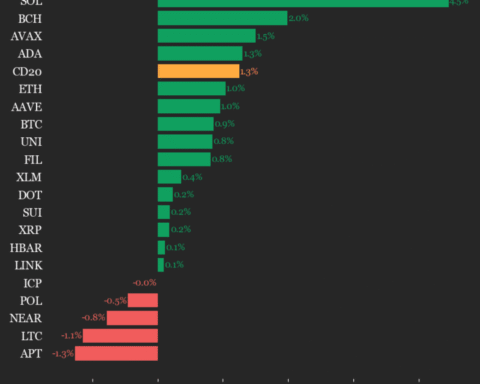Ce texte, en chantier depuis un an, est présenté comme une réponse à la colère des agriculteurs. La gauche et des associations s’inquiètent de reculs dans la protection de l’environnement, au nom de la simplification.
Tout a été fait pour qu’elle voie le jour avant l’ouverture du Salon de l’agriculture. (Nouvelle fenêtre) va être définitivement adoptée, jeudi 20 février, après un vote du Sénat prévu dans l’après-midi, dont l’issue ne fait pas de doutes. Le texte, issu d’un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire mardi soir, a déjà été largement approuvé à l’Assemblée nationale mercredi. Cette loi, à l’adoption retardée par la dissolution puis la censure du gouvernement Barnier, est présentée comme une réponse à la colère de nombreux agriculteurs, sur le devant de la scène depuis les manifestations du début de l’année 2024. Mais elle est également très critiquée par la gauche et de nombreuses associations de défense de l’environnement, qui s’alarment d’un certain nombre de reculs et de renoncements. On vous résume ce que contient le texte.
L’agriculture élevée au rang d' »intérêt général majeur »
Comme l’exigeait le premier syndicat agricole, la FNSEA, l’une des mesures phares de ce projet de loi consacre « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture » au rang d’« intérêt général majeur ». Objectif : nourrir la réflexion du juge administratif et faciliter le parcours de projets de structures comme les retenues d’eau ou les bâtiments d’élevage hors-sol, lorsqu’ils sont mis en balance avec un objectif de préservation de l’environnement.
Des élus et des juristes doutent de la portée du dispositif, la protection de l’environnement ayant une valeur constitutionnelle, alors que cet « intérêt général majeur » est inscrit dans une loi simple. Pour tenter d’y remédier, un principe décrié de « non-régression de la souveraineté alimentaire », sorte de miroir de la non-régression environnementale déjà consacrée dans la loi, a également été introduit dans le texte à l’initiative des sénateurs.
Le texte accorde aussi une présomption d’urgence en cas de contentieux autour de la construction d’une réserve d’eau pour l’irrigation, là encore dans l’objectif de réduire les délais des procédures. Elle concernera aussi des projets de bâtiments d’élevage, dont les permis de construire font régulièrement l’objet de recours d’associations de défense de la nature.
Greenpeace, qui juge ce projet de loi « dangereux », pointe notamment ces mesures. « Derrière ces formulations juridiques floues se cache une intention politique très claire de la part du gouvernement et d’une partie des syndicats agricoles : contourner certaines législations environnementales afin de favoriser des projets à fort impact environnemental, comme les mégabassines ou les installations classées pour la protection de l’environnement en élevage », s’inquiète l’ONG.
Pas d’agroécologie, ni d’interdiction de pesticide « sans solution »
La version initiale du projet de loi contenait des objectifs en matière de développement de l’agroécologie, c’est-à-dire de méthodes de production plus respectueuses de l’environnement. Mais la loi n’en fait plus mention dans sa mouture finale, à la demande du Sénat. Egalement supprimé par les sénateurs, l’objectif de consacrer 21% de la surface agricole française au bio en 2030 a, en revanche, été réintroduit dans le texte.
Par ailleurs, le principe « pas d’interdiction sans solution », mantra de la FNSEA sur les pesticides, trouve aussi sa traduction législative parmi les politiques agricoles dont le pays entend se doter. La loi invite ainsi le gouvernement à « s’abstenir d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne » en l’absence d’alternatives viables. Une mesure qui a fait bondir les associations de défense de l’environnement. « En remettant les pesticides sur un piédestal, les élus ont donc choisi de sacrifier la santé des sols, mais aussi celle des paysans et des citoyens », a fustigé la Fondation pour la nature et l’homme dans une tribune publiée sur franceinfo.
Des installations et des transmissions facilitées
Le projet de loi entend donner un cadre d’action au monde agricole pour relever un défi majeur : attirer des bras pour compenser les départs massifs à la retraite attendus dans les dix ans à venir. A ce stade, le texte fixe l’objectif de « 400 000 exploitations agricoles » en France en 2035, et 500 000 paysans travaillant sur ces exploitations.
Le projet de loi crée ainsi un guichet unique départemental – France services agriculture – pour accompagner toute personne voulant s’installer en agriculture ou tout agriculteur souhaitant céder son exploitation. Un nouveau diplôme de niveau bac +3 sera également créé, baptisé Bachelor agro.
Le texte prévoit par ailleurs un « diagnostic modulaire de l’exploitation agricole », censé aider les jeunes agriculteurs qui le demandent dans leur projet de reprise d’une ferme, en leur fournissant des informations sur « la viabilité économique, environnementale et sociale » de celle-ci. Enfin, le Sénat a incité le gouvernement à créer en 2026 une « aide au passage de relais » pour les agriculteurs en fin de carrière qui mettent leurs terres à disposition de repreneurs.
Une gestion des haies simplifiée
Loin d’être anecdotique, le statut des haies a très souvent été pointé du doigt par les agriculteurs, lors des manifestations de 2024, pour sa complexité et les injonctions contradictoires qu’il entraîne. Ce statut est désormais unifié, avec des contraintes levées pour leur destruction, soumise à une simple « déclaration unique préalable » qui vaut autorisation sans réponse contraire de l’administration dans un délai maximal de quatre mois.
Une dépénalisation de certaines infractions à l’environnement
Un article très clivant, nettement étendu à l’initiative du Sénat, révise l’échelle des peines en cas d’atteintes à l’environnement. Cette mesure dépénalise très largement ces infractions lorsqu’elles ne sont pas commises « de manière intentionnelle », au profit d’une simple amende administrative de 450 euros maximum ou du suivi d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement.
La gauche y voit une inversion de la charge de la preuve, voire un « permis de détruire l’environnement », qui de surcroît ne concernerait pas uniquement les agriculteurs. Pour un collectif d’ONG, comprenant notamment la Ligue pour la protection des oiseaux, France nature environnement ou encore WWF, le texte « introduit des dérogations massives aux réglementations environnementales en vigueur, au détriment des avancées écologiques indispensables à la transition agricole. »
Les parlementaires ont également fait un pas vers un « droit à l’erreur » administrative des agriculteurs, en approuvant le fait que « la bonne foi » d’un exploitant « est présumée » lors d’un contrôle.