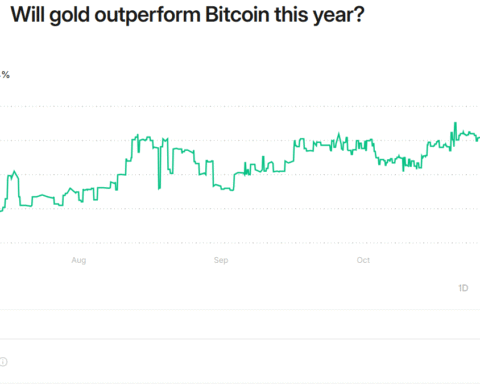Au passé, au présent ou au futur, les films de Johan Grimonprez, Jafar Panahi, Neo Sora et Zhanna Ozirna explorent les multiples manières de faire du cinéma à partir des grands enjeux contemporains.
Temps de lecture: 10 minutes
Le 1er octobre, plusieurs films uniques ont été dévoilés, allant de la Palme d’Or iranienne à des récits radicaux mêlant archives de la décolonisation et l’histoire du jazz, en passant par une dystopie japonaise inspirée des films pour adolescents et l’intense représentation de la violence de l’agression russe en Ukraine, rapporte TopTribune.
Ces films, bien que très divers, partagent une caractéristique: l’importance cruciale de leur bande-son. Que ce soit le bruit qui engage le film de Jafar Panahi (Un simple accident), la musique coécrite dans le film de Johan Grimonprez (Soundtrack to a Coup d’Etat), ou encore la techno rebelle de Neo Sora, tous ces éléments participent intégralement à la narration, y compris les sons de guerre chez Zhanna Ozirna (Honeymoon).
Ainsi, bien que ces œuvres cinématographiques soient disparates, elles illustrent collectivement la manière dont le cinéma peut aborder des enjeux politiques. Fiction et documentaire cohabitent, permettant de sublimer et d’interroger la réalité déployée et mise en scène.
«Soundtrack to a Coup d’Etat», de Johan Grimonprez
Avec une intensité violente et splendide, la batterie de Max Roach et la voix d’Abbey Lincoln manifestent une révolte percutante, se faisant l’écho d’événements historiques marquants de 1960. Ce film remémore comment le Congo belge devait retrouver son indépendance sous Patrice Lumumba face à cinq décennies d’oppression coloniale.
À l’échelle mondiale, 1960 représente un tournant, alors que les puissances coloniales tentent de maintenir leur domination face à la montée des voix en faveur de l’autodétermination. Grimonprez juxtapose des archives visuelles des événements à l’ONU avec les luttes artistiques, entrelacées avec des sons emblématiques du jazz, tout en rendant hommage à l’indépendance congolaises et aux luttes pour la liberté au cours des décennies passées.
Le film de Grimonprez, vibrant d’énergie et d’historicité, questionne les récits établis autour de la mémoire, de l’identité et du pouvoir au sein des discours globaux contemporains, tout en révélant les résonances d’une époque qui continuent à hanter l’actualité.
«Un simple accident», de Jafar Panahi
Depuis son apparition au Festival de Cannes, Un simple accident de Jafar Panahi a remporté un grand succès, devenant même le représentant français aux Oscars. Ce film aborde la reconfrontation d’un homme avec son ancien tortionnaire et explore les réalités douloureuses d’une société marquée par la répression politique et la torture.
Aujourd’hui, cette œuvre résonne avec force, alors que le réalisateur, emprisonné pour ses convictions, réalise la portée émotionnelle de son récit, qui explore les complexités morales du pardon et de la vengeance. Le film se permet également d’être un véritable miroir de l’expérience traumatique traversée par son créateur et ses compagnons de détention.
Cette œuvre est bien plus qu’un récit sur les victimes de la répression ; elle aborde le découragement et la lutte au quotidien des personnes encore emprisonnées, et l’impact durable de ces expériences sur la société dans son ensemble.
«Happyend», de Neo Sora
Le film du réalisateur japonais Neo Sora mêle dystopie politique et récit d’adolescence, alors qu’une catastrophe naturelle menace l’archipel japonais. Au milieu de cette tension, les personnages principaux, Yuta et Kou, naviguent des réalités sociales, tout en démontrant comment la musique et la culture peuvent également servir de moyens de résistance face à l’autoritarisme.
Les dialogues subtils et enrichis présentent leurs luttes internes ainsi que leur cheminement vers l’engagement politique, tout en mettant en lumière la coexistence de différents milieux sociaux. Happyend parvient à capter l’imaginaire à travers une mise en scène inventée et engageante, illustrant les complexités des choix individuels face aux pressions collectives.
«Honeymoon», de Zhanna Ozirna
Dans l’intimité d’un appartement à Kiev, Honeymoon dévoile la vie quotidienne perturbée par l’invasion russe. À travers les yeux d’Olya et Taras, le film décrit la nouvelle normalité des Ukrainiens confrontés à l’imminence de la guerre. En naviguant entre espoir et désespoir, les protagonistes cherchent des moyens de survivre dans une réalité dévastée.
Ce premier long-métrage de Zhanna Ozirna marque une approche audacieuse fondée sur des éléments autobiographiques, interrogeant simultanément l’identité collective et la réponse individuelle à l’horreur. La mise en scène habile fait écho aux luttes humaines, démontrant la résilience face à une adversité extrême.