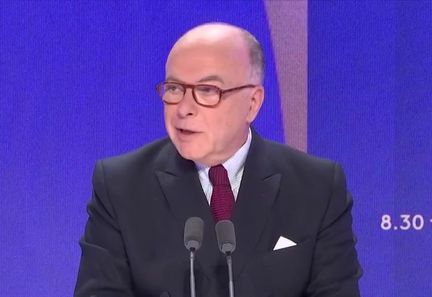Le droit de propriété est un des droits fondamentaux déclaré dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à travers l’article 17. Ce dernier stipule : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé… si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. », rapporte TopTribune.
Cependant, un certain nombre d’impôts appliqués en France semblent contredire ce principe. Quand ces taxes deviennent confiscatoires, elles échappent à la notion de contribution équitable à la charge publique, et se manifestent plutôt comme une forme de dépossession partielle et arbitraire.
I. La fiscalité confiscatoire : une atteinte au droit de propriété et aux droits de l’homme
L’exemple de la fiscalité patrimoniale illustre clairement ce problème. L’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), succédé par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), ne vise pas à taxer un revenu ou une plus-value, mais pénalise directement l’existence d’un patrimoine, qui a déjà été soumis à imposition par le passé. Le message implicite est clair : « Ceux qui en ont suffisamment devraient contribuer davantage. »
De plus, lorsque les taux marginaux de l’impôt sur le revenu deviennent excessifs, ou lorsque les droits de succession dépassent les 20 % d’un héritage (en France, le taux atteint 30 % à partir de 500 000 €, montant pouvant aller jusqu’à 45 %), nous ne sommes plus dans une logique d’équité contributive, mais dans celle de la confiscation. Sur quelle base l’État se permet-il de considérer qu’une transmission familiale doit être réduite de moitié ?
Ce type de prélèvement ne se légitime d’aucune façon par des considérations morales ; il équivaut à une spoliation légale. Il vulnérabilise le droit de jouir de ses biens librement, un droit qui devrait rester inviolable. De ce fait, ce principe constitue bel et bien une atteinte à l’ensemble des droits de l’homme.
II. Une fiscalité idéologique, démagogique et inefficace
1. Une idéologie de nivellement
Les partisans d’une fiscalité lourde revendiquent souvent la justice sociale. Pourtant, l’argumentation repose sur une idéologie plus que sur une logique rationnelle : il semble inacceptable d’accepter des disparités de richesse. Le système fiscal devient dès lors un outil de nivellement et de répression. Le but est que chaque jeune commence son existence avec le même niveau de patrimoine.
Ce discours s’accompagne également d’une approche démagogique : séduire la jalousie sociale en proposant de multiples aides représente une stratégie efficace pour capter les voix des électeurs. Comme le dit le proverbe, « tout le monde est d’accord pour partager l’argent des autres ». La démocratie peut parfois se révéler corrompue.
2. Une inefficacité économique avérée
Il apparaît clairement que cette approche nuit à l’efficacité économique. Alors que l’État cherche continuellement des ressources, il consomme de manière inefficace, tandis que le capital privé, plus judicieusement géré, contribue à la création de valeur et d’emplois. L’administration publique semble avaler tout sur son passage.
La « courbe de Laffer » illustre bien ce paradoxe : au-delà d’un seuil considérablement élevé (approximativement entre 60 et 70 % des revenus), toute augmentation des impôts engendre une diminution de l’assiette taxable et donc des revenus fiscaux. Les données relatives à l’ISF en France ont démontré un rendement budgétaire faible, mais des pertes significatives dues à l’exil fiscal et à la dissuasion à investir.
L’OCDE a même mis en avant que les impôts sur le capital et les hauts revenus sont parmi les plus dommageables pour la croissance, car ils freinent l’investissement et l’innovation. À l’inverse, les pays qui ont allégé leur fiscalité concernant les hauts revenus et la transmission de patrimoine (comme divers pays nordiques) n’ont pas observé l’effondrement de leurs finances publiques, mais plutôt une stabilisation de leur base fiscale.
3. Un déséquilibre démocratique
Au-delà des considérations économiques, la question est également d’ordre moral. Quand une majorité impose à une minorité le poids prépondérant de l’effort fiscal, il s’agit d’une forme manifeste de « tyrannie de la majorité », comme le soulignait Tocqueville. Ce système sappe le consentement à l’impôt, qui est la pierre angulaire même du contrat démocratique.
En France, 10 % des ménages fiscaux rémunèrent 75 % de l’impôt sur le revenu (DGFiP, 2022–2023). Les 2 % les plus riches contribuent à hauteur d’environ 40 %, tandis que le 0,1 % des classes les plus aisées à lui seul apporte 13 % du total (iFRAP, 2023). Or, ces mêmes catégories sociales assurent également le financement de l’économie par le biais de l’épargne, de l’investissement et de l’emploi.
Les surtaxes appliquées au-delà d’un certain seuil risquent d’affaiblir le moteur même de la prospérité nationale. En réalité, cela revient à appauvrir l’ensemble de la population au nom d’une fausse égalité. Inévitablement, ce sont les talents qui génèrent la richesse qui, en fin de compte, permettent à l’État de prospérer. Les cibler constitue un acte contraire à l’intérêt collectif.
Conclusion
Une fiscalité confiscatoire ne se limite pas à être injuste ; elle est également moralement inacceptable et économiquement destructrice. Elle menace le droit de propriété, instille la méfiance, favorise l’exil et contribue à l’appauvrissement du pays.
Le droit de propriété ne représente pas un privilège, mais un droit fondamental. L’ignorer au nom de la démagogie fiscale constitue un risque qui pourrait porter atteinte aux fondements même de notre démocratie et de nos libertés.
Bibliographie / Sources
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), art. 17.
- Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950), Protocole n°1, art. 1.
- Tocqueville, A. de (1835), De la démocratie en Amérique.
- DGFiP, L’impôt sur le revenu en 2022 (2024).
- DGFiP, Statistiques IR 2023 (2025).
- Fondation iFRAP (2023), 75 % de l’IR payé par 10 % des ménages; 0,1 % les plus hauts revenus paient 13 % de l’IR.
- OCDE (2008), Taxation and Economic Growth.
- OCDE (2023), Revenue Statistics.
- Courbe de Laffer : analyse macroéconomique (cf. OCDE, 2022).
- Cour européenne des droits de l’homme, Sporrong et Lönnroth c. Suède (1982).