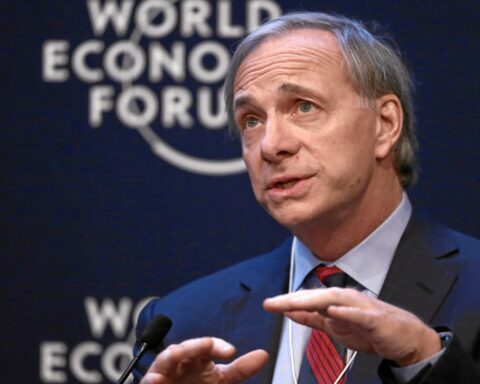La proposition de loi élaborée par les sénateurs Duplomb et Menonville concernant le secteur agricole a franchi un cap crucial ce lundi 30 juin 2025. Cette mesure, critiquée par les formations de gauche en raison de sa disposition autorisant la réintroduction d’un pesticide interdit, a fait l’objet d’un accord entre députés et sénateurs, ouvrant la voie à son adoption finale, rapporte TopTribune.
Lors d’une réunion à huis clos, les sept députés et sept sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP) au Sénat ont réussi à parvenir à un compromis sur ce projet de loi, qui vise principalement à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Cette proposition reste cependant en tant que telle un sujet de débats et de divergences.
Un néonicotinoïde réintroduit
Le point le plus controversé de ce texte demeure sans conteste la réintroduction, bien que de manière dérogatoire et sous des conditions strictes, de l’acétamipride. Ce pesticide, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, était proscrit en France depuis 2018.
Les inquiétudes autour de ses effets sur la santé humaine persistent, malgré un manque de données concluantes. Bien qu’il soit encore autorisé dans certaines régions d’Europe, des producteurs, notamment ceux de betteraves et de noisettes, demandent sa réintroduction, affirmant ne disposer d’aucune alternative viable pour lutter contre les ravageurs. En revanche, du côté des apiculteurs, on exprime de vives inquiétudes en qualifiant ce pesticide de « tueur d’abeilles ».
La CMP a décidé de maintenir cette législation, tout en y apportant des ajustements, tels qu’une « clause de revoyure » prévue après trois années de réintroduction, ainsi que l’interdiction de cultiver des plantes attirant les pollinisateurs sur les zones déjà traitées.
Faciliter le stockage de l’eau
Parallèlement, l’objectif de ce texte est également de simplifier les procédures de stockage de l’eau pour l’irrigation agricole face à la problématique de pénurie engendrée par le changement climatique. Toutefois, certaines associations ont exprimé des préoccupations au sujet de l’implantation de mégabassines, qui pourraient monopoliser les ressources en eau au bénéfice de l’agriculture intensive.
Un des articles principaux confère une présomption d’intérêt général majeur pour les infrastructures de stockage d’eau, tout en réservant des procédures simplifiées pour l’obtention des autorisations nécessaires. En revanche, une mesure jugée polémique relative à la définition des « zones humides » a finalement été retirée.
Faciliter l’élevage intensif
Concernant les bâtiments d’élevage intensif, le texte prévoit d’assouplir les normes pour la création ou l’agrandissement de ces installations. Selon les seuils établis, certains élevages sont catégorisés comme installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sont tenus d’obtenir des autorisations en fonction de la taille de leur cheptel.
Certaines filières souhaitent que ces seuils soient modifiés pour permettre une flexibilité accrue. Par exemple, un poulailler ne devrait plus nécessiter d’autorisation pour moins de 85 000 poules, contre 40 000 précédemment. Une porcherie pourrait passer d’une limite de 2 000 à 3 000 cochons. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure ne serait effective qu’à partir de fin 2026, une échéance jugée trop lointaine par certains syndicats qui désirent une application immédiate.
Rétropédalage sur l’Anses
Le projet issu du Sénat offrait au gouvernement la possibilité d’introduire des « priorités » au sein des travaux de l’Anses, l’agence nationale chargée d’évaluer les risques associés aux pesticides. Cette mesure a suscité de vives réactions, tant du côté des élus de gauche que des scientifiques, qui ont dénoncé un potentiel atteinte à l’indépendance de cette agence.
En CMP, un compromis a finalement été établi, écartant les dispositions les plus controversées, tout en stipulant que l’agence devra tenir compte des facteurs « agronomiques, phytosanitaires et environnementaux » lors de ses évaluations.
Il est également précisé que les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), mandaté pour surveiller la protection de l’environnement, agiront sous l’autorité des préfets, ce qui soulève encore certaines interrogations.
C’est quoi la suite ?
Portée par Laurent Duplomb (Les Républicains) et Franck Menonville (UDI, centre), ce projet de loi est sur le point d’être adopté. Un dernier vote est prévu mercredi au Sénat, suivi d’un autre à l’Assemblée nationale le mardi 8 juillet.
Bien que le soutien du Sénat, majoritairement à droite, soit relativement certain, l’issue au sein de l’Assemblée pourrait être plus délicate. Néanmoins, une majorité semble se dessiner, incluant les voix du Rassemblement national, des Républicains et d’une grande partie du bloc central macroniste, ce qui pourrait conforter une cette adoption, vivement attendue par la FNSEA, principal syndicat agricole.
Avec AFP.
Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.