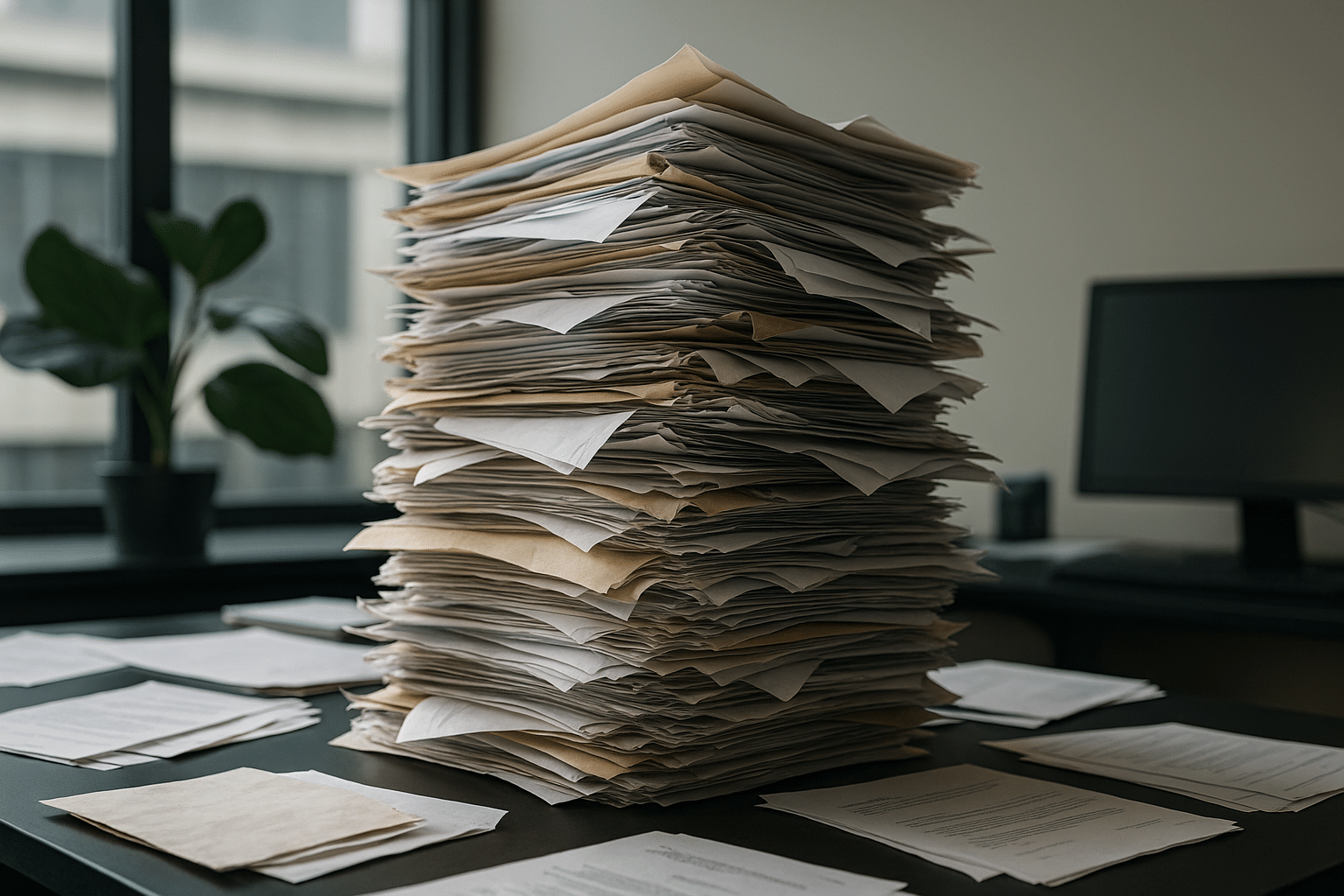Une économie ne s’effondre pas subitement ; elle se dégrade progressivement. C’est exactement ce qui se passe en France. Chaque année, sous le mandat de chaque gouvernement, les ministres des Finances introduisent une nouvelle « réforme », un « ajustement » ou une « simplification » qui, sous prétexte de modernisation, ne fait qu’alourdir le millefeuille fiscal et réglementaire. Les conséquences sont visibles : une paralysie du pays, une économie démoralisée, une fuite des capitaux productifs et une classe politique qui feint d’être surprise par les résultats, rapporte TopTribune.
Une fiscalité devenue une roulette russe
Les entrepreneurs n’ont plus la capacité d’investir, de créer, de transmettre ou même de planifier une activité sans appréhender le changement prochain. Aujourd’hui, c’est la taxe sur les holdings ; demain, une hausse de la flat tax ; après-demain, une nouvelle « contribution exceptionnelle » qui, à l’image des précédentes, finira par s’installer durablement. Ainsi, le chef d’entreprise français vit dans la crainte permanente du fisc. Ce n’est pas tant la concurrence qui l’inquiète, mais plutôt l’Administration fiscale. La fiscalité française s’apparente à un piège instable. Elle ne favorise ni l’initiative, ni la croissance ; au contraire, elle valorise l’immobilisme et la prudence, tout en pénalisant la créativité. Quand on interroge les responsables politiques à ce sujet, ils répondent avec une arrogance technocratique insupportable qu’il est nécessaire de « faire contribuer ceux qui ont profité du système », comme si la création de valeur était une faute morale. De ce fait, l’entrepreneur n’est plus un acteur économique, mais plutôt un suspect constant.
Une overdose normative, symptomatique du contrôle
À cette instabilité fiscale s’ajoute une dérive normatique. Un déluge de lois, décrets, arrêtés et circulaires submerge les entreprises. Chaque année, des milliers de nouvelles obligations viennent alourdir le quotidien économique. Les entrepreneurs doivent déclarer, certifier, justifier, vérifier et se plier à des normes souvent contradictoires, parfois absurdes. Le coût de cette surenchère administrative est colossal, atteignant jusqu’à 100 milliards d’euros par an selon les estimations du Sénat. Mais au-delà du coût financier, c’est la culture de la méfiance qui est la plus inquiétante. L’État français n’a pas confiance : il veut tout encadrer, tout réglementer, tout surveiller. Chaque entrepreneur est vu comme un potentiel fraudeur ; chaque investisseur, un « profiteur » ; chaque innovation est perçue comme un risque à contrôler. Ce pays est devenu allergique à la liberté économique. L’ironie réside dans la schizophrénie des dirigeants : ils se lamentent face à la désindustrialisation et à la fuite des talents, tout en continuant à empiler les normes et à multiplier les taxes. Ils affirment vouloir « simplifier », mais chaque réforme ajoute des pages au Code général des impôts. Ils parlent d’« attractivité » tout en modifiant les règles du jeu tous les six mois. À ce rythme, même les entrepreneurs les plus audacieux finissent par renoncer. Et il est surprenant qu’on s’étonne ensuite de la fuite des capitaux, des cerveaux et des projets à l’étranger.
L’instabilité comme philosophie de gouvernance
Cette agitation n’est pas le fruit du hasard, mais un système de gouvernance. En France, gouverner signifie montrer qu’on agit, même dans le désordre. Chaque majorité souhaite sa « réforme emblématique », chaque ministre désire laisser sa marque dans le Journal officiel. Peu importe si cela obscurcit la visibilité pour les entreprises : l’essentiel est le message politique, la posture morale. Cela détruit la confiance, le moteur fondamental de l’économie. Lorsque les règles changent constamment, les investisseurs se retirent, les entrepreneurs font de leur mieux pour s’adapter, et les créateurs se taisent. Lorsque seuls des gestionnaires inquiets restent, il n’y a plus ni croissance, ni emplois, ni vitalité. Cette instabilité continue est également le reflet d’une défaillance politique plus profonde. Nos dirigeants ont abandonné la cohérence au profit de la réaction. Agir est devenu une fin en soi. Les réformes ne visent plus à améliorer la situation, mais à communiquer. Le véritable courage politique serait de ne rien changer pendant une décennie, d’offrir un cadre fiscal stable, de restaurer la confiance. Toutefois, cela exige de surmonter la tentation de satisfaire chaque crise médiatique. Or, notre classe politique a perdu cette capacité.
Une économie marquée par la peur
Le résultat est palpable : une économie tendue, où l’énergie créative se transforme en timidité. Les entrepreneurs ne rêvent plus, ils se protègent. Les investisseurs ne planifient plus, ils attendent avec angoisse la prochaine déclaration ministérielle, le prochain article du projet de loi de finances, ou le prochain « ajustement technique » qui engendre des millions d’euros de coûts. Cette peur structurelle est la taxe la plus délétère : elle est invisible, mais elle asphyxie tout. Ce pays, historiquement producteur de générations d’ingénieurs, d’artisans, de bâtisseurs et d’entrepreneurs, en vient à produire des formulaires. L’énergie qui devrait alimenter la croissance est détournée vers des démarches administratives. On a troqué la liberté contre la procédure, l’esprit d’entreprise contre l’esprit de conformité. C’est là le véritable déclin français.
Le retour au bon sens
Il est grand temps de mettre un terme à cette fuite en avant. Il est essentiel de rappeler une vérité simple : la stabilité n’est pas synonyme d’immobilisme, mais plutôt la condition sine qua non de la confiance. Et la confiance est le carburant indispensable à l’économie. Tant que nous continuerons à gouverner par réflexe, à légiférer sous l’émotion, à taxer par impulsion idéologique, nous condamnerons notre pays à la stagnation. La France n’a pas besoin d’une énième réforme fiscale, mais plutôt d’un moratoire sur l’hyper-législation. Elle nécessite du souffle, de la clarté, de la régularité. Et surtout, elle a besoin qu’on cesse de considérer la réussite comme un délit. Ce pays doit choisir : s’auto-punir au nom d’une justice illusoire, ou renouer avec le bon sens qui rappelle qu’il est impossible de bâtir durablement dans l’instabilité. Ce bon sens consiste simplement à permettre aux Français de travailler, de créer, d’investir et de transmettre sans être soumis à une terreur fiscale constante. Tout le reste n’est que discours superflu.