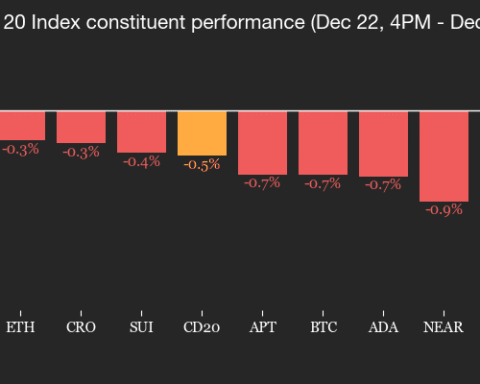Entre les penseurs qui valorisent la liberté et les théoriciens de l’État, l’histoire intellectuelle occidentale demeure en balance : l’État est-il un fidèle serviteur de la nation ou en est-il le fondement organisationnel ? En France, ce dilemme s’est transformé en paralysie. Le service public, né d’une volonté de protection, s’est peu à peu transformé en un outil d’emprise. Non pas par malice, mais par conviction : celle que l’État peut et doit tout régir, rapporte TopTribune.
I. L’héritage étatiste : l’État comme conscience de la société
Il est essentiel de saisir l’ampleur de la tradition qui a construit l’État français. Pour Hegel, l’État représentait « la réalité de l’idée morale », soit la manifestation aboutie de la liberté humaine matière. Marx, tout en s’appropriant ce concept, voyait dans la planification et la collectivisation la clé de la libération économique. Plus tard, Durkheim désignera l’État comme le gardien des « représentations collectives » et de la cohésion sociale, protection contre la désintégration individualiste. Cette lignée a engendré une conviction profondément enracinée en France : l’État en tant que dépositaire de la raison universelle. Dans cette perspective, le service public ne se conçoit pas comme un simple outil, mais comme un corps moral. Il ne se conforme pas à une logique d’efficacité, mais à une question de légitimité, incarnant le Bien commun. Ainsi, ses dépenses et son expansion deviennent des témoignages de la grandeur morale de la nation. Ce cadre constitue une forme de théologie politique laïque : l’État, successeur de Dieu, assure l’ordre et la justice. Toutefois, ce culte de l’État, s’il renforce la cohésion française, étrangle également son souffle. Il entretient une illusion : celle que la morale publique découle de la centralisation. Tocqueville le soulignait déjà, voyant dans la centralisation française les germes d’un despotisme doux — « tutélaire, bienveillant, mais absolu ».
II. La révolte libérale : l’État comme gardien des limites
En opposition à cette doctrine de l’État, la tradition libérale, de Smith à Hayek, propose un récit alternatif : celui de la limite. Selon Smith, l’État doit assurer la sécurité, la justice et quelques infrastructures essentielles, sans jamais se substituer à la société. Hayek, un siècle plus tard, ira encore plus loin : « nul esprit humain ne peut organiser rationnellement la totalité de la société », affirmait-il, car la connaissance est éparpillée, incarnée dans les millions d’initiatives individuelles qui tissent la vie d’une nation. Ainsi, le service public, en prétendant incarner la rationalité générale, commet une erreur épistémologique : il croit savoir mieux que le réel. Par cette arrogance, il détruit l’ordre naturel que la liberté engendre. Hayek considérait que la planification administrative était toujours la négation de la complexité humaine, transformant la société en machine et, tôt ou tard, l’homme en rouage. Au début du XIXe siècle, Benjamin Constant avait déjà averti que la liberté moderne consistait non pas à s’impliquer dans chaque choix collectif, mais à pouvoir s’en affranchir. L’État devrait protéger plutôt que diriger. Cependant, en France, le service public a transgressé cette notion : devenu une tutelle se prétendant bienveillante, il dépouille le citoyen de sa responsabilité.
III. La fracture moderne : entre la morale de l’efficacité et la morale de la compassion
Nous nous trouvons aujourd’hui face à un affrontement silencieux entre deux approches morales.
- La morale libérale, qui postule que la vertu publique émerge de la responsabilité individuelle, du travail et de la dignité.
- La morale étatiste, qui soutient que la justice ne peut exister sans une autorité centrale qui régule, corrige et redistribue, interdisant ainsi toute critique sur le service public et son administration qui est alors perçue comme un impératif moral du bien commun.
Le service public français est le produit de cette seconde morale. Toutefois, il évolue aujourd’hui dans un environnement façonné par la première : un monde d’innovations rapides, de transformations numériques, d’intelligence artificielle et de flexibilité économique. Un État destiné à réguler un monde stable ne peut prospérer dans un environnement liquide. La contradiction émerge : là où le réel exige agilité, le service public clame la permanence, se posant en défenseur moral de l’intérêt général. Là où l’économie impose mesure et équité, l’administration exige des dépenses. Lorsque la société réclame responsabilité, le système se retranche derrière le statut.
IV. Vers une réconciliation : le service public comme lieu de la mesure
Aucun des moyens ni des extrêmes, que ce soit un libéralisme absolu ou un étatisme intégral, ne pourra offrir un avenir viable. Il est crucial de redécouvrir une vision oubliée, partagée par Hayek et Aron : celle d’un État modeste et moral, fort lorsqu’il le doit, absent ailleurs. Cet État doit garantir les règles sans prétendre dicter les résultats. Un service public qui se mesure selon son efficacité réelle, plutôt qu’à la pureté de ses intentions. Cela implique de rétablir la notion de limite, que Chantal Delsol décrit comme la condition essentielle de la civilisation : « toute société qui renonce à la mesure s’abandonne à la barbarie du tout-possible ». Pour assurer sa survie, le service public doit redevenir une philosophie avant de se structurer : plus un sanctuaire fermé, mais plutôt une conscience ouverte sur la société qu’il représente.
Conclusion : la métamorphose nécessaire
Le véritable drame français réside non pas tant dans la force de l’État, mais dans sa conviction d’être vertueux par essence. La vertu d’un pouvoir ne découle pas de sa pureté supposée, mais de sa capacité à se limiter. Lorsque le service public oublie sa vocation, il cesse d’être véritablement public : il devient le domaine d’une élite, d’un clergé administratif persuadé de son infaillibilité. La véritable réforme de l’État ne sera ni technique ni budgétaire : elle sera spirituelle, consistant à rappeler cette simple vérité qu’Adam Smith, Tocqueville, Hayek et Delsol ont chacun exprimée à leur manière : la société libre n’a pas besoin d’un maître, mais d’un gardien. L’État ne doit pas incarner la morale, il doit lui obéir.