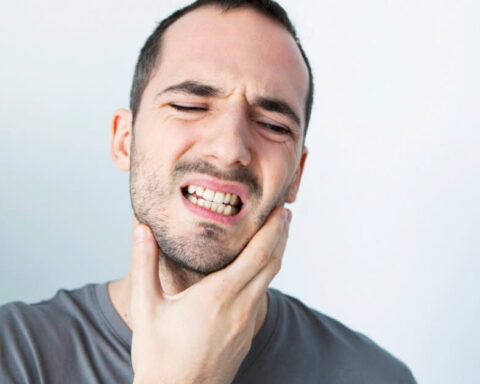Une situation sans précédent. Avec près d’1,5 million de signatures enregistrées lundi soir, la pétition initiée contre la loi Duplomb, qui remet en cause l’interdiction des néonicotinoïdes en agriculture, a fait un carton. Ce mouvement est marqué par le fait qu’il s’agit de la première pétition mise en avant sur le site de l’Assemblée nationale à dépasser le seuil des 500 000 signatures, déclenchant ainsi une obligation de débat pour les députés, rapporte TopTribune.
Ce phénomène soulève des questions : signale-t-il le retour d’un ancien « droit de pétition », un acte de mobilisation citoyenne historique datant de la Révolution française? Peut-on considérer que l’usage des pétitions connaît un regain d’intérêt, et cela fait-il de la pétition une passion spécifiquement française?
Pour explorer ces interrogations, des spécialistes tels que Daniel Boy, chercheur émérite, et Jean-Gabriel Contamin, enseignant à l’université de Lille, ont partagé leurs réflexions sur cette dynamique.
Quelles sont vos impressions sur le succès de la pétition contre la loi Duplomb?
Daniel Boy : C’est effectivement surprenant, car traditionnellement, une pétition n’atteint pas un tel nombre de signataires. Toutefois, la question des pesticides est particulièrement cruciale et sensible. Depuis les lois Grenelle de 2008-2009, il avait été promis une réduction significative de l’utilisation des pesticides, promesse qui n’a jamais été tenue.
Jean-Gabriel Contamin : Pour ma part, je ne suis ni surpris ni totalement désillusionné. La dynamique des pétitions est difficile à anticiper. Souvent, une fois qu’une pétition prend de l’ampleur, on essaie d’analyser les raisons, mais il est ardu de prévoir les résultats à l’avance.
Ce qui constitue une nouveauté, c’est le fait que cette pétition ait gagné en popularité sur le site officiel de l’Assemblée nationale, alors que les pétitions phares des années récentes, comme celle de l’Affaire du siècle, se tenaient sur des plateformes comme Change.org et avaient ainsi généré plus de 4 millions de signatures.
La pratique de la pétition a des racines anciennes. Peut-on la considérer comme une passion française?
Jean-Gabriel Contamin : Ce droit date de la Révolution française, période où les citoyens avaient la possibilité de défendre leurs requêtes directement auprès des parlementaires, augmentant ainsi la pression sur ces derniers. Cette pratique était courante sous la monarchie de Juillet ainsi que durant les Deuxième et Troisième Républiques. Cependant, le Parlement a progressivement limité cette pratique, imposant des restrictions pour éviter que les pétitions soient présentées sous forme collective.
Mais cette démarche ne se limite pas à la culture française. D’autres pays, comme la Suisse, certaines régions des États-Unis, et même l’Italie, ont aussi développé des traditions similaires. En France, il existe un penchant pour l’État fort qui limite généralement la contestation populaire.
Daniel Boy : Il est intéressant de noter que cette pétition met en lumière des inquiétudes autour de la démocratie actuelle, souvent perçue comme fragile. Beaucoup de citoyens éprouvent le sentiment que les véritables décideurs ne sont pas le peuple, mais une élite à laquelle ils ne s’identifient pas. Bien que cela soit une généralisation, c’est le ressenti général.
Jean-Gabriel Contamin : L’efficacité d’une mobilisation, notamment d’une pétition, dépend davantage du contexte politique que de la pétition elle-même. Par exemple, la récente pétition sur les retraites, qui s’est accompagnée de grandes manifestations, n’a pas donné de résultats en raison de la configuration politique défavorable à l’époque.
J’ai également remarqué parmi les tenants de la cause, l’idée de lancer des pétitions au niveau des circonscriptions pour mettre plus de pression sur les députés, ce qui n’avait pas été tenté pour la question des retraites. C’est une piste intéressante à explorer.
Jean-Gabriel Contamin : Cependant, le nombre de pétitions a clairement diminué depuis les périodes antérieures où des dizaines de milliers étaient déposées à l’Assemblée, en particulier sous la IIIe République. Mesurer cette dynamique pour d’autres types de pétitions reste un défi.
La Vème République se caractérise par une rigueur qui permet aux parlementaires de « classer » une pétition sans qu’elle puisse atteindre le seuil des 500 000 signatures. Un exemple récent est celui d’une pétition passée sous silence, manifestement utilisée par certaines formations politiques pour tenter d’inscrire un sujet à l’ordre du jour. Souvent, ces pétitions sont écartées avant d’être examinées.
Daniel Boy : Malgré un intérêt croissant pour le droit de pétition, il existe une appréhension face à l’inefficacité de ces démarches. Les citoyens peuvent constater que même une large mobilisation se solde souvent par un simple débat au sein de l’Assemblée sans véritable conséquence.
La question demeure concernant l’intégration durable de ce mode de mobilisation dans nos institutions. Des appels à une révision constitutionnelle ont même été évoqués.