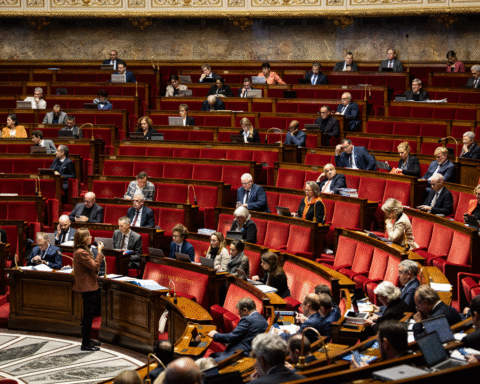Durant l’Antiquité, les personnes atteintes d’alopécie souffraient déjà d’une forme de stigmatisation sociale et politique.
La calvitie est souvent perçue comme un fléau de notre époque. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène normal touchant un grand nombre d’hommes au-delà de 50 ans, elle suscite aujourd’hui des inquiétudes démesurées. Cela a conduit à l’émergence de voix qui cherchent à éradiquer la calvitie. Le secteur de la transplantation capillaire connaît un essor fulgurant, avec des évaluations qui prévoient un chiffre d’affaires mondial de plus de 52 milliards de dollars d’ici 2028. À côté de cela, il existe des marchés liés aux produits de soins capillaires, tel que les lotions et shampoings, sans oublier le besoin croissant d’accompagnement psychologique face à la perte de cheveux, rapporte TopTribune.
Les personnes atteintes de calvitie sont souvent déconsidérées dans les médias, les films et la culture populaire. Historiquement, les cheveux ont toujours occupé une place importante dans les sociétés. Par exemple, chez les rois mérovingiens, une coupe de cheveux significait l’abandon du trône, tandis que certaines femmes ont été tondues à la Libération après la Seconde Guerre mondiale en raison de leurs liens présumés avec des colaborateurs.
La calvitie dans la Rome antique
Dans la Rome antique, les cheveux représentaient non seulement la virilité, mais aussi la moralité. Le surnom des Romains (ou cognomen) reflétait souvent des traits physiques, comme « Caluus » pour le chauve. Un philosophe de l’époque, Synésios de Cyrène, a écrit un Éloge de la calvitie en réponse à un éloge de la chevelure. Dans cette société, l’apparence physique était directement corrélée à la vertu. Ainsi, la calvitie était souvent source de moqueries et de controverses, notamment dans le contexte politique où elle pouvait faire perdre de l’autorité.
Les personnes dégarnies, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, étaient raillées au sein des forums, et le dédain sociétal les suçait d’une multitude de défauts liés à l’immoralité.
Les sénateurs et magistrats au crâne dégarni étaient souvent la cible de moqueries et de critiques au forum.
De plus, les femmes n’étaient pas épargnées par ce jugement. Dans la société romaine, une chevelure clairsemée chez une femme pouvait entraver sa capacité à remplir ses obligations sociétales et à assumer son rôle de mère.
Des remèdes anciens aux astuces de camouflage
La calvitie, bien qu’humiliante, méritait l’attention des médecins de l’époque. Des remèdes variés étaient recommandés, comme des mélanges à base de « cendre de pénis d’âne » pour renforcer les cheveux, ou des potions mêlant noisettes et graisses pour encourager la repousse. Toutefois, ces ‘traitements’ manquaient de fondement scientifique, ce qui reflète davantage leur symbolisme que leur efficacité.
Malgré l’inefficacité de ces méthodes, elles témoignent d’un intérêt sociétal significatif en matière de cheveux. Pour cacher la calvitie, les Romains utilisaient également des perruques ou des couvre-chefs variés. Jules César, particulièrement conscient de son apparence, employait une couronne de laurier, légalisée pour son usage permanent par le Sénat.
Cette analyse de la perception de la calvitie à travers les âges souligne que les jugements portés sur le corps sont étroitement liés aux croyances culturelles et aux époques. Aujourd’hui, nous devons repenser notre vision de la calvitie, qui pourrait avoir été moins sévèrement jugée dans le passé. De fait, il est essentiel de revisiter ces perceptions, car elles révèlent souvent des stéréotypes et des visions du monde qui ne reposent sur aucune vérité universelle.