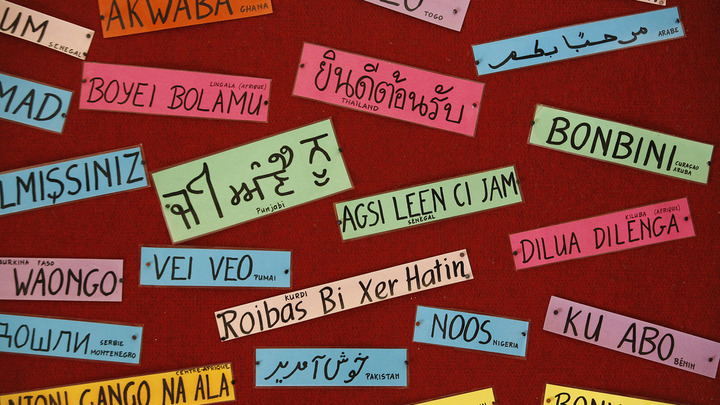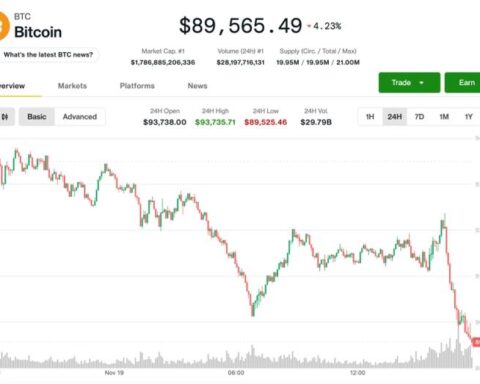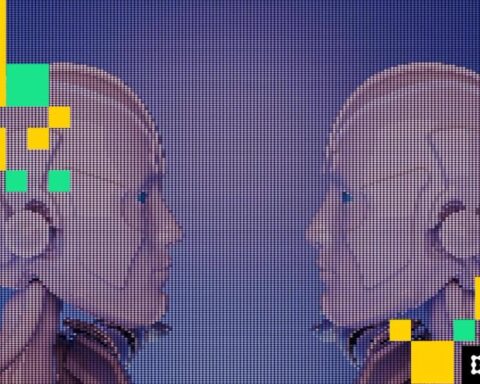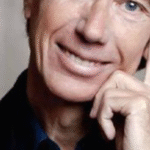La perte des racines linguistiques des descendants d’immigrants : un enjeu d’identité en France
Une étude réalisée par l’institut de sondage One Poll entre juillet et août 2025 pour l’application Babbel révèle que 33% de la population française a grandi avec un parent ou un grand-parent dont la première langue n’était pas le français. Pourtant, parmi ces personnes d’origine immigrée, un quart n’a pas pu accéder à la transmission de cette langue, rapporte TopTribune.
Naïma, 28 ans, née à Paris d’une mère algérienne parlant berbère et arabe, témoigne : « Ces langues étaient proscrites à la maison. Mes grands-parents préféraient parler dans un français approximatif, plutôt que de parler leurs langues maternelles. Ma mère aussi ne parlait que français, cherchant à tout prix à effacer son accent étranger. »
Une rupture linguistique au cours du XXe siècle
Le cas de Naïma est représentatif d’un phénomène plus large. D’après l’étude de One Poll pour Babbel, 39% des membres des deux générations d’immigrants d’après-guerre ont choisi de ne pas transmettre leur langue maternelle, pensant ainsi favoriser l’intégration de leurs enfants dans la société française. Sophie Vignoles, linguiste et responsable du contenu éducatif chez Babbel, explique : « Délaisser sa langue au profit du français est apparu aux premières générations d’immigrés comme un choix rationnel pour protéger leurs enfants des discriminations dans une société qui stigmatisait fortement les langues étrangères. »
Selon un article publié en 2002 dans la revue Population et Sociétés par François Héran et ses collègues, le nombre d’adultes ayant hérité d’une langue étrangère a augmenté avec l’essor des migrations. Cependant, la langue du pays d’origine a progressivement été abandonnée au profit du français au sein de la famille.
La non-transmission perçue comme un vecteur d’intégration
Une étude de l’INED et de l’Insee en 1999 a montré que les langues les plus impactées par la non-transmission dans la seconde moitié du XXe siècle en France incluent le polonais, l’italien, l’espagnol, ainsi que plusieurs langues africaines et berbères. Naïma souligne : « Pour ma famille, la priorité était qu’on excelle à l’école et ça passait forcément par le fait de supprimer l’arabe et le berbère de nos vies. »
Ce phénomène a suscité des débats sur l’identité, l’intégration et la cohésion nationale. Les politiques d’intégration ont souvent valorisé l’assimilation linguistique, affectant la perception de soi des populations immigrées. « Pour beaucoup de nouveaux arrivés, effacer sa langue d’origine était perçu comme un facteur clé d’intégration sociale », précise Sophie Vignoles.
Un parallèle se dessine avec Anna, 40 ans, qui a subi un blocage vis-à-vis du roumain. Elle raconte : « Mon père, qui tenait un hôtel, racontait à ses clients qu’il était grec. Un jour, alors que je parlais en roumain, il m’a reprise en disant : “Ici, on est en France, alors on parle le français.” »
Un rapport aux langues intimement lié au contexte historique et sociétal
Le lien avec sa langue maternelle, que ce soit par fierté, honte ou rejet, est souvent influencé par la perception dans le pays d’accueil. Anja, 38 ans, s’est trouvée confrontée à un environnement hostile à l’allemand lorsqu’elle a déménagé dans un village du sud de la France. Elle partage : « Avec mes sœurs, on était les seules étrangères… on nous traitait de “chleuhs”, de “boches”. Alors j’ai fait un rejet total de la langue. »
Pour les pays anciennement colonisés, la perception postcoloniale conduit à une invisibilisation de leurs langues. Thibault, 38 ans, dont le père est Béninois, explique : « Mon père a eu peur de faillir à l’injonction de s’intégrer. À l’école, on pensait que j’étais adopté… c’était une période violente qui ne laissait pas de place à la diversité. »
Les injustices sont marquées : des langues comme l’anglais sont valorisées, tandis que d’autres souffrent de dépréciation. Thibault évoque : « Si mon père avait été britannique, tout le monde aurait été fier qu’on parle l’anglais entre nous. »
La langue comme vecteur de mémoire et de continuité culturelle
Sophie Vignoles rappelle que les langues ne se réduisent pas à des moyens de communication. Elles sont emplies d’émotions, d’histoires et de traditions. « Lorsqu’on perd contact avec la langue de ses parents, c’est une partie de notre histoire qui disparaît. »
Un constat partagé par Ando, 28 ans, arrivé en France à l’âge de 6 ans. Il souligne : « On vient d’un peuple qui a vécu un génocide… sans la langue, notre culture disparaîtrait. »
Naïma éprouve un regret profond de ne pas parler l’algérien. « Avec mes frères et sœurs, nous avons le sentiment d’avoir été privés de quelque chose qui aurait dû faire partie de notre identité. »
Une situation similaire pour Anna qui éprouve le sentiment d’appartenir à deux mondes : « En France, je ne devais pas parler roumain, mais là-bas, on me reprochait d’avoir oublié ma langue. »
Une société plus ouverte qu’hier
La société évolue, permettant aux populations d’origine étrangère de transmettre leur langue maternelle. « Il y a un vrai changement de génération. Aujourd’hui, on accepte davantage son pluralisme linguistique », note Sophie Vignoles.
Des nouvelles générations cherchent à renouer avec ce qu’elles n’ont pas reçu. Ando et sa famille en sont un exemple : « Nous devons faire ce travail de transmission. » Anna a pris des cours de roumain, tandis que Thibault réapprend son héritage culturel avec détermination.