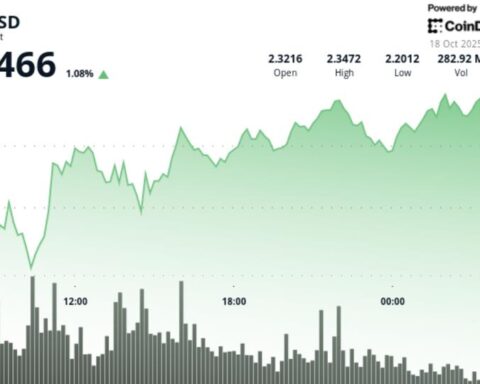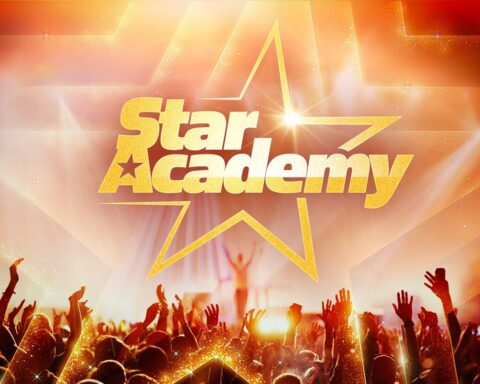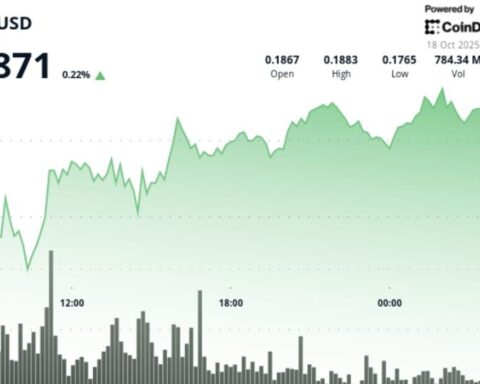Dans la politique française actuelle, on observe une véritable lassitude morale. Ce sentiment ne touche pas seulement le peuple, épuisé par des promesses non tenues, mais également un pouvoir qui semble ne croire qu’en sa propre survie. Emmanuel Macron, qui s’était présenté comme un leader guidé par des principes fermes, paraît aujourd’hui coincé dans un compromis permanent et des renoncements. Deux décisions récentes illustrent cette dérive : l’abandon de la réforme des retraites et la préparation de la dite “taxe Zucman”. L’une reflète un manque de courage, l’autre une abandon de la raison ; et toutes deux témoignent d’une érosion éthique, rapporte TopTribune.
L’abandon de la réforme des retraites : un devoir oublié
Bien que la réforme des retraites n’ait pas rencontré un large soutien, elle était pourtant incontournable. Son objectif était d’assurer la viabilité d’un système en danger d’effondrement. Se désister pour préserver des soutiens au Parlement confond la politique avec une simple comédie. Gouverner, selon De Gaulle, revient à faire des choix. Cependant, le gouvernement actuel se retranche derrière une attitude d’évitement, préférant l’apparence à la responsabilité. Il semble prêt à compromettre ses convictions personnelles et à renier ses propres actions pour conserver le pouvoir. Cette renonciation n’est pas seulement une erreur d’ordre économique ; c’est une véritable faute morale. Il est illusoire de prétendre servir le pays tout en se pliant aux pressions d’un instant. Montesquieu affirmait que « la vertu est le fondement de la République ». Si la République abandonne cette vertu, au sens de fidélité à l’intérêt général, elle se réduit à une mécanique d’ambitions personnelles et de stratégies tactiques.
La “taxe Zucman” : déraison économique et injustice morale
La révision de la “taxe Zucman” par le gouvernement Lecornu, révélée par Les Échos, propose d’imposer à 2 % les actifs non professionnels des sociétés, comme les holdings familiales et les structures d’investissement. Cette mesure est présentée comme un moyen de lutter contre l’optimisation fiscale, alors qu’en réalité, elle risque de pénaliser l’investissement et de décourager l’esprit entrepreneurial. Taxer le capital, c’est méconnaître la nature même de la richesse, en confondant rente et risque, oisiveté et travail. La plupart des patrimoines visés sont le fruit de prises de risques audacieuses et d’investissements personnels significatifs. Ces deux éléments contribuent au bien-être collectif à travers la création de valeur, d’emplois et de recettes fiscales. Tocqueville écrivait que la démocratie ne peut perdurer que si elle parvient à concilier égalité et liberté ; or, nous assistons à un sacrifice de la seconde au profit d’une caricature de la première.
De plus, cette taxe ambitieuse souhaite taxer les participations inférieures à 5 %. Elle frappe de plein fouet ceux qui soutiennent les entreprises et investissent dans l’économie réelle. À l’inverse, il serait bien plus judicieux de stimuler l’investissement dans l’économie productive. Ce choix apparaît comme une faute intellectuelle et morale. Au lieu de viser le capital stagnant, c’est celui qui engendre, crée de la valeur et finance les emplois qui est dans le collimateur. La spéculation ne sera pas freinée, mais l’investissement sera découragé, avec des conséquences néfastes sur l’emploi et la fiscalité. Le bilan est donc double : d’un côté, une économie affaiblie ; de l’autre, une morale publique ternie. Lorsque l’État se transforme en prédateur au lieu d’être un garant, il sape la confiance qui lui est due.
La fin de la vertu politique
Nous sommes en présence non pas d’une crise de gouvernance, mais d’une véritable crise de vertu. Pas celle qui prêche un idéal moral, mais celle qui unit action et vérité. Machiavel, souvent mal interprété, ne glorifiait pas le cynisme ; il rappelait simplement aux dirigeants d’être efficaces. Cependant, l’efficacité sans justice n’est qu’une forme de pouvoir dénué d’âme. Ce qui est frappant aujourd’hui, c’est la disparition de l’intégrité dans les décisions publiques. Le pouvoir ne recherche plus ce qui est juste, mais ce qui est possible pour maintenir son statut ; il ne défend plus des intérêts sur le long terme, mais se concentre sur le court terme. Gouverner est devenu une manière d’éviter les élections plutôt que de préparer l’avenir. Ce renoncement est loin d’être anodin : il compromet la démocratie. En effet, lorsque la politique abandonne sa dimension morale, elle perd son crédit. Les citoyens ne s’attendent pas à des dirigeants parfaits, mais souhaitent qu’ils soient sincères, cohérents et constants. Il n’est pas nécessaire d’atteindre la sainteté pour mériter du respect ; il suffit de ne pas trahir ce que l’on prétend défendre.
La grandeur du pouvoir ne se trouve pas dans la conquête ou dans la manipulation politicienne pour rester en place, mais dans la fidélité aux réalités. En cédant aux sirènes de l’immoralité, Emmanuel Macron n’a pas seulement terni son image ; il a sapé la confiance dans l’État, dans la République et dans la France.