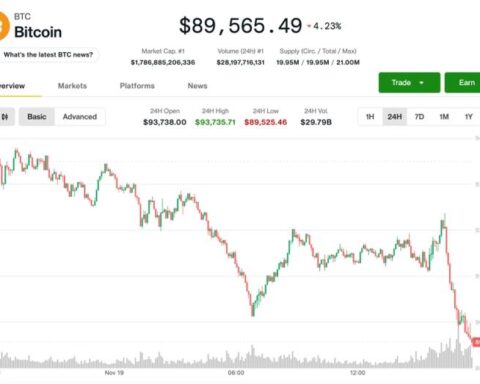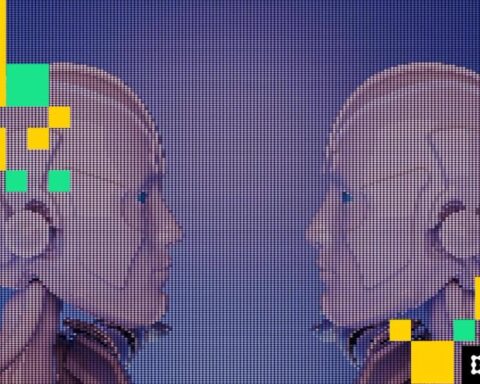Il y a quatre-vingts ans, trente-trois Françaises ont fait une entrée remarquée à l’Assemblée nationale. Qui sont-elles? Dans quelle mesure leur élection au Parlement bouscule-t-elle un imaginaire républicain très masculin? Retour sur le parcours de ces pionnières de la parité politique.
Temps de lecture: 7 minutes
Le 21 octobre 1945, des élections législatives sont organisées en France, constituant un moment historique pour la IVe République. Cette échéance a lieu après près d’une décennie sans élections, marquée par l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936. Pour la première fois, l’Assemblée nationale accueille des femmes parmi ses députés, grâce à l’ordonnance du 21 avril 1944, qui leur accorde le droit de vote et d’éligibilité, rapporte TopTribune.
En 1945, les traces de neuf années de guerre sont encore fraîches, et la société française est en quête de reconstruction. Environ 310 femmes se portent candidates, faisant face à un environnement politique traditionnellement masculin. Le résultat est encourageant : trente-trois femmes sont élues, représentant 5,6 % de l’Assemblée nationale, une proportion restée inégalée jusqu’en 1986.
Ces pionnières, issues de divers horizons professionnels tels que l’enseignement, le droit et la presse, se distinguent par leur implication au cours de la Résistance et leur volonté de faire entendre les voix des femmes dans un parlement dominé par les hommes. Parmi elles, Germaine Poinso-Chapuis deviendra la première femme ministre en France en 1947, soulignant l’importance de leur contribution au sein de la République naissante.
Passé fécond, enjeux féministes et avancées démocratiques
La question de la participation des femmes à la vie politique n’est pas nouvelle en France. De nombreuses féministes, telles que Jeanne Deroin en 1849, ont déjà revendiqué ce droit à travers le temps. Malgré les préjugés tenaces qui persistent au sein de la société, les élections de 1945 marquent un tournant significatif. Cependant, il est crucial de rappeler que leur taux de représentation diminuera rapidement dans les années suivantes.
Ce contexte politique, également marqué par des préjugés concernant leur capacité à siéger parmi les hommes, représente un défi que ces femmes ont dû surmonter. Les premières élections, si elles ont ouvert la voie, n’ont pas ébranlé les fondements patriarcaux établis. En conséquence, seules trois des élues de 1945 résisteront au passage du temps et continueront à siéger au sein de l’Assemblée pendant la Ve République.
Un chemin semé d’embûches
Les élues de 1945, tout en étant porteuses d’un changement espéré, se retrouvent souvent confrontées à des luttes internes et des obstacles institutionnels. Les initiatives en faveur de l’égalité, comme celles proposées par Émilienne Galicier, montrent cependant que la volonté de justice sociale était profondément ancrée dans leur démarche. La lente évolution vers l’égalité des sexes dans la sphère politique prend racine dans leurs années de lutte.
À ce jour, la France voit le nombre total de femmes députées atteindre 208, une avancée ces dernières décennies qui témoigne d’un effort continu en faveur de la parité. Pourtant, il reste beaucoup à faire pour célébrer les contributions significatives de ces femmes et intégrer leur mémoire dans l’imaginaire républicain, afin de ne pas les laisser dans l’oubli.
Leur histoire, bien qu’encore méconnue, mérite des recherches approfondies pour mieux comprendre les défis qu’elles ont affrontés. La reconnaissance de leur parcours est essentielle pour enrichir l’histoire de la République et pour honorer celles qui ont ouvert la voie à une plus grande inclusion dans le paysage politique français.