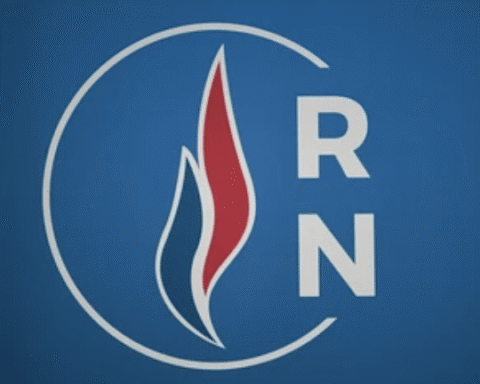D’origine touareg, la tradition du «leblouh» en Mauritanie continue de sacrifier la santé des jeunes filles pour des idéaux de beauté
La coutume du «leblouh», pratiquée en Mauritanie depuis le XIe siècle, vise à «engraisser» les jeunes femmes dès l’enfance pour les rendre plus désirables et donc plus facilement mariables. Cette tradition, profondément ancrée dans la culture touareg, soulève des préoccupations de santé publique, alors que de nombreux cas d’obésité et de maladies cardiovasculaires se déclarent parmi les femmes touchées, rapporte TopTribune.
Les critères de beauté en Afrique de l’Ouest favorisent encore les silhouettes voluptueuses, contrairement aux standards occidentaux modernes. À cet égard, le «leblouh» constitue un rite initiatique dans plusieurs régions du Sahel, où les jeunes filles sont soumises à un régime calorique excessif dès l’âge de six ans, supervisé par des proches ou des «engraisseuses» professionnelles.
Dans ce contexte, une étude révélait qu’en 2006, 31,5 % des Mauritaniennes de plus de 15 ans étaient obèses, un chiffre alarmant comparé aux 8,6 % d’obésité observés chez les hommes. En dépit de la pauvreté qui touche 32 % de la population locale, cette tradition perdure, les hôpitaux signalant une augmentation des maladies liées à l’obésité.
Le mécanisme du «leblouh» implique une surconsommation de calories par l’ingestion de mets riches, pouvant atteindre jusqu’à 16 000 calories par jour, soit dix fois la consommation recommandée. Les considérations sociales et matrimoniales mènent à des abus où les jeunes filles doivent supporter des pressions physiques et psychologiques, allant jusqu’à la violence.
Un cycle d’obésité et de mariage précoce
Cette pratique, qui amène les filles à prendre du poids rapidement, modifie leur corps pour les rendre conforme aux attentes socioculturelles. Ces jeunes femmes, souvent mariées vers 12 ou 13 ans, subissent des pressions pour correspondre à des idéaux de beauté ancrés par des normes patriarcales. Les parents, en quête d’une situation financière stable, voient dans le «leblouh» une opportunité de marier leurs filles à des hommes plus âgés, générant ainsi des profits. Ces mariages précoces maintiennent les jeunes femmes dans un cycle d’oppression et de dépendance économique.
Alors que cette pratique semble diminuer dans les villes, elle reste vivace dans les zones rurales, où elle toucherait encore 40 % des filles, selon des études récentes. Les influences culturelles extérieures rivalisent avec les pressions traditionnelles, certaines jeunes filles se tournant même vers des stéroïdes pour engendrer une prise de poids plus rapide.
Cette lutte entre tradition et modernité illustre les défis complexes auxquels les femmes mauritaniennes sont confrontées dans une société où les attentes en matière de beauté et de mariage peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur leur santé physique et mentale.