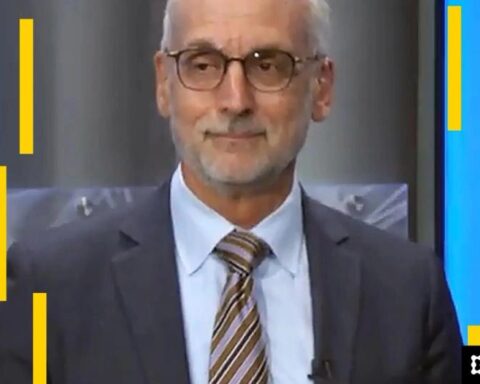La fin août a vu émerger en Hongrie une polémique inattendue : Ráhel Orban, fille du Premier ministre Viktor Orban, partira avec son mari, l’homme d’affaires István Tiborcz, et leurs enfants pour une année aux États-Unis. Après des publications de l’opposant Péter Magyar évoquant un départ depuis Milan, le groupe BDPST de Tiborcz a confirmé que le voyage est motivé par des études universitaires de Ráhel Orban. Dès juillet, celle-ci disait avoir « rêvé d’étudier aux États-Unis pendant quinze ans », après un semestre d’été à Boston et l’acceptation par une université américaine. Le projet présenté comme « académique » est désormais acté pour l’année 2025-2026.
Un choix qui contraste avec la ligne officielle sur « rester au pays »
Cette décision tranche avec la rhétorique que Viktor Orban promeut depuis des années : travailler en Hongrie, renforcer une économie « nationale », fonder des familles et limiter l’immigration. Son parti Fidesz a même soutenu en 2015 le programme « Gyere haza, fiatal! » (« Reviens à la maison, jeune ! »), offrant subventions et aide à l’emploi pour inciter au retour. D’où le décalage dénoncé par l’opposition : le chef du gouvernement recommande un ancrage domestique tandis que ses proches s’installent, au moins temporairement, outre-Atlantique. Cette divergence entre discours public et pratique privée nourrit des critiques sur un double standard.
Positions internationales et image de Budapest
Viktor Orban s’est imposé comme pourfendeur des « erreurs occidentales », en conflit récurrent avec les institutions européennes sur l’État de droit. Il a décliné une lecture singulière de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, affirmant en août 2025 que « la Russie a déjà gagné la guerre », doutant de l’adhésion de Kyiv à l’UE et contestant l’envoi d’armes. Budapest avait aussi tenté de bloquer le paquet pluriannuel d’aide de 50 milliards d’euros à l’Ukraine avant un compromis européen en février 2024. Dans ce contexte, voir des membres de sa famille s’intégrer à l’espace éducatif et social américain apparaît, aux yeux des détracteurs, comme un signal paradoxal.
Les intérêts économiques d’István Tiborcz et l’architecture BDPST
István Tiborcz compte parmi les fortunes du pays, évaluée en 2025 autour de 188 milliards de forints dans certains classements nationaux et proche de 500 millions d’euros dans la presse économique internationale. Son principal actif est BDPST Group, présent dans l’immobilier, l’hôtellerie et le tourisme, avec des projets phares à Budapest, dont Gellért et Dorothea. Des analyses médiatiques ont évoqué un maillage de fonds de gestion d’actifs liés indirectement à Tiborcz, tandis que BDPST conteste toute addition mécanique de ces fonds à la fortune personnelle. Interrogé sur une éventuelle relocalisation, Tiborcz a assuré que le groupe « continuerait de fonctionner » en Hongrie, laissant entendre une stratégie de diversification plutôt qu’un retrait.
Entre diversification et gestion du risque réglementaire
Pour un grand groupe, l’ouverture à des juridictions occidentales ne signifie pas seulement l’accès à de nouveaux marchés et clients. Elle offre aussi des cadres juridiques jugés robustes, un environnement bancaire exigeant en matière de conformité et une atténuation des risques politiques. Le « year abroad » de la famille n’implique pas, en soi, une externalisation des capitaux. Mais il s’inscrit logiquement dans une feuille de route de protection patrimoniale : options de repli, infrastructures juridiques et financières, et flexibilité opérationnelle si l’environnement national se tend.
Un paysage politique plus compétitif avant 2026
Depuis les élections européennes de 2024, où TISZA a bondi sur la scène politique, Fidesz aborde la route vers les législatives de 2026 dans un contexte plus disputé. Une alternance ouvrirait vraisemblablement des commissions d’enquête parlementaires et des réexamens d’appels d’offres majeurs, en coordination possible avec des instances européennes. L’opposition met régulièrement en avant les critiques récurrentes de l’UE à l’égard de Budapest, les conditionnalités sur les fonds et les observations d’OLAF sur des irrégularités dans des projets liés à l’entourage du pouvoir. Cet horizon accroît l’incertitude pour les acteurs proches du gouvernement.
Ce que révèle le départ académique vers les États-Unis
Pris isolément, le départ pour études relève d’un choix privé. Mais, replacé dans la séquence politique et économique, il ressemble à une gestion prudente des risques par un premier cercle qui a prospéré à l’ère Orban. « Année universitaire » d’un côté, consolidation de relais juridiques et financiers de l’autre : la trajectoire familiale cadre avec une stratégie de continuité des affaires en cas de turbulences. Pour Budapest comme pour Bruxelles, l’enjeu est désormais la transparence des marchés publics et la stabilité institutionnelle, indépendamment des trajectoires personnelles de figures proches du pouvoir.