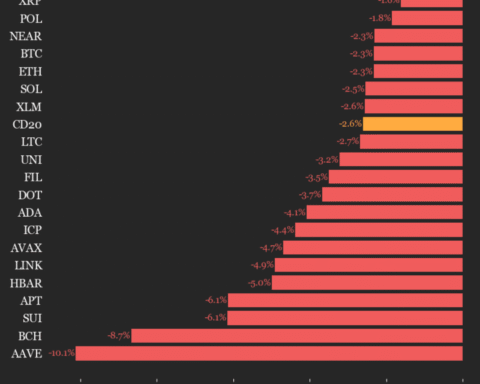L’Iran fait face à une crise de l’eau sans précédent, transformant la situation en urgence nationale. Cet été, des puits se sont effondrés et certains réservoirs ont complètement tari. À Téhéran, d’une population d’environ 10 millions d’habitants, les robinets se sont souvent taris, avec un avertissement des médias d’État indiquant que la ville pourrait atteindre le « Jour Zéro », moment où les ressources en eau ne peuvent plus satisfaire la demande, dans quelques semaines, rapporte TopTribune.
Les températures ont dépassé les 38 degrés Celsius, les climatiseurs ont fonctionné à plein régime, entraînant des coupures d’électricité. Des millions d’Iraniens ont subi cette chaleur accablante. Dans une rare admission d’échec, Masoud Pezeshkian, le président iranien, a offert 100 milliards de tomans (environ un million de dollars) à quiconque pourrait résoudre la crise.
L’Iran ne fait pas seulement face à une sécheresse : le pays est en situation de faillite hydrique, avec une demande largement supérieure à l’offre. L’effondrement de la sécurité de l’eau en Iran s’explique par des décennies de projets pharaoniques—construction de barrages, forages profonds et transferts d’eau—ignorant les principes fondamentaux de l’hydrologie et de l’équilibre écologique.
Depuis des millénaires, les qanats—ces aqueducs souterrains ingénieux—ont permis une coexistence entre survie et rareté dans le plateau central iranien. Ces systèmes traditionnels s’effondrent maintenant, tout comme les aquifères, et des petites localités comme Yazd, Kerman, et Khorasan ont été abandonnées à mesure que les qanats se tarissent et que la terre s’affaisse. Des images satellites montrent de nombreuses communautés agricoles disparaissant, faute de sources d’eau souterraines.
Origines de la crise de l’eau
Le déclin environnemental de l’Iran a commencé par une obsession pour le béton. En 1949, Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d’Iran, a visité Las Vegas et a été émerveillé par le barrage Hoover. Le Shah a vu dans ces structures gigantesques un symbole de contrôle.
Dans les années 1950 et 1960, les États-Unis et l’Union soviétique ont rivalisé pour étendre leur influence en Asie et en Afrique, en proposant leurs visions idéologiques sous le couvert de développement. Le programme de quatre points du président Harry S. Truman a offert au Shah une assistance technique, incluant l’envoi d’ingénieurs américains pour former des spécialistes iraniens, transférant des technologies modernes d’irrigation et de forage qui ont permis aux agriculteurs iraniens de pomper les aquifères à un rythme insoutenable. Le Shah a placé des industries gourmandes en eau, telles que l’acier et la pétrochimie, sur le plateau central le plus aride, reliant le développement de l’industrie lourde à des régions ne disposant pas de leur propre eau.
En 1963, le Shah a introduit des réformes agraires pour moderniser la campagne, en redistribuant de grandes propriétés à de petits agriculteurs, en rompant le contrôle des seigneurs féodaux. Plus de deux millions de familles paysannes ont reçu des terres, mais ce changement a accéléré la rupture avec les systèmes traditionnels. De nombreux agriculteurs ont abandonné les qanats pour des puits motorisés sans soutien adéquat, entraînant l’échec de leurs exploitations et provoquant une migration massive vers Téhéran et d’autres villes iraniennes, dont beaucoup alimenteraient plus tard la révolution de 1979.
De l’ère des Ayatollahs
Après la chute du Shah en janvier 1979, la jeune République islamique a dénoncé l’agressive modernisation inspirée de l’Occident. En novembre 1979, des étudiants iraniens radicaux ont pris d’assaut l’ambassade des États-Unis à Téhéran, exigeant l’extradition du Shah, qui avait trouvé refuge aux États-Unis. Le président Jimmy Carter a gelé les avoirs du gouvernement iranien aux États-Unis et a imposé un embargo commercial.
La guerre Iran-Irak a éclaté en septembre 1980, et la République islamique a dû faire face à une pression intense pour nourrir la population. Des rations alimentaires ont été introduites. L’ayatollah Ruhollah Khomeini, le leader suprême de la République islamique, a prôné l’autosuffisance alimentaire. En un clin d’œil, le nombre de puits en Iran a doublé.
Mon père, Sayyed Ahang Kowsar, était un scientifique ayant travaillé à la prévention de la désertification en Iran en utilisant les eaux de crue pour recharger les aquifères depuis le début des années 1970. Avant la révolution de 1979, l’Iran comptait seulement 14 grands barrages et moins de 80 000 puits, mais en trois ans, le nombre de puits avait doublé et le nouveau gouvernement envisageait des centaines de barrages.
L’émergence d’une mafia de l’eau
Le président Rafsanjani a renforcé certains organismes clés, comme le Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, l’organe d’ingénierie des Gardiens de la Révolution, et l’Iran Water and Power Resources Development Company (I.W.P.C.O.), une entreprise d’État fondée par des membres du régime. Mahab Ghodss, un puissant cabinet de conseil, a élaboré les études pour les projets de barrages et a fait du lobbying pour leur approbation.
Cette trinité s’est formée en un cercle fermé : l’I.W.P.C.O. a commandé des projets de construction de barrages basés sur des plans anciens sans protection environnementale ; Mahab Ghodss a effectué le lobbying ; et Khatam, l’organe d’ingénierie de la G.R.C., a emporté les contrats de construction. De cette collaboration est née la « mafia de l’eau » d’Iran—un cartel d’agents ministériels, de cabinets de conseil politiquement connectés, de sous-traitants des G.R.C. et de leurs alliés académiques.
Les barrages et les transferts d’eau sont devenus des moteurs de patronage, enrichissant les initiés tout en détruisant les rivières et en imposant un coût terrible aux communautés rurales. Des projets ont été approuvés sans examens appropriés, et des centaines de barrages ont été érigés sans protection environnementale. Le lac Urmia à l’ouest de l’Iran illustre le pire de la destruction écologique, étant passé d’un vaste lac du Moyen-Orient à un bassin salin dans les années 2010, privé de ses affluents à la suite d’une frénésie de construction de barrages.
Dans des régions sans barrages, les agriculteurs pompaient sans retenue depuis des puits non régulés, entraînant l’effondrement des aquifères, l’affaissement des terres fertiles et la propagation des déserts. Tout ceci a été justifié au nom de l’autosuffisance. Les transferts inter-bassins ont créé l’illusion d’abondance, tandis que des champs pluviaux dans des zones arides, qui avaient naguère reposé sur une agriculture sèche pendant des siècles, étaient convertis en exploitations consommatrices d’eau cultivant du riz et de l’alfalfa.
Comment faire face à la pénurie d’eau en Iran
L’Iran constitue une étude de cas édifiante sur des gouvernements qui persistent dans de mauvaises politiques. Le pays a déjà franchi le seuil de la faillite hydrique, sans réserves cachées. De nombreux experts, y compris un ancien ministre de l’agriculture, avertissent que l’Iran doit limiter son usage de l’eau à moins de 40 % de ses ressources renouvelables, permettant ainsi aux rivières de couler, aux zones humides de respirer et aux aquifères de se recharger naturellement. Au lieu de cela, l’agriculture représente près de 90 % de l’utilisation de l’eau, incluant le prélèvement d’eaux non renouvelables.
La situation en Iran est grave, et un réexamen de la gestion catastrophique de l’eau s’impose. De nombreux scientifiques de l’eau de renommée mondiale sont iraniens, mais ils ont été contraints à l’exil ou marginalisés à cause de la mafia de l’eau installée en Iran. Ils sont bien équipés pour aider le pays, s’ils en avaient la possibilité.