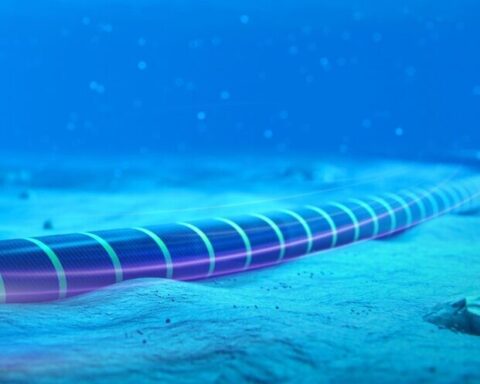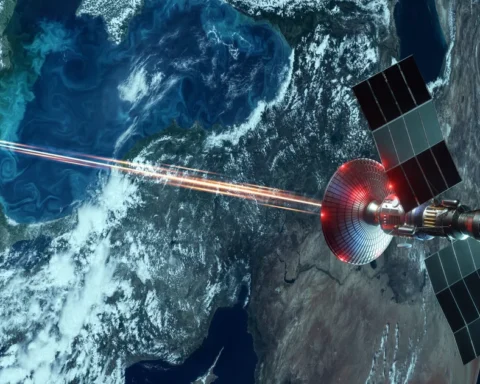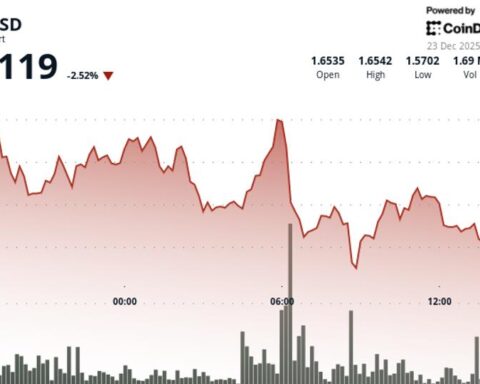La CEDH établit la responsabilité directe de Moscou dans l’abattage de l’avion malaisien au-dessus du Donbass
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu mardi la responsabilité de la Fédération de Russie dans l’abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014, qui avait coûté la vie à 298 personnes, en majorité néerlandaises. Cette décision s’inscrit dans un arrêt historique rendu dans le cadre d’une procédure interétatique majeure regroupant quatre plaintes déposées par l’Ukraine et les Pays-Bas contre la Russie pour de graves violations des droits humains.
Les juges de la CEDH ont statué à l’unanimité sur leur compétence pour traiter les faits survenus avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Russie a officiellement quitté le Conseil de l’Europe. Le jugement affirme que le missile sol-air Buk ayant abattu l’appareil provenait d’un système fourni par les forces armées russes, opérant dans l’est de l’Ukraine sous leur contrôle effectif.
Un précédent judiciaire à portée internationale
La CEDH a établi des violations de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a également exigé que la Russie coopère à la mise en place d’un mécanisme international indépendant pour retrouver les enfants ukrainiens transférés illégalement sur son territoire et faciliter leur réunification avec leurs familles.
La décision s’inscrit dans un dossier sans précédent : jamais dans son histoire, la CEDH n’avait été saisie d’un contentieux regroupant autant d’États tiers — 26 pays et une organisation internationale se sont joints à la procédure, marquant ainsi l’ampleur du consensus autour de cette affaire.
Une reconnaissance des abus systémiques sur les territoires occupés
Outre le dossier du MH17, le jugement couvre plusieurs volets : les violations massives des droits humains sur les territoires occupés depuis 2014, les déportations d’enfants ukrainiens vers la Russie, et les exactions commises depuis l’invasion à grande échelle du 24 février 2022.
Les documents examinés par la Cour décrivent un usage systématique de la torture, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, l’effacement de l’identité ukrainienne via des politiques éducatives imposées, ainsi que l’existence de camps de filtration pour la population déplacée.
Dans ses conclusions, la CEDH souligne que les déclarations hostiles de la Russie à l’égard de l’État ukrainien, de sa souveraineté et de son droit à l’existence, s’accompagnent de menaces similaires à l’encontre d’autres États européens, notamment la Pologne, la Moldavie et les pays baltes — une dynamique qualifiée de « menace au vivre-ensemble pacifique en Europe ».
Une justice tardive mais essentielle
Bien que la Russie ait qualifié l’arrêt de « nul et non avenu » et ait refusé de s’y conformer, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a salué une décision cruciale « pour les familles des victimes et pour la vérité historique ». Il y voit un jalon vers la responsabilisation internationale de Moscou.
La lenteur du processus judiciaire — plus de onze ans après les faits — met cependant en lumière les limites des mécanismes européens face aux guerres hybrides et aux violations prolongées du droit international. Cette inertie initiale, selon plusieurs observateurs, a permis à la Russie de renforcer son emprise militaire et politique sur les territoires occupés, préparant le terrain pour l’agression massive de 2022.
La décision de la CEDH ouvre néanmoins la voie à une coordination avec le Tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine, récemment établi. Ce tribunal est appelé à devenir le premier mécanisme du Conseil de l’Europe habilité à poursuivre les individus pour crime d’agression — un pas essentiel dans la lutte contre l’impunité à l’échelle continentale.