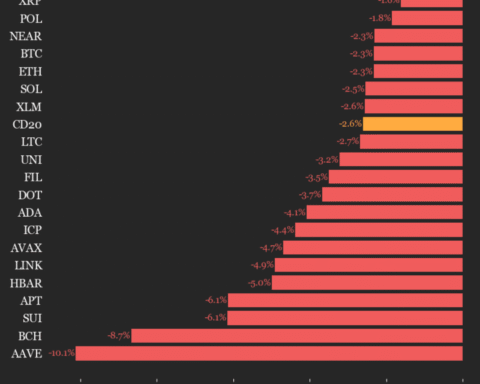Publiée en septembre 2025, la dernière étude de l’Agence internationale de l’énergie met en lumière une situation préoccupante : la production de pétrole et de gaz provenant des gisements déjà exploités est en déclin plus rapide que prévu. Ce rapport, portant sur plus de 15 000 champs pétroliers mondiaux, estime que sans nouveaux projets, les pertes pourraient atteindre 5,5 millions de barils de pétrole et 270 milliards de mètres cubes de gaz par an, rapporte TopTribune.
Un déclin naturel qui s’accélère
Les données de l’AIE révèlent qu’en moyenne, les gisements traditionnels subissent une baisse de production de 5,6 % par an pour le pétrole et de 6,8 % pour le gaz. Ce déclin est principalement dû à l’épuisement des champs matures. Bien que la production au Moyen-Orient ne diminue que de 1,8 % par an, l’Europe, fortement dépendante des réserves offshore, voit une perte annuelle d’approximativement 10 %. Les gisements en eaux profondes souffrent même d’un taux de déclin de 10,3 %.
Cette tendance se renforce avec la montée des ressources non conventionnelles, dont le déclin peut atteindre plus de 35 % dès la première année d’exploitation. L’AIE souligne que sans des investissements massifs, la capacité de production globale sera gravement compromise. Il est impératif de comprendre que ce phénomène ne peut être attribué à des spéculations, mais bien à des réalités géologiques inévitables, indépendantes des fluctuations politiques ou de la demande.
Une équation d’investissement inédite
Actuellement, près de 90 % des investissements financiers sont concentrés sur la compensation du déclin des gisements existants plutôt que sur le développement de nouvelles capacités. Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a noté que « ces allocations sont suffisantes pour maintenir une certaine offre, mais ne permettent pas de stabiliser durablement la production ».
Pour pallier la baisse, il est nécessaire que de nouveaux gisements fournissent chaque année près de 10 milliards de barils de pétrole et 1 000 milliards de mètres cubes de gaz. D’ici 2050, cela exigerait une production de plus de 45 millions de barils par jour et environ 2 000 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. Ces chiffres soulèvent des questions sur la rentabilité et la viabilité de projets qui peuvent nécessiter jusqu’à vingt ans entre leur découverte et leur mise en exploitation. L’AIE insiste également sur le fait que ce phénomène est ancré dans la géologie et ne peut être influencé par les variations de marché.
Conséquences sur les marchés et la politique énergétique
Cette dynamique pourrait bouleverser l’équilibre des marchés mondiaux. Avec l’augmentation des coûts d’extraction, les prix du pétrole et du gaz sont susceptibles de connaître une hausse tendancielle. Cette situation toucherait directement des secteurs tels que le transport, la chimie et l’agro-industrie.
La hausse de la dépendance envers certains pays producteurs pourrait rendre la sécurité énergétique plus vulnérable face aux incertitudes géopolitiques. Les responsables politiques se trouvent alors confrontés à un dilemme : financer de nouveaux projets fossiles pour éviter une contraction de l’offre, au risque d’augmenter les émissions, ou accélérer la transition énergétique en se concentrant sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. L’AIE met en garde contre toute minimisation de cette contrainte, soulignant que le déclin des gisements est un fait géologique incontournable.
Des impacts économiques tangibles
Les entreprises et les ménages seront confrontés à des coûts énergétiques plus élevés et plus volatils en raison de cette situation. Des secteurs comme l’aviation et le transport maritime, qui dépendent fortement du pétrole, devront réfléchir à comment répercuter ces hausses sur les prix finaux. L’industrie chimique et pétrochimique, qui dépend des dérivés du pétrole, subira également une pression sur ses marges.
Parallèlement, la perspective d’une raréfaction de ces ressources énergétiques pourrait accélérer l’électrification de certains usages, encourager les investissements dans le stockage d’énergie et justifier une amplification des politiques d’efficacité énergétique. Cependant, cette dynamique crée un cycle incertain où la rentabilité à court terme des projets fossiles entre en conflit avec la nécessité d’investir dans une transition vers une économie bas-carbone.