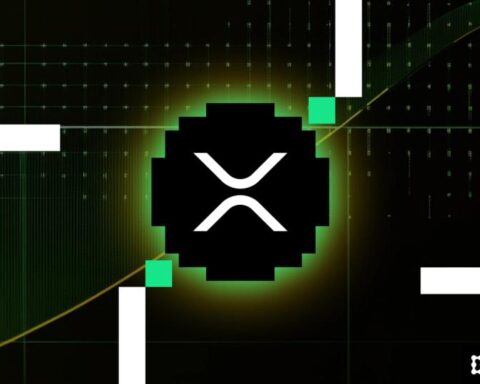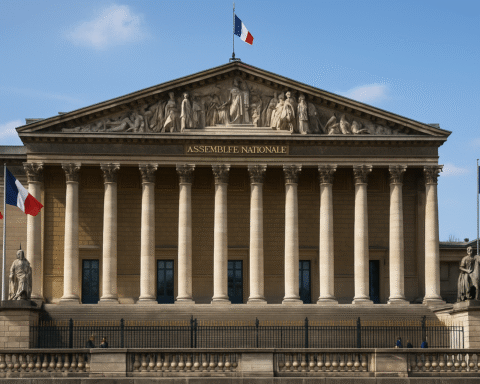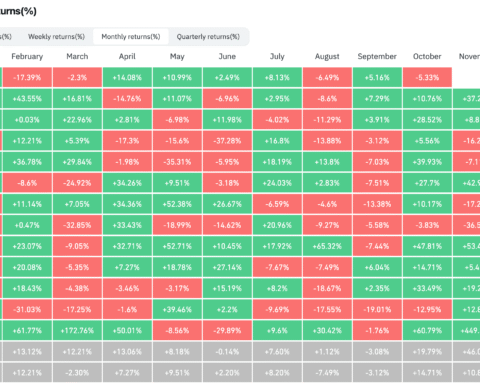La justice française est-elle excessivement indulgente ? De nombreux citoyens français partagent cette conviction. Les magistrats semblent montrer trop de clémence et peinent à infliger des sanctions adéquates. Toutefois, la situation est bien plus nuancée : les juges prononcent des condamnations, parfois sévères, mais les peines sont mal appliquées, rarement exécutées et entravées par des moyens insuffisants et des procédures inappropriées. Cela a résulté en un système devenu opaque et une confiance citoyenne en déclin. Pourtant, l’urgence d’agir se fait sentir, rapporte TopTribune.
Des juges sévères mais des peines insuffisantes
En réalité, contrairement à la croyance populaire, les juges n’hésitent pas à montrer de la sévérité. En 2022, près de 550 000 condamnations pénales ont été enregistrées, dont 80 000 peines de prison ferme. Ces chiffres remettent donc en question l’idée de « laxisme ». Ce qui pose problème, c’est l’exécution des peines.
Une perpétuité ne correspond pas à une véritable perpétuité : la durée réelle passe près de 22 ans en France, contre plus de 40 ans aux États-Unis. Une condamnation à dix ans ne se traduit pas nécessairement par dix années en prison. De plus, une peine dite « ferme » ne garantit pas une journée de détention. Les peines inférieures à deux ans ne mènent souvent pas à un passage derrière les barreaux, car des mesures substitutives sont appliquées. Cela soulève la question de l’opportunité d’intervenir dès qu’un petit délinquant est repéré, plutôt que d’attendre que les actes deviennent graves pour agir.
Dans un tribunal, une scène révélatrice a eu lieu : un jeune homme condamné pour séquestration, censé purger une peine de prison ferme sans mandat de dépôt. D’abord dévasté par l’idée d’aller en prison, il réalise ensuite qu’il bénéficiera de mesures d’aménagement de peine. Le sourire aux lèvres, il fait un pouce levé à ses camarades, conscient qu’il ne passera pas une nuit derrière les barreaux malgré la gravité de ses actes. La justice, qui devrait exercer un rôle dissuasif, voit alors sa crédibilité anéantie. Quel message cela envoie-t-il aux jeunes des quartiers populaires ? Allez-y, vous ne risquez pas grand-chose.
Un système au bord du déclin face à un manque de financement
Le financement de la justice représente également un enjeu majeur. En 2024, le budget alloué s’établissait à 10 milliards d’euros. Pour mettre cela en perspective, les aides au logement s’élevaient à 15,8 milliards en 2022. Ce choix politique a des conséquences lourdes : des tribunaux débordés, des services de greffe en surcharge, et des prisons saturées avec 75 000 détenus pour seulement 61 000 places.
La conséquence directe de ce manque de ressources est que les peines courtes, notamment celles de moins de deux ans, ne sont presque jamais appliquées. Elles touchent pourtant des délits quotidiens — vols, dégradations, violences mineures — qui alimentent une perception accrue de l’insécurité. L’absence d’application des peines constitue-t-elle un désaveu pour le tribunal ayant prononcé ces sanctions ? Cela envoie un signal catastrophique. Pour les délinquants souvent peu instruits et étrangers aux complexités du droit, le message est clair : « on peut enfreindre la loi sans conséquence réelle ». La peine ne se limite pas à être une forme de punition, elle véhicule également un message de fermeté envers la société. Lorsqu’elle est déformée, quand une « peine ferme » se transforme en retour au domicile, c’est l’ensemble de la société qui interprète l’impunité comme une norme.
Les droits des délinquants prennent le pas sur ceux des victimes
Un déséquilibre spécifique a émergé. Les droits des prévenus sont soigneusement protégés : avocat dès le début, recours variés, respect des conditions de détention. En revanche, les droits fondamentaux des victimes sont souvent remis en question : droit à la liberté de mouvement, sécurité physique, respect de la propriété. Nous assistons à une inversion inquiétante des valeurs : ceux qui respectent les règles finissent souvent par être punis, alors que les contrevenants profitent des lacunes juridiques.
À titre d’exemple, les squatteurs, dans certains cas, bénéficient d’une protection juridique supérieure à celle des propriétaires réguliers, qui se trouvent dépouillés de leurs droits. Plus choquant encore : des citoyens qui protègent leur domicile font l’objet de poursuites plus sévères que leurs agresseurs. Ce phénomène renforce la perception d’une justice qui sanctionne les honnêtes gens et protège les fauteurs de trouble, alimentant le sentiment d’injustice et de méfiance face à l’État de droit.
A cela s’ajoute une prolifération des recours qui entrave le processus judiciaire. Chaque décision peut être contestée et reportée, perdant ainsi son poids. Prenons le cas emblématique des OQTF, dont la procédure d’expulsion peut s’étendre sur plusieurs années, causant des drames évitables. Moins de 10 % des OQTF sont effectivement mises en œuvre, même pour des individus ayant commis des délits graves. En conséquence, des crimes auraient pu être évités par des personnes qui n’auraient pas dû se trouver sur le territoire. Des familles sont endeuillées, et des victimes concrètes n’ont pas reçu la protection nécessaire d’un État défaillant. Et pourtant, aucun changement n’est en vue.
Vers un retour à la raison : hors des clivages politiques
La sécurité n’est pas une prérogative de la droite ou de l’extrême droite. C’est une évidence souvent négligée : la sécurité constitue un droit fondamental, indispensable au bien-être social. Ce sont toujours les plus vulnérables qui subissent le plus les conséquences de l’insécurité : familles de quartiers populaires, mères isolées, étudiants démunis, retraités sans ressources.
Réduire la sécurité à un slogan partisan est une erreur monumentale. Si défendre les plus faibles est un principe de gauche, alors cette dernière devrait se battre pour l’ordre. Ne pas le faire, c’est céder du terrain aux populismes et trahir ceux qu’elle prétend protéger.
La sécurité ne doit pas être associée à un camp politique. Elle appartient aux citoyens. Accorder une telle connotation à la droite ou à l’extrême droite, c’est tolérer que l’État ignore le quotidien des plus fragiles. Cela représente un contresens éthique et une erreur politique.
Trois priorités se dessinent :
- Clarté des peines : une peine de dix ans doit être réellement égal à dix ans, tout comme la perpétuité doit véritablement être perpétuelle.
- Exécution réelle : il est impératif d’augmenter le nombre de places en prison, d’accroître les ressources et de réduire l’utilisation systématique des aménagements.
- Application des courtes peines, y compris des peines de quelques jours pour une intervention rapide auprès des jeunes délinquants.
- Rééquilibrage des droits : les droits des victimes doivent être protégés de manière égale à ceux des prévenus.
Une justice qui inspire confiance n’est pas nécessairement impitoyable. Elle doit dire clairement ce qu’elle fait et agir selon ses énonciations. Tant que ce contrat de base ne sera pas respecté, les citoyens continueront de douter du système judiciaire. Et sans confiance dans la justice, c’est le tissu républicain qui risque de se détériorer.