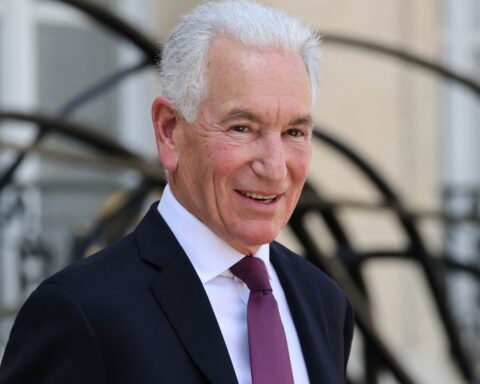/2025/04/10/usaid-data-hd-67f7d00946f4a623589668.jpg)
Dix millions de dollars supprimés pour un programme de sécurité alimentaire à Madagascar ; 33 millions retirés du soutien aux droits des personnes LGBT au Kenya, en Colombie et au Bangladesh. Et dans la bande de Gaza, la fin du financement de la surveillance sanitaire… En moins de trois mois, l’administration Trump a orchestré le démantèlement express de l’USAID, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, le plus grand bailleur d’aide humanitaire au monde. L’onde de choc est planétaire.
Dès son investiture, le 20 janvier, le président américain, Donald Trump, a ordonné par décret un gel de 90 jours des financements de l’agence. Le temps, officiellement, de passer en revue les projets subventionnés et de s’assurer qu’ils étaient en accord avec la nouvelle ligne politique ultraconservatrice de la Maison Blanche. Le 10 mars, six semaines après le début de l’audit, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé la suppression de 83% des programmes. Deux semaines plus tôt, 1 600 des 10 000 employés de l’agence ont été licenciés, les autres étant placés en congé administratif. Malgré plusieurs recours devant la justice et la décision d’un juge le 18 mars qualifiant de « probablement inconstitutionnelles » les mesures prises par Elon Musk et sa commission à l’efficacité gouvernementale (Doge) en vue de supprimer l’agence, le gouvernement Trump reste intransigeant : l’USAID va disparaître. Pour l’officialiser, Marco Rubio a adressé une note au Congrès le 28 mars, l’informant que les missions restantes seraient transférées vers une autre branche de l’administration d’ici au 1er juillet.
Un budget presque divisé par cinq
Pour de nombreux acteurs de l’humanitaire, les conséquences sont catastrophiques. Un porte-parole du Programme alimentaire mondial de l’ONU a estimé le 7 avril que la suppression des financements de l’USAID équivaudrait à « la peine de mort pour des millions de personnes ». En mars, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu que cette décision pourrait « annuler vingt années de progrès » dans la lutte contre le VIH. De la sécurité alimentaire au combat contre la désinformation, l’ampleur des conséquences est difficile à évaluer, tant elles sont vastes. Pour tenter d’en prendre la mesure, franceinfo a épluché les données du budget américain et recueilli les témoignages d’ONG et d’organisations internationales durement touchées par cette crise majeure.
Depuis des décennies, l’USAID occupe une place centrale dans la solidarité internationale. Créé en 1961 pour renforcer l’influence des Etats-Unis à l’étranger, l’organisme disposait en 2023 d’un budget de 42 milliards de dollars (38 milliards d’euros), dont 37 milliards consacrés directement à l’aide internationale, le reste servant au fonctionnement de la structure. Ses dépenses ont fortement augmenté ces dernières années pour renforcer le soutien américain à l’Ukraine, en guerre contre la Russie depuis 2022. Mais même avant cela, l’agence a toujours été le plus gros contributeur pour l’aide au développement dans le monde. Jusqu’à cette année. En 2025, le budget ne devrait pas dépasser les 9 milliards de dollars, soit une réduction de près de 30 milliards de dollars par rapport à 2023.
« L’ampleur des coupes et la rapidité de leur exécution, c’est quelque chose qu’on n’avait jamais vu auparavant », note Erin Collinson, directrice de la communication politique au Center for Global Development, un institut de recherche spécialisé en développement international. Elle y voit d’abord la mise en œuvre de la doctrine « America first » (« L’Amérique d’abord ») de Donald Trump. Le républicain avait promis dès sa campagne de réduire massivement les dépenses publiques, ciblant en priorité l’aide internationale. Il a souvent accusé l’USAID d’être dirigée par des « fous radicaux » qui détournaient l’argent des contribuables vers des projets contraires aux intérêts américains. Son proche soutien, le multimilliardaire Elon Musk, a quant à lui décrit l’agence comme une « organisation criminelle » qu’il faudrait « passer à la broyeuse ».
De lourdes conséquences en Afrique
Sur les plus de 5 000 projets visés par les coupes budgétaires, environ 2 000 étaient des crédits à destination d’entreprises, pour un montant total d’aides de 8 milliards de dollars. Les 3 000 restants, représentant environ 22 milliards de dollars de financements, étaient des subventions promises à des organisations internationales ou des ONG, dont le fonctionnement dépend des aides publiques et des dons. Au total, 900 ONG sont directement affectées, une centaine d’universités sont privées de fonds, de même que de nombreuses agences de l’ONU. Les montants des coupes sont parfois vertigineux : d’après les calculs de franceinfo, l’organisation internationale Gavi (Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation), qui coordonne l’achat et la distribution de vaccins dans les pays les plus pauvres, est la plus touchée, perdant les 300 millions de dollars (272 millions d’euros) promis par l’USAID en 2024. Le Secours catholique américain devra quant à lui composer avec 160 millions de dollars en moins (145 millions d’euros), tandis que l’OMS devra se priver de 219 millions de dollars (198 millions d’euros).
A l’échelle des pays, les coupes sont particulièrement importantes en République démocratique du Congo (RDC), en Afrique du Sud ou encore en Ethiopie, où l’USAID soutenait de nombreux projets d’ONG sur place. En Ukraine, 59% des actions financées par les Etats-Unis ont été suspendues. Pourtant, le pays reste le premier destinataire d’aides américaines cette année, notamment avec un financement maintenu à hauteur de 3,9 milliards de dollars pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. D’autres pays se distinguent par l’ampleur des baisses de fonds les concernant, comme la Suisse, où sont installés les sièges sociaux de nombreuses organisations internationales, comme l’OMS, l’ONUSIDA ou encore l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). On constate aussi certaines coupes aux Etats-Unis, puisque de nombreuses structures jusque-là financées par l’USAID y sont domiciliées.
Projets initialement soutenus par l’USAID dont le financement a été arrêté ou maintenu en 2025
En vous déplaçant et zoomant sur ce globe, visualisez les 3 000 actions humanitaires et de développement concernées par le gel des subventions américaines cette année
Au moins 19 organisations françaises sont également touchées. « On a été choqués quand on a appris que tous nos projets allaient être réévalués », confie Kevin Goldberg. Directeur général de l’ONG française Solidarités International, il raconte que son organisation a reçu, fin janvier, des courriels lui demandant de suspendre immédiatement tous les projets financés par l’agence américaine.« L’USAID représentait 33% de nos financements, et on avait envisagé que ce serait 35 à 36% de notre budget de 2025. Ce sont des millions de dollars qui ont été gelés d’un coup », explique-t-il.
Si le gouvernement américain a envoyé des lettres autorisant la reprise de certaines activités en février, surtout dans des zones où l’aide a été jugée « vitale »par Washington, comme au Soudan, il en a totalement annulé d’autres. C’est notamment le cas au Mozambique, où Solidarités International mène différents projets d’aide humanitaire et des chantiers de plus long terme, comme l’accès à l’eau ou la relance agricole. « On estime qu’entre 150 000 et 200 000 personnes sont affectées par ces coupes », explique Mathieu Vernusse, directeur de l’ONGdans le pays. L’un de ses bureaux s’apprête à fermer, et 90 de ses 140 employés seront licenciés.
« On a dû refuser certains enfants »
Même pour les projets épargnés par l’administration Trump, les difficultés restent nombreuses. Comme d’autres organisations, Action contre la faim (ACF) a reçu en février plusieurs lettres de la part de l’USAID annonçant que certains financements précédemment annulés allaient finalement être rétablis. L’agence s’y engageait à rembourser les frais avancés pendant la période de gel, ainsi qu’à verser les montants prévus pour le reste de l’année. Pourtant, l’ONG française, qui a décidé de poursuivre certaines opérations vitales pendant la période de gel des financements, attend toujours les fonds promis. « Ils nous doivent trois mois de remboursement et n’ont toujours pas versé les financements du deuxième trimestre. On a avancé plusieurs dizaines de millions de dollars : c’est un risque financier énorme », explique Elodie Andrault, directrice des opérations.
En RDC, où 70% de l’aide humanitaire était financée par les Etats-Unis au début de l’année, la situation est critique. Ravagé par des conflits intracommunautaires qui se sont intensifiés ces derniers mois, le pays fait face à l’une des pires crises humanitaires au monde : plus d’un quart de la population souffre de faim aiguë, selon l’ONU. Dans ce contexte, 102 projets financés par l’USAID ont été suspendus, avant que 58 ne soient finalement relancés. « On a pris le relais pour fournir des médicaments, payer les salaires dans les centres de santé… Mais on ne pouvait pas tout couvrir », témoigne Florian Monnerie, chef de mission d’ACF dans le pays. Sur le terrain, les équipes sont contraintes à des arbitrages douloureux. « On a dû refuser certains enfants en situation d’urgence dans nos centres de santé », précise-t-il. L’humanitaire évoque une hausse de la mortalité infantile, ainsi qu’une chute de la fréquentation des structures et des dizaines de salariés licenciés.
Un contributeur difficile à remplacer
Les bailleurs capables de combler de vide laissé par l’USAID ne sont pas nombreux. Principal pilier de l’aide publique américaine, l’agende de développement plaçait les Etats-Unis au sommet des pays donateurs dans le monde. En 2023, Washington a déboursé plus de 62 milliards de dollars (56 milliards d’euros) pour de l’aide au développement, un montant qui inclut les fonds versés par l’USAID mais aussi par d’autres agences américaines. C’est presque deux fois plus que l’Allemagne, deuxième contributeur mondial cette année-là.
« Des bailleurs capables de financer des projets à 10 millions d’euros, il n’y en a pas beaucoup à part les Etats-Unis », confie à franceinfo Marion Santi, chargée de mission au Gret. L’ONG française, spécialisée dans l’assainissement et l’accès à l’eau, a dû interrompre un contrat de quatre ans destiné à améliorer les conditions sanitaires dans trois grandes villes de Madagascar. Une mission pourtant essentielle pour réduire la mortalité, selon l’humanitaire, « sidérée et dégoûtée » de devoir y mettre fin. L’ONG tente de trouver un nouveau financeur, mais l’espoir est mince : « Je ne me fais pas d’illusions : même si un autre bailleur reprend le projet, il faudra forcément revoir nos ambitions à la baisse. »
Chercher des nouveaux financeurs est d’autant plus difficile que les Etats-Unis ne sont pas les seuls à couper dans leurs budgets : de nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne ont, eux aussi, annoncé des réductions significatives de leur aide au développement cette année. Début avril, seule la Norvège a débloqué en urgence près de 27 millions d’euros pour aider les ONG mises à mal par le retrait des financements américains. Une somme bien trop faible pour remplacer les subventions des Etats-Unis, et qui ira en priorité aux organisations norvégiennes. Oslo a également annoncé une enveloppe annuelle d’environ 162 millions d’euros à destination de six ONG, sur une période de cinq ans.
A Paris, dans les locaux d’Action contre la faim, Elodie Andrault dit être « dans le brouillard total ». Elle multiplie les rendez-vous pour tenter de trouver d’autres sources de financement, avec grande difficulté. « Aucun de nos gros bailleurs ne s’est dit prêt à compenser. On tente avec des fondations privées, on a même lancé une collecte publique… Mais pour l’instant, rien ne compense les pertes. »