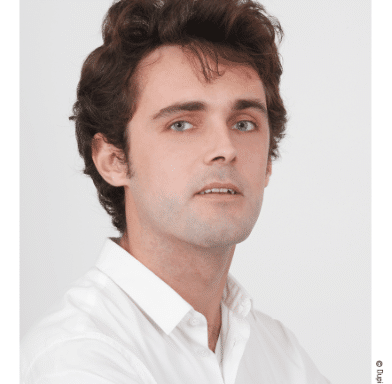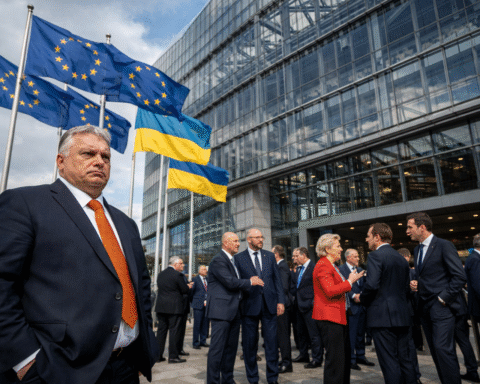Cette espèce originaire d’Australie a colonisé une partie du pourtour méditerranéen, avec des conséquences néfastes pour la biodiversité locale.
Un rayon de soleil dans un décor hivernal. Le long des routes du sud de la France, les petites boules jaunes du mimosa d’hiver égayent et parfument les trois premiers mois de l’année, pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Mais l’Acacia dealbata – son nom scientifique – ne fait pas que des heureux. Outre les allergies qu’il peut causer(Nouvelle fenêtre), « le mimosa nous pose beaucoup de soucis. Il a des impacts importants sur nos écosystèmes », alerte Camille Casteran, chef du secteur continental du Parc national de Port-Cros, dans le Var. La plante a même été inscrite sur la liste noire des espèces exotiques envahissantes(Nouvelle fenêtre) par le Conservatoire botanique méditerranéen de Porquerolles.
L’emblème de la Côte d’Azur vient en réalité de très loin. Le mimosa d’hiver est originaire d’Australie. Il a ensuite été introduit en Angleterre dès 1792 pour ses qualités ornementales et olfactives, selon le Centre de ressources des espèces exotiques envahissantes(Nouvelle fenêtre). La plante est cultivée en France à partir du milieu du XIXe siècle, et elle est observée dans le milieu naturel à Cannes (Alpes-Maritimes) dès 1864. Son succès est fulgurant, notamment chez les parfumeurs de Grasse qui vont massivement l’utiliser dans leurs flacons. La ville est aujourd’hui reliée à Bormes-les-Mimosas (qui n’était que « Bormes » jusqu’en 1968) par la célèbre « route du mimosa ».
Colonisation express
Mais quand le mimosa débarque dans une région et qu’il s’y plaît, il prend vite toute la place. Dans les Alpes-Martimes et dans le Var, la présence de cette plante peut ainsi concurrencer d’autres espèces remarquables et patrimoniales, assurent les scientifiques. Le mimosa d’hiver émet également des substances toxiques qui limitent la croissance racinaire de la végétation aux alentours. « Cette plante est monospécifique sur la zone qu’elle colonise, donc seule cette espèce va se développer », explique Camille Casteran, qui tente de conserver « l’écosystème méditerranéen ».
Certains animaux en font aussi les frais dans la région, comme la tortue d’Hermann, l’un des reptiles les plus menacés à l’échelle européenne et mondiale. « Le recouvrement de ces milieux par le mimosa est problématique parce que [la tortue] a besoin d’espaces ouverts pour son alimentation à base d’herbacés, renchérit le botaniste. Pour la ponte aussi, il faut que les œufs soient exposés à l’ensoleillement. »
Et ce n’est pas près de s’arrêter. Pour réussir cette colonisation express, le mimosa dispose de plusieurs vecteurs de reproduction. Les insectes et la pollinisation, bien sûr, mais aussi les drageons, des rejets qui se développent non pas à partir d’une graine, mais d’une simple racine. Tailler ou couper le mimosa est donc inutile, voire contre-productif.
Les équipes du parc national sont donc obligées d’activer les grands moyens pour tenter de limiter sa propagation. D’abord, une coupe, puis dans la foulée, les employés dessouchent les plants à l’aide d’une mini-pelle mécanique. Et ce n’est pas fini. Un long et fastidieux travail au piochon doit encore être réalisé pour arracher tous les rhizomes oubliés. « C’est un travail colossal qui demande énormément de temps et d’agent », souffle le chef de secteur. Des chantiers bénévoles d’arrachage sont régulièrement organisés dans la région(Nouvelle fenêtre).
« Une poudrière sur pieds »
En plus d’être envahissant et résistant, le mimosa ne craint pas le feu. Au contraire. C’est une espèce pyrophile, c’est-à-dire que sa reproduction est stimulée par le feu. Et la plante peut elle-même favoriser la propagation des incendies.
Face au risque important de feu de forêts dans les régions sèches du sud de la France, des obligations légales de débroussaillement ont été mises en place par les autorités. Tous les particuliers des zones concernées doivent s’y plier autour de leurs habitations. Mais, là encore, le mimosa y trouve son compte. « Il est très friand de ces espaces mis à nu », poursuit Camille Casteran. « Dès qu’un débroussaillement est effectué, le mimosa s’implante de manière efficace et il est ensuite compliqué de l’en déloger. »
« Les humains ont un rôle à jouer »
Malgré sa résistance, pas question de lui mener la vie dure avec des désherbants dans les parcs nationaux. « On a abandonné les méthodes chimiques, explique Camille Casteran. Le but, ce n’est pas de tout détruire autour », assure-t-il. Un nouvel allié a tout de même fait son apparition dans le parc pour aider les équipes dans leur travail en période de disette budgétaire : un âne. « Il faut qu’il n’y ait rien de plus appétant pour lui autour, et cela nous permet de bien limiter les populations de mimosa », se félicite le chef de secteur.
Pour les particuliers, amateurs de ses jolies boules jaunes, il n’existe pas de restrictions légales concernant cette plante. « Elle n’est pas réglementée, donc on peut continuer à l’utiliser, l’acheter et la vendre », confirme Arnaud Albert, référent national des plantes exotiques envahissantes. Certaines pépinières proposent également des variétés obtenues en culture qui ont des racines moins puissantes et invasives. « Il ne s’agit pas de faire la guerre à une plante, mais les humains ont un rôle à jouer pour préserver les milieux naturels », prévient Arnaud Albert.