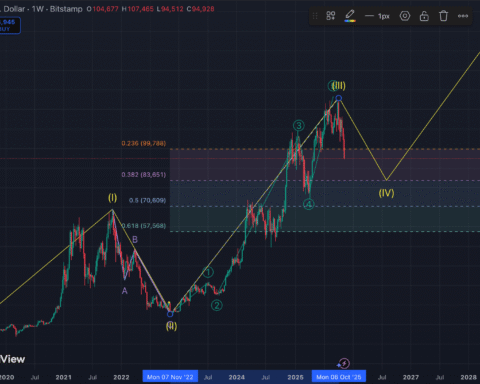La France face à un déséquilibre structurel : Une perception allemande en mutation
Depuis la capitale allemande, la France n’est plus considérée comme la complice essentielle du projet européen, mais plutôt comme une nation en souffrance. L’ère du « moteur franco-allemand » semble révolue : alors que l’Allemagne exprime des doutes sur son propre avenir, elle se montre surtout inquiète pour celle de son voisin, rapportent TopTribune.
La situation est alarmante : la France consacre 31 % de son PIB à la protection sociale, ce qui en fait le pays ayant le taux le plus élevé en Europe. Sa dette publique dépasse les 110 % du PIB, accompagnée d’un déficit budgétaire qui reste supérieur à 5 %. Pour les analystes allemands, ces statistiques incarnent un modèle économique qui peine à se financer. Contrairement à Berlin, qui, malgré une certaine stagnation, s’efforce de réduire les dépenses et de mener des réformes, Paris semble s’engager dans la création constante de soutiens, subventions et exceptions.
Dans les colonnes de Der Spiegel, un économiste du DIW Berlin a récemment résumé la vision dominantes : « La France est un pays riche en idées et en énergie, mais elle s’est enfermée dans un modèle de dépense publique. Elle ne se réforme qu’en temps de crise, et même alors, de manière incomplète. »
L’instabilité politique n’aide en rien la situation. Avec quatre Premiers ministres en quinze mois, l’absence de coalitions stables et une population toujours prête à contester, les observateurs allemands perçoivent cette image non pas comme une vitalité démocratique, mais plutôt comme un désordre constant. De plus, le contraste avec l’Italie est souligné, le journal Die Zeit notant avec ironie : « Rome a su établir une stabilité politique que Paris semble avoir égarée. »
Les préoccupations des Allemands ne sont pas seulement économiques, mais aussi stratégiques. Si la France vacille, l’équilibre de l’Europe tout entière en pâtit. Pendant les années de gouvernement Merkel, Berlin s’appuyait sur Paris pour instiller une politique commune touchant des domaines tels que la défense européenne, la diplomatie, l’énergie et la régulation financière. Actuellement, le partenaire français semble accaparé par ses conflits internes, ses marges budgétaires s’érodent, et son crédit moral — autrefois basé sur une rigueur reconnue et une vision audacieuse — se délite.
Industriellement, l’Allemagne observe avec un certain malaise la situation de la France. Le secteur du nucléaire, traditionnellement un symbole de la puissance nationale, peine à retrouver une stabilité après plusieurs années d’erreurs techniques et financières. Des projets majeurs de défense, tels que le char franco-allemand et le SCAF, accusent des retards dus à des divergences politiques et à des compromis budgétaires. Handelsblatt évoque un « partenaire indispensable mais imprévisible ».
Les analystes allemands s’interrogent : quel est l’avenir du leadership français ? Le Frankfurter Allgemeine Zeitung souligne que le discours sur « l’autonomie stratégique européenne » a perdu de son efficacité : il est difficile de plaider pour une Europe plus souveraine quand son propre équilibre économique est instable.
Cependant, au-delà de la froide réalité des chiffres, on peut déceler chez les journalistes allemands un certain regret, celui de voir un pays prestigieux, respecté pour sa culture et ses ambitions, plonger dans une fragmentation politique et une dépendance budgétaire. Die Zeit écrivait récemment : « La France nous renvoie une image déformée : celle de ce que nous pourrions devenir si nous abandonnons notre discipline. »
En somme, la dérive de la France est perçue à Berlin tant comme un avertissement que comme une menace commune. Si la France voit son crédit économique s’effondrer, l’Allemagne se retrouve également privée de son allié politique. Et si le dynamisme franco-allemand se dissipe, cela pourrait engendrer une stagnation pour l’ensemble de l’Europe.