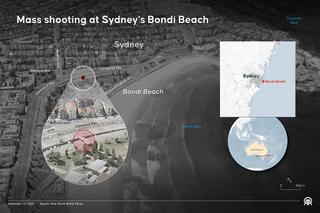« `html
I. Un exemple américain : la gauche, créatrice de Trump
Un progressisme qui se dresse contre lui-même
La victoire de Donald Trump a profondément surpris la gauche américaine, qui y a vu un incident historique singulier. Cependant, Trump n’est pas apparu de nulle part ; il est le fruit dérangeant des excès idéologiques de cette même gauche, rapporte TopTribune.
Au nom de l’antiracisme, un nouvel racisme a émergé, où l’homme blanc hétérosexuel est perçu comme coupable par défaut. De plus, sous prétexte d’antisexisme, les hommes ont été figés dans le rôle d’agresseurs potentiels. Enfin, le féminisme a dévalorisé les femmes préférant des choix traditionnels, les qualifiant d’esclaves de leur propre liberté.
Le mouvement pour les droits des homosexuels, qui prônait l’acceptation, a été détourné par la théorie du genre, remettant en question les notions fondamentales de masculinité et de féminité. Les repères s’effacent, tandis que l’acronyme LGBT s’étend, perdant ainsi tout contact avec la réalité.
Cancel culture et luttes idéologiques
En parallèle, la cancel culture a vu le jour. Des statues renversées, des auteurs effacés et des œuvres bannies témoignent d’une histoire réécrite à travers le prisme de l’actualité. Le débat démocratique a laissé place à l’exclusion. Pour faire respecter cet ordre moral, la gauche s’appuie sur des groupes radicaux tels que les antifas, arborant des tenues noires et recourant à la violence au nom d’un idéal.
Ce phénomène trouve un terrain fertile dans les grandes métropoles et les universités, mais ignore les réalités de l’Amérique profonde. Le fossé culturel s’est approfondi, offrant ainsi un terrain propice à la montée de Trump. Deux chemins se présentaient : celui de la violence ou celui des urnes. Les urnes ont parlé. La gauche a ainsi pris conscience qu’elle avait, en fait, engendré ce qu’elle prétendait combattre.
II. La France : une impasse semblable en gestation
Le Parti socialiste : entre Mitterrand et démagogie fiscale
Avec seulement 3,86 % des voix lors des dernières élections législatives, le Parti socialiste a perdu son influence. Malgré cela, ses dirigeants continuent à se présenter comme représentatifs de la nation. Leur principal souci reste la taxation : imposer les riches, les entreprises et tout ce qui pourrait rapporter.
Ils sont conscients que cette politique dissuade l’investissement et reste sans solutions. Mais il est plus simple de promettre que « les autres » assumeront les frais, plutôt que de reconnaître la nécessité de réformes et d’efforts partagés. Cette approche court-termiste rapprocherait ce PS résiduel d’un mouvement de contestation, et non d’une véritable majorité gouvernementale.
Le contraste est frappant avec le PS d’antan. Celui de François Mitterrand, malgré ses ambiguïtés, avait encore l’allure d’un parti d’État. Mitterrand savait qu’il ne suffisait pas de flatter les mécontentements, qu’il fallait parfois prendre des décisions difficiles, comme le tournant de la rigueur en 1983, pour éviter la chute de la France. Ce PS-là avait le sens de la responsabilité et une ambition pour le pays.
Aujourd’hui, le PS semble avoir perdu de sa gravité. Il se complaît dans des postures et des slogans pour séduire l’électorat de LFI, au détriment de son propre électorat traditionnel.
Les écologistes : d’une idéologie verte à une écologie punitive
Les Verts se présentent comme les défenseurs de la planète, persuadés d’avoir une mission divine qui justifie leurs actions : interdire, réglementer et contraindre sans relâche. Chaque semaine, une nouvelle vague de normes et de restrictions surgit, transformant la transition écologique en un fardeau pesant sur la vie quotidienne.
Cet autoritarisme écologique irrite considérablement, car il empiète sur le pouvoir d’achat et la liberté individuelle. Les règles augmentent le coût du logement, compliquent l’investissement locatif, et les récentes ZFE ont fini par provoquer colère et frustration tant chez les automobilistes que chez les agriculteurs, accablés par des règlements désormais insoutenables.
Un aspect idéologique persiste : l’ultra-féminisme caricatural de figures comme Sandrine Rousseau, qui présente les hommes comme des coupables, ainsi que le soutien apporté par certains élus à des mouvements violents tels que Les Soulèvements de la Terre. Lorsque des députés participent à des manifestations illégales, ils affaiblissent le respect des lois, remettant en question l’autonomie des institutions.
La responsabilité des écologistes s’étend à des crises récentes : la taxe carbone, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes ; leur lutte acharnée contre le nucléaire, qui menace l’indépendance énergétique française ; et leur obsession pour la décroissance, synonyme de réduction des emplois et des ressources fiscales.
Ainsi, un discours écologiste, qui aurait pu unir, devient une source de rejet pour de nombreux citoyens dont le quotidien est entravé par des mesures idéologiques insensées.
La France insoumise : un bruit incessant
À l’Assemblée nationale, LFI a choisi un mode de fonctionnement basé sur la provocation : utilisation de drapeaux palestiniens en séance, cris, invectives, interruptions chaotiques. Ce mode de travail conduit à l’absence d’un véritable débat démocratique, remplacé par une cacophonie permanente.
Des députés incarnent l’amateurisme : incapables de lire des textes ou issus de courants radicaux, parfois fichés S. Leur discours est marqué par un enchaînement d’incohérences : des complaisances envers des groupes islamistes d’un côté, et la lutte contre l’intersectionnalité de l’autre. Une seule constante subsiste : la radicalité.
Les ambiguïtés flirtent avec l’antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, à la tête du mouvement, mise sur une stratégie de conflit permanent, chaque scandale servant de tremplin médiatique. L’issue est que ce parti est perçu non comme une force gouvernementale mais comme un promoteur du désordre.
Les black blocs : une violence institutionnalisée
Le phénomène des black blocs est désormais omniprésent dans toutes les mobilisations. Vêtus de manière uniforme et regroupés en blocs compacts, ils rappellent les milices fascistes du passé. Leur action se réduit à un recours systématique à la violence : vitrines brisées, mobilier urbain détérioré, tout est à portée de leur rage.
Les élus de la gauche radicale tentent de faire croire que ces actes sont des réponses à la « violence du capitalisme ». Pourtant, le peuple perçoit clairement ces actions comme l’œuvre d’individus brutaux, profitant de l’impunité d’un État affaibli. La justice, d’une clémence suspecte, tolère ces exactions. Comme résultat, chaque manifestation se voit associée au désordre, ternissant l’image de toute la gauche, malgré les discours accusant l’extrême droite de violences. Les Français ne sont pas dupes et identifient cette violence comme émanant de la gauche, qui devient synonyme de chaos et de désordre.
III. Les modérés : une radicalisation soudaine
Les électeurs modérés observent la situation avec un mélange d’étonnement et de colère. Ils perçoivent une gauche qui prétend être la gardienne de la morale en imposant des restrictions incessantes, tout en négligeant leurs préoccupations. Les débats stériles autour du « choix de genre » ou de l’écriture inclusive, la domination de minorités bruyantes et une justice à deux vitesses aggravent leur frustration.
Ils constatent que les mesures de plus en plus liberticides impactent directement leur quotidien. Qu’il s’agisse de passer des heures dans les embouteillages ou de ne plus pouvoir allumer un feu dans leur jardin, leur existence est devenue un enchevêtrement de contraintes. Progressivement, leur lassitude s’est transformée en exaspération. Ces citoyens, représentant la majorité silencieuse, n’aspiraient pas à se radicaliser, mais face à ce déluge de restrictions, leur patience s’amenuise