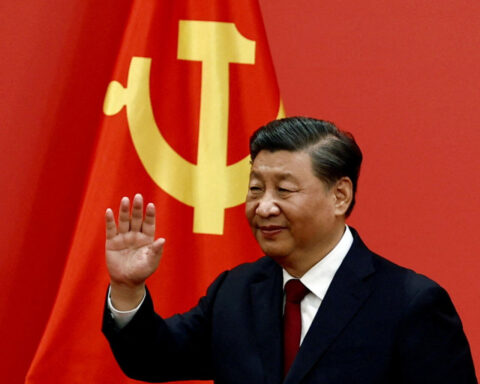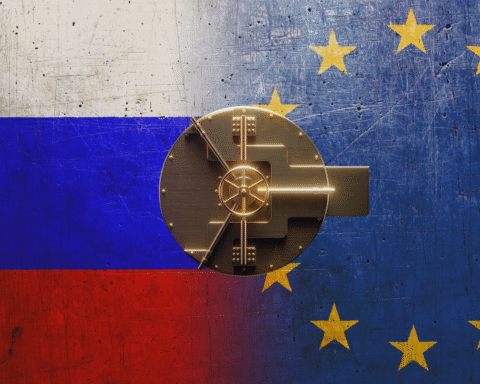Depuis le début de l’année 2024, une nouvelle réglementation a profondément modifié le paysage de l’emploi en France. Les travailleurs en CDD et en intérim risquent de voir leurs droits à l’indemnisation chômage annulés s’ils refusent deux offres de CDI pour des postes similaires. Cette décision, ratifiée par le Conseil d’État le 18 juillet 2025, a suscité des controverses concernant ses impacts sur le plan social et économique, rapporte TopTribune.
Le cadre légal et ses fondements
Cette règle découle de la loi « Marché du travail », adoptée le 21 décembre 2022. Elle s’appuie sur les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du Code du travail, lesquels stipulent que les propositions de CDI doivent être comparables au contrat existant en termes de rémunération, de durée de travail, de classification et de localisation. Ces critères visent à assurer des conditions équitables pour les employés concernés.
Des syndicats tels que FO, CGT, FSU et Solidaires ont vivement critiqué cette mesure, la considérant comme une atteinte à l’égalité d’accès à l’assurance chômage. Ils la voient comme une incitation au travail forcé, tout en portant atteinte à la dignité des salariés et à leur droit à un recours effectif. Selon ces organisations, une telle pression pourrait forcer les employés à accepter des CDI, équivalant à une forme d’exploitation.
La réaction du Conseil d’État et les procédures impliquées
Le Conseil d’État a rejeté les réclamations des syndicats, affirmant qu’aucune violation des droits fondamentaux n’a été observée. Il a souligné que les refus de CDI devaient être notifiés à France Travail, sans automatiquement entraîner la perte des droits au chômage. L’application de l’article L. 5422-1 du Code du travail doit rester inaltérée, sans aucune question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Les employeurs doivent accorder un délai raisonnable aux salariés pour accepter les offres de CDI. En l’absence de réponse, cela sera interprété comme un refus tacite, France Travail étant responsable d’informer le salarié des répercussions potentielles de son choix. En outre, les employés peuvent avancer des raisons légitimes pour justifier leur refus, malgré l’absence d’une liste officielle d’accptabilité, dans le cadre d’une réduction des indemnités journalières.
Les ramifications et les impacts sociaux
Avec la validation de cette décision par le Conseil d’État, le dispositif est appliqué sans délai : des refus répétés peuvent mener à une suspension des allocations chômage, en lien avec la réforme de l’assurance chômage. France Travail joue un rôle clé dans l’évaluation des refus pour déterminer si les droits des travailleurs doivent être conservés ou annulés après examen.
Cette mesure marque un tournant significatif dans la politique de l’emploi en France, visant à rendre les demandeurs d’emploi plus responsables dans le cadre de la réforme du système de sanctions. Néanmoins, cela alimente toujours les débats, notamment sur ses conséquences pour la sécurité financière des travailleurs vulnérables.
Les responsabilités des employeurs et le rôle de France Travail
Les employeurs sont tenus de transmettre officiellement leurs propositions de CDI, avec preuve d’envoi et de réception, et de spécifier le délai accordé pour répondre. En cas de refus ou d’absence de réponse, ils doivent notifier France Travail dans un délai d’un mois.
Ensuite, France Travail informe le salarié des conséquences potentielles, y compris la perte possible des allocations chômage, et détermine si le motif avancé pour le refus peut être jugé légitime.