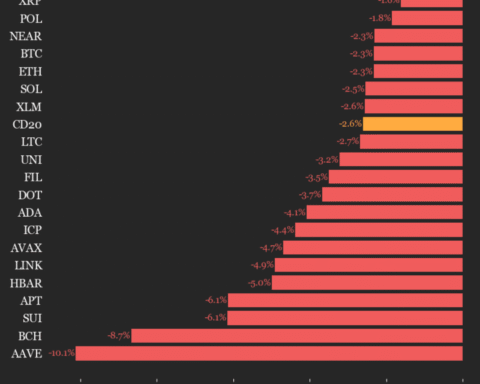Diplômé de HEC, Valentin Drouillard a débuté sa carrière en tant que consultant au sein du cabinet Accuracy avant de fonder Armtek en 2018. Située à l’intersection de la défense et de l’innovation technologique, cette start-up stratégique vise à améliorer les capacités opérationnelles des armées et à renforcer la performance industrielle du secteur. Suite à son intervention à la table ronde « Industrie et forces armées : nouvelles formes de dialogue » lors de La REF 2025, nous avons eu l’occasion d’échanger sur l’importance d’un dialogue renouvelé entre les armées et les industriels, rapporte TopTribune.
Pouvez-vous décrire le contexte de votre intervention lors de La REF 2025 et les enjeux de cette table ronde ?
Valentin Drouillard : La table ronde « Industrie et forces armées : nouvelles aires de dialogue et d’intérêts » s’inscrit dans un cadre où l’intensification des menaces et la complexification des technologies transforment en profondeur les modalités de la guerre moderne. Son objectif était d’explorer comment rapprocher les armées et les entreprises industrielles pour co-développer des solutions plus efficaces et adaptables. Pour moi, l’enjeu était aussi de faire le point sur les actions concrètes d’Armtek visant à faciliter ce dialogue, tout en rendant accessibles les méthodes et connaissances militaires aux acteurs industriels, afin de générer de la valeur tant opérationnelle qu’économique.
Il a été beaucoup question de la nécessité d’établir un langage commun entre les armées et l’industrie. Pourquoi cela est-il si important aujourd’hui ?
VD : Nous avons des façons de penser et de communiquer très différentes. Les entreprises mettent l’accent sur l’efficacité : répondre à un marché, créer une valeur pérenne, satisfaire un besoin. En revanche, les forces armées visent des objectifs bien distincts : protéger le pays, gérer les risques et neutraliser les menaces. En somme, d’une part il y a l’efficacité commerciale et de l’autre l’efficacité vitale. Ces différences de perspective influencent les modes d’action. De plus, chaque secteur évolue dans son propre cadre, avec ses spécificités, ses acronymes et ses règles internes, ce qui conduit souvent à des malentendus. Par exemple, la TVA est perçue différemment : pour une société, c’est une simple obligation fiscale ; pour une administration, c’est une perte budgétaire. Ces incompréhensions compliquent les relations.
Comment surmonter ces malentendus ?
VD : La solution réside dans une analyse méticuleuse des pratiques et des réalités sur le terrain. Notre démarche repose sur une exploration approfondie : nous réalisons de nombreux entretiens et immersions pour appréhender les défis et méthodes des différents acteurs. Cette collecte de connaissances permet ensuite de concevoir des outils simples, clairs et immédiatement utilisables. Ainsi, chaque partie impliquée peut se retrouver dans ses propres réalités : les industriels acquièrent une meilleure compréhension des contraintes militaires, tandis que les armées accèdent à un langage commun qui facilite le dialogue. Cette méthode a pour effet de tisser des liens concrets et durables, en dissipant les malentendus.
La table ronde a également abordé l’importance de nouvelles formes de collaboration. Comment envisagez-vous ces évolutions ?
VD : Nous devons dépasser les approches purement transactionnelles. Le processus traditionnel, qui consiste à rédiger un besoin opérationnel, le traduire en spécifications techniques puis le confier à un industriel, peut fonctionner pour des systèmes tels que des sous-marins ou des avions de chasse. Cependant, il n’est pas adapté aux technologies émergentes comme les drones, l’intelligence artificielle ou les solutions numériques. Ce qu’il faut développer, c’est une relation de travail collaborative. Il est crucial de tester ensemble, d’itérer rapidement et d’intégrer en continu les retours d’expérience. Il convient de voir le besoin non pas comme une certitude, mais comme une hypothèse à valider ensemble : les forces apportent leur connaissance du combat, l’industrie sa maîtrise technologique. Ce type de synergie produit des solutions plus adaptées et rapides à mettre en œuvre.
Vous soulignez l’importance des données dans ce nouveau cadre. Pourquoi sont-elles si déterminantes ?
VD : La donnée représente le langage commun par excellence. Trop souvent, les informations sont cloisonnées dans des systèmes d’information, des documents et des bases de données, ce qui ralentit le processus et complique la transformation. L’automatisation devient alors impossible. Il est impératif d’adopter une approche intégrée, où chaque stade — besoin, expérimentation, emploi, maintenance — est interconnecté et actualisé en temps réel. La donnée sert à dépasser les perceptions : elle objectivise la valeur, nourrit des rétroactions et simplifie les collaborations. En d’autres termes, la donnée se transforme en capacité, celle-ci en disponibilité, et la disponibilité en rentabilité. C’est le fondement d’un langage partagé entre les forces et l’industrie. C’est précisément la mission d’Armtek : transformer la donnée en impact opérationnel.
Enfin, il subsiste le défi de l’extension de ce modèle. Comment trouver un équilibre entre innovation et masse dans un contexte de ressources limitées ?
VD : C’est tout le défi de la guerre 4.0 : innover tout en produisant à grande échelle, marier évolutivité et volume. En France, nous savons faire preuve d’innovation, mais nous éprouvons davantage de difficultés à produire rapidement et en quantité. Il est donc nécessaire de réorienter notre logique. En temps de paix, nous devons financer la capacité à augmenter rapidement nos ressources, plutôt que de simplement investir dans l’armement lui-même. Autrement dit, il faut démontrer que nous sommes capables de produire des chars rapidement si la situation l’impose, ce qui constitue un message dissuasif puissant. En temps de guerre, l’acceptation du sacrifice, de la réquisition et de la mobilisation devient essentielle. C’est le prix à payer pour assurer la sécurité et la souveraineté.
Conclusion :
Comme l’ont souligné les intervenants de la table ronde aux côtés de Valentin Drouillard, notamment Isabelle Fraine (Google Cloud), Pierre Barnabé (SOITEC) et le général Baratz (CCF), « ces échanges doivent s’inscrire dans la durée ». Dans le contexte de bouleversements géopolitiques et de l’accélération des évolutions technologiques, il est primordial de repenser les relations entre les armées et les industriels. Pour l’armée, cela implique de réformer ses structures et d’exploiter au mieux l’efficacité industrielle ; pour les entreprises, cela signifie saisir les enjeux de la guerre moderne et y répondre avec agilité. Par le biais d’Armtek, Valentin Drouillard s’engage concrètement dans cette voie : établir un langage commun, rapprocher méthodes et connaissances, et transformer l’intelligence collective en une véritable capacité opérationnelle au service de la défense et de la souveraineté française.