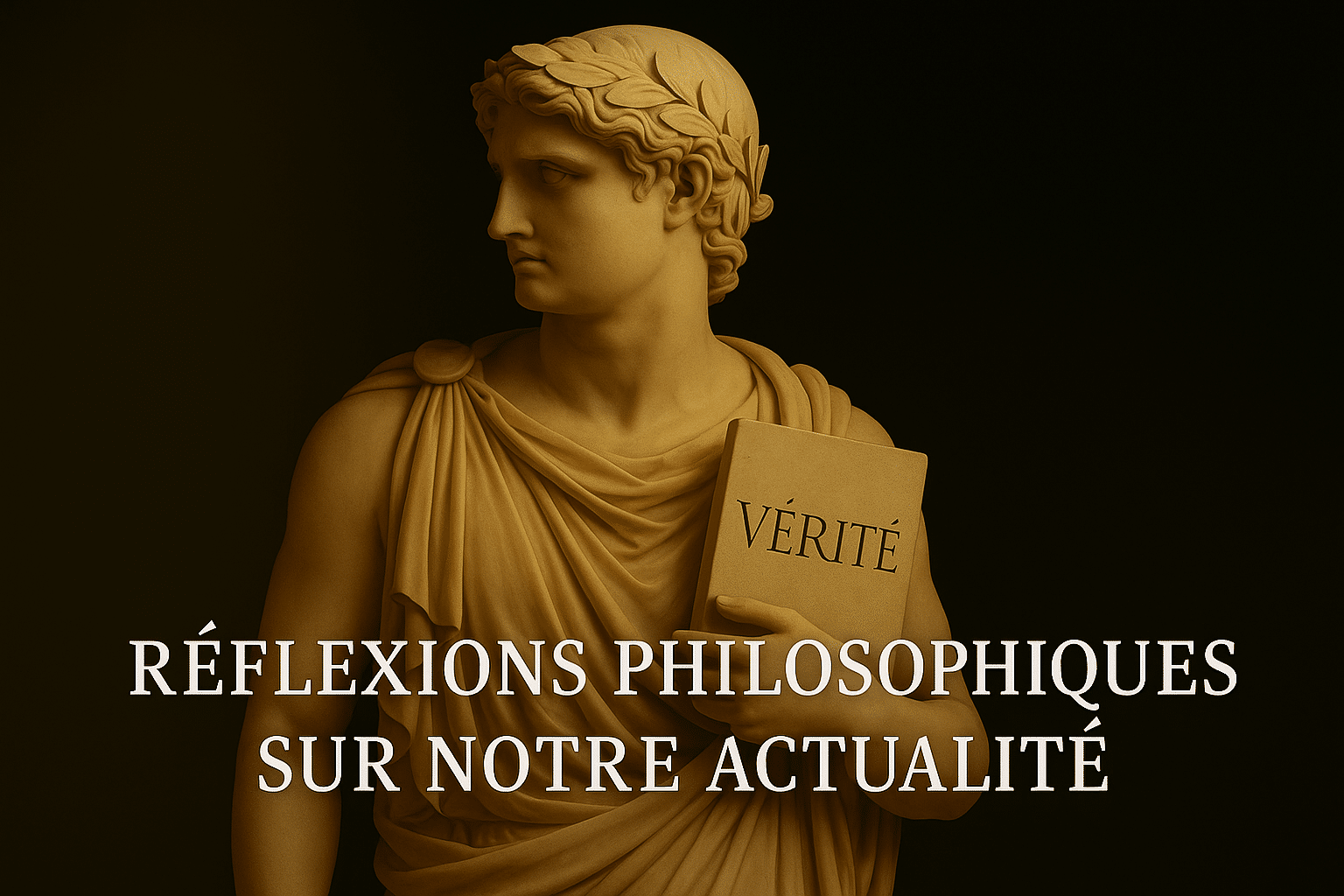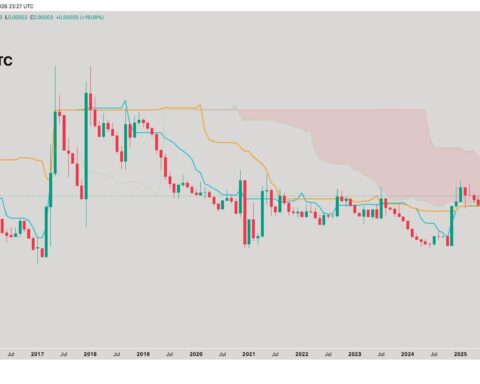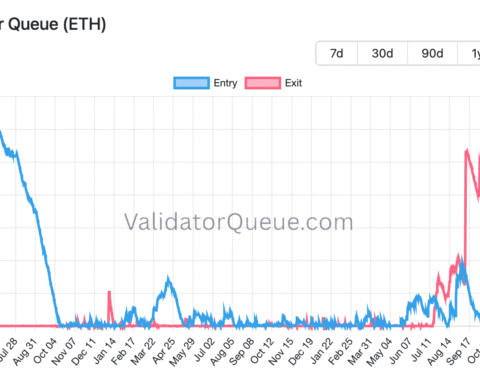La tentation de réduire l’économie à de simples chiffres et formules est omniprésente. Croyre qu’un impôt peut être résolu sur un tableur Excel et voté lors d’un amendement en séance nocturne est une erreur fondamentale. La fiscalité touche à la métaphysique de notre société. Elle révèle notre identité, ce que nous considérons comme juste et la direction que nous désirons emprunter ensemble. C’est pourquoi la proposition de Gabriel Zucman ne se limite pas à un cadre fiscal, mais s’inscrit dans le domaine de la philosophie politique. Derrière l’idée d’une taxe sur les “ultra-riches” se cache un projet ambitieux visant à redéfinir la relation entre l’État, l’économie et les citoyens, rapporte TopTribune.
I. Du pouvoir gestionnaire au pouvoir créateur : Marx, Gramsci, Holloway
Pour Marx, l’État ne fait que gérer des relations de pouvoir qui le dépassent. Gramsci souligne que la force seule ne suffit jamais ; celui qui détient le pouvoir durablement ne se contente pas de gouverner les institutions, mais il contrôle également les esprits. L’hégémonie culturelle consiste à imposer une vision du monde, jusqu’à ce qu’elle devienne une évidence. Ainsi, le pouvoir réel se déplace des ministères vers l’imaginaire collectif. La conquête du pouvoir commence par la bataille des idées, qui précède l’accès au pouvoir étatique. Dans son ouvrage Change the World Without Taking Power, John Holloway avance que le contre-pouvoir réside dans le peuple qui refuse et lutte. Le pouvoir d’action, celui qui génère le changement, prend le pas sur le pouvoir de domination. Zucman s’inscrit dans cette lignée. Il ne cherche pas à accéder au pouvoir ; il est conscient que sa taxe n’aboutira pas réellement et qu’elle est davantage un acte de communication politique. Il tente de créer une tension morale : le peuple spolié contre les privilégiés. C’est dans cette lutte d’idées que se situe le véritable acte politique. Comme l’affirmait Hannah Arendt, toute révolution est le fruit d’un renversement des jugements collectifs sur ce qui est acceptable.
II. Quand l’égalité devient théologie : Rousseau, Tocqueville, Berlin
La proposition de Zucman ne constitue pas un système fiscal traditionnel, mais une vision égalitaire radicale. En suivant la logique de Rousseau, la propriété privée pose une fracture qu’il est nécessaire de rétablir constamment. Plutôt que de réduire la pauvreté, qui a été en grande partie maîtrisée par les sociétés modernes, l’accent doit être mis sur la réduction des écarts perçus, ceux qui blesse notre sensibilité démocratique. Tocqueville avait prévu que cette passion pour l’égalité pourrait amener les gens à préférer une servitude égalitaire à une liberté inégale. Zucman est explicite : il ne cherche pas à accroître les richesses des moins nantis, mais à diminuer celles des plus fortunés. Cela relève d’une politique basée sur le ressentiment, dans le sens nietzschéen. L’émotion dominante devient alors celle de la haine de la réussite d’autrui. Isaiah Berlin nous rappelle que vouloir assigner à autrui une “juste place” peut conduire à des moyens coercitifs. Dans ce contexte, la fin justifie les moyens, qu’il s’agisse de confiscation, de contrainte ou d’une humilité imposée aux “gagnants”.
III. Emotionnaliser l’économie pour rendre possible l’impossible
Pourquoi défend-on une taxe que Zucman sait inapplicable ? La réponse réside dans une visée politique : provoquer un choc moral. L’économie devient alors une scène où s’expriment les passions démocratiques. On dépeint un tableau où les pauvres supportent tout le poids et où les riches échappent à leurs obligations, en dépit des données montrant le contraire. L’objectif ici n’est pas l’exactitude, mais l’impact émotionnel. Nietzsche nous rappelle que “l’art est là pour nous préserver de la mort de la vérité.” Dans cette optique, l’art réside dans la provocation astucieusement orchestrée. En mettant la fiscalité au cœur du débat national, Zucman déplace les enjeux politiques : on ne débat plus d’efficacité, mais de vertu ; pas de prospérité, mais de pureté morale. C’est une technique gramsciste : utiliser l’économie pour transformer les mentalités avant même que l’économie ne soit modifiée. En remettant en question la légitimité des entrepreneurs, vilipendés en tant que profiteurs, il prépare le terrain pour la nationalisation des succès privés, l’homogénéisation des mérites, et la saisie des richesses au nom du bien commun. Cela se fait non pas contre le pouvoir, mais par-dessus celui-ci, dans l’édifice même du consentement social.
Conclusion
Il serait imprudent de considérer la “taxe Zucman” comme une simple curiosité académique. Il s’agit là d’un point névralgique dans une bataille idéologique qui déterminera l’avenir de la liberté économique. Cette question ravive l’éternelle dualité de nos sociétés : égalité versus liberté ? Uniformité coercitive ou responsabilité individuelle ? Une société qui valorise ses membres ou une société qui rabaisse ses élites ? Le sujet ici n’est pas tant la rentabilité fiscale que le type de monde que l’on souhaite bâtir. Si l’on suit Spinoza, qui affirmait que la liberté est “l’essence de l’homme”, alors toute politique se méfiant de la réussite comporte une menace existentielle. Ce contre-pouvoir n’est pas un rempart démocratique, mais une tentative de réajustement culturel, où la passion pour l’égalité se veut souveraine. Face à cela, la lucidité s’avère non seulement essentielle, mais également un devoir. L’argumentation de Zucman est périlleuse car elle flirte avec des dérives totalitaires, où toute dissension à son approche serait réprimée par la contrainte.