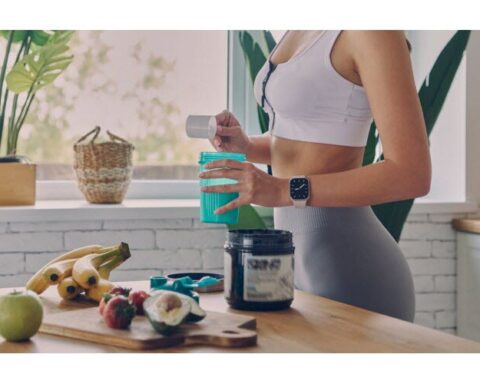Un budget placé sous le signe du redressement financier
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans la continuité du plan budgétaire présenté par le ministère des Finances : un retour à la rigueur avec une priorité portée sur la soutenabilité. Après une période difficile marquée par la crise sanitaire et l’augmentation des coûts énergétiques, le gouvernement vise à reprendre le contrôle sur l’évolution financière de la protection sociale, rapporte TopTribune.
Le défi est immense : le déficit cumulé de la Sécurité sociale pourrait atteindre 23 milliards d’euros en 2025, en hausse par rapport aux 15,3 milliards de l’année précédente. Le but est maintenant de réduire ce solde à 17,4 milliards en 2026, en visant un retour progressif à l’équilibre d’ici 2029. Thomas Cazenave, ministre du Budget, évoque un “effort de responsabilité collective” visant à “préserver un modèle social unique au monde”.
Pour atteindre ces objectifs, l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), qui constitue le cœur du budget alloué à la santé, n’augmente que de 1,6 % pour l’année suivante, comparativement à 3,4 % en 2025. En d’autres termes, bien que les dépenses continuent de croître, cela se fera à un rythme deux fois moins soutenu. Le gouvernement explique cette décision en affirmant qu’il s’agit d’un “ralentissement des dépenses, sans les couper”.
Santé, retraites et prestations sociales : les axes de la rigueur
Une part significative des économies à réaliser proviendra de la branche maladie. La Caisse nationale d’assurance maladie se doit de réaliser environ 3,9 milliards d’euros d’économies en 2026, grâce à une meilleure gestion des prescriptions, des négociations sur les tarifs des médicaments, et une révision des affections de longue durée (ALD). Ces affections, actuellement remboursées à 100 %, feront l’objet d’une réévaluation. François Bayrou, Haut-commissaire au Plan, a parlé d’une “actualisation nécessaire du périmètre”.
Le gouvernement prévoit également de procéder à des ajustements sur les prestations sociales ; le gel temporaire des pensions de retraite et des allocations familiales pourrait ainsi générer environ 3,7 milliards d’euros. Bien que cette mesure soit délicate sur le plan politique, elle est présentée comme un levier d’ajustement conjoncturel. Par ailleurs, une augmentation des franchises médicales sur les consultations et médicaments pourrait rapporter 800 millions d’euros supplémentaires.
En matière de recettes, l’État prévoit une hausse mécanique de 16 milliards d’euros, en lien avec l’augmentation de la masse salariale et la lutte contre la fraude sociale. Le gouvernement s’engage aussi à renforcer les échanges de données entre les différentes administrations, un processus jugé essentiel pour récupérer plusieurs milliards d’euros d’ici 2027.
Les tensions autour du financement hospitalier
Un des éléments les plus critiques de ce budget demeure le financement des hôpitaux publics. Le sous-objectif de l’ONDAM hospitalier ne connaîtra qu’une augmentation de 2,4 %, une hausse jugée insuffisante par la Fédération hospitalière de France (FHF), qui avertit d’un “risque de sous-financement structurel”. À cause de l’inflation persistante, de la hausse des coûts énergétiques, et de la pénurie de personnel, les établissements de santé craignent une dégradation de leur capacité d’investissement.
En réponse, le gouvernement annonce qu’un Fonds d’investissement santé, doté de 2 milliards d’euros étalés sur trois ans, soutiendra la modernisation des infrastructures. Toutefois, selon les acteurs de santé, ce fonds ponctuel ne compense pas le ralentissement global des dépenses. Les syndicats hospitaliers s’inquiètent d’une pression croissante sur les services d’urgence et le personnel déjà surchargé.
Une équation économique et politique délicate
Pour le gouvernement, ce budget représente un véritable test de crédibilité économique. Deux objectifs concomitants sont en jeu : rassurer Bruxelles quant à la trajectoire des finances publiques et contenir l’accroissement de la dette sociale, reprise par la CADES jusqu’en 2033. Chaque variation d’un point dans l’évolution de l’ONDAM représente environ 2,5 milliards d’euros de dépenses additionnelles, une dérive que Bercy ne souhaite pas tolérer.
Cependant, la stratégie adoptée n’est pas sans risques. Dans un contexte de croissance atone (+0,7 % anticipé pour 2025) et d’une inflation toujours proche de 2,5 %, l’effort demandé aux ménages et aux institutions hospitalières pourrait affecter la demande intérieure et détériorer le climat social. Les syndicats dénoncent déjà un “budget d’austérité déguisé”, tandis que les associations de patients craignent une augmentation des renoncements aux soins.