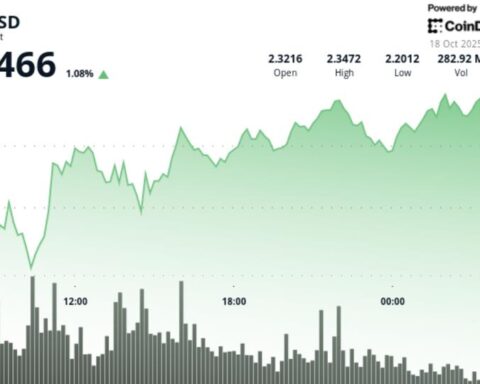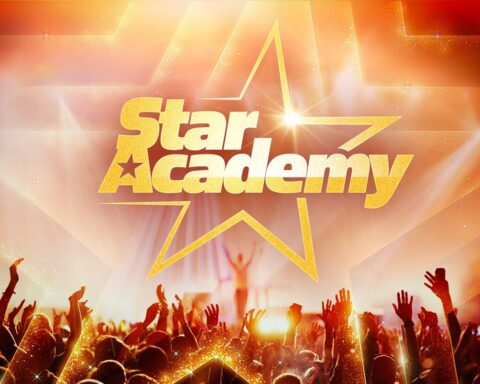Le gouvernement a récemment révélé son intention d’instaurer une taxe annuelle sur les holdings dites « patrimoniales ». Présentée comme un moyen de promouvoir une justice fiscale, cette mesure vise à imposer des sociétés non opérationnelles qui détiennent des actifs financiers, immobiliers ou mobiliers, souvent considérées comme des instruments d’accumulation de patrimoine. Plus précisément, cela impliquerait un prélèvement basé sur la valeur nette des actifs figurant au bilan, peu importe les résultats comptables ou les dividendes perçus. En d’autres termes, une société possédant des actifs peu ou pas rentables pourrait rencontrer des obligations fiscales même sans générer de revenus. Cette approche soulève des questions cruciales quant à sa conformité avec les principes constitutionnels et la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel, rapporte TopTribune.
1. Proportionnalité face à la capacité contributive
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen stipule que « la contribution commune soit répartie équitablement entre tous les citoyens, en fonction de leurs capacités ». La jurisprudence du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que l’impôt doit être fondé sur de véritables capacités contributives. En taxant la valeur d’un patrimoine sans prendre en compte les revenus réels générés, cette nouvelle taxe sur les holdings rompt le lien entre la charge fiscale et la capacité de contribution. Ainsi, une société ne produisant aucun flux positif mais détentrice d’un actif peut être contrainte de s’acquitter d’un impôt, même en l’absence d’une contrepartie économique. Ce décalage entre richesse potentielle et richesse réalisée est, historiquement, l’une des raisons les plus fréquentes d’annulation par le juge constitutionnel.
2. Risque de confiscation
Le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, affirmé que la fiscalité ne doit pas avoir un effet confiscatoire. Or, si la nouvelle imposition vient s’additionner à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des dividendes, son cumul pourrait égaler, voire excéder, les revenus réellement générés par le capital. En l’absence d’un mécanisme de plafonnement global, comme un bouclier fiscal ou un plafonnement lié aux revenus, cette accumulation pourrait mener à une taxation atteignant jusqu’à 100 % du revenu disponible, ce qui serait considéré comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété, selon la jurisprudence.
3. Égalité face aux charges publiques
L’article 6 de la Déclaration de 1789 garantit l’égalité devant la loi, et donc devant l’impôt. En visant une catégorie précise de sociétés, les holdings patrimoniales, sans prendre en compte la diversité de leurs activités (certaines se présentant comme des structures familiales de gestion, d’autres comme des instruments d’investissement productif), la mesure ne parvient pas à justifier cette rupture d’égalité. Deux entreprises de taille et de structure financière similaires pourraient être imposées différemment en fonction de la nature juridique de leurs actifs. Le principe d’égalité fiscale exige que des contribuables similaires soient soumis à des règles identiques.
4. Compatibilité avec le droit européen
Enfin, d’un point de vue du droit communautaire, cette taxe pourrait être interprétée comme un obstacle à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux. Si cette mesure désavantage spécifiquement les holdings françaises par rapport à des structures similaires dans d’autres États membres, elle risque d’être contestée conformément au droit européen, notamment en vertu de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La taxe prévue sur les holdings patrimoniales soulève de sérieuses interrogations sur ses fondements constitutionnels et juridiques. Dans sa configuration actuelle, elle semble en décalage avec les principes de proportionnalité, de non-confiscation, et d’égalité fiscale. En l’absence d’ajustements, comme l’instauration d’un mécanisme de plafonnement et une définition précise des sociétés concernées, cette mesure risque de faire l’objet d’annulations par le Conseil constitutionnel ou d’être remise en question devant les instances judiciaires européennes.