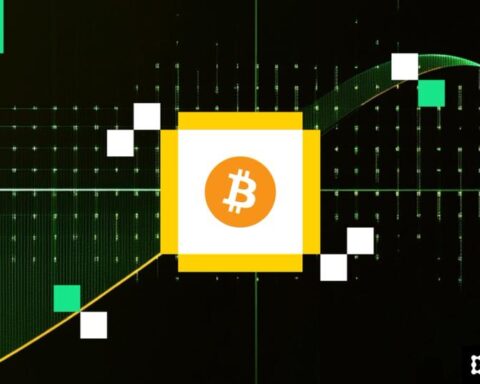La recrudescence des « freinages fantômes » en France suscite de vives inquiétudes tant chez les autorités que parmi les investisseurs. Ce problème technologique menace non seulement la confiance des utilisateurs, mais pourrait également bouleverser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’automobile, y compris les constructeurs, assureurs et fournisseurs, créant ainsi une crise avec des répercussions économiques importantes, rapporte TopTribune.
Une crise de confiance à fort impact industriel
Le 14 août 2025, le ministère des Transports a ouvert une enquête officielle sur les « freinages fantômes ». Ces arrêts inopinés de véhicules en circulation, attribués aux systèmes de freinage d’urgence automatique, remettent en question la fiabilité d’une technologie qui est au cœur de la transformation industrielle actuelle. En plus des préoccupations sécuritaires, les implications économiques pour les constructeurs automobiles pourraient se révéler considérables, surtout dans un contexte de mutation rapide du secteur.
Ce phénomène découle de l’obligation, instaurée en 2022, d’intégrer des systèmes AEB (Automatic Emergency Braking) sur tous les nouveaux véhicules européens. Bien que conçus pour protéger des vies, ces dispositifs sont désormais suspectés de causer des accidents graves. Des témoignages indiquent plus de 250 incidents documentés en quelques semaines, certains rapports faisant état de jusqu’à 400 signalements.
Pour les constructeurs, la situation est délicate. Admettre une défaillance généralisée pourrait entraîner des rappels massifs, comparables à ceux liés aux airbags Takata. Les pertes directes pourraient atteindre plusieurs centaines de millions d’euros pour des groupes tels que Stellantis, sans compter les frais juridiques associés à d’éventuelles actions collectives.
Plus préoccupante est l’érosion de la confiance des consommateurs. Les systèmes d’assistance à la conduite représentent une étape vers la conduite autonome, un marché estimé à plus de 300 milliards de dollars d’ici 2035. Tout doute quant à leur fiabilité fragilise ainsi les modèles économiques élaborés depuis plusieurs années.
Un risque systémique pour l’industrie automobile
Cette affaire va au-delà des seuls constructeurs. Les équipementiers, qui fournissent les capteurs et calculateurs, pourraient également être tenus responsables. Des entreprises leaders comme Bosch, Continental et Valeo fournissent ces technologies à presque toutes les marques européennes. Une remise en question de ces systèmes pourrait avoir des implications systémiques pour l’ensemble du secteur.
Les assureurs, eux aussi, prennent note. Une augmentation des sinistres liés à ces freinages imprévus les pousserait à revoir leurs barèmes tarifaires. Certains analystes évoquent l’avènement d’une tarification segmentée en fonction des assistances intégrées, ce qui alourdirait encore le coût total de possession pour les automobilistes.
Sur les marchés financiers, une inquiétude croissante se propage. Les valeurs des entreprises automobiles, déjà affectées par une baisse de 5 % des immatriculations neuves en France durant le premier semestre 2025, pourraient subir de nouvelles pressions boursières si un rappel massif venait à être confirmé. Cette situation rappelle aux investisseurs que la dépendance accrue à l’électronique embarquée accroît effectivement le risque industriel.
Un arbitrage complexe pour les autorités
Le ministère des Transports, par l’intermédiaire du SSMVM, a pris la question en main. Des discussions directes ont été initiées avec Stellantis et d’autres constructeurs, tandis que des tests indépendants sont en cours. Le 7 août 2025, la principale lanceuse d’alerte, Joanna Peyrache, a été reçue par les représentants du ministère.
Pour l’État, la situation est délicate. D’un côté, il faut assurer la sécurité des usagers et maintenir la crédibilité d’une politique de modernisation technologique. D’un autre côté, une condamnation trop rapide des constructeurs pourrait accroître l’instabilité d’un secteur qui soutient plus de 400 000 emplois directs et représente environ 10 % de la valeur ajoutée industrielle de la France.
Cette dualité fait écho à d’autres crises industrielles où l’État a dû jongler entre soutien à la compétitivité nationale et protection du consommateur. Les comparaisons avec le scandale du dieselgate sont inévitables dans les cercles économiques.
Une chance de repositionnement stratégique
Si le phénomène des freinages fantômes semble représenter une menace, il ouvre également des perspectives pour certains acteurs. Les startups spécialisées dans la cybersécurité automobile et l’intelligence artificielle pourraient émerger comme des fournisseurs de solutions pour une validation logicielle renforcée. De même, les assureurs pourraient concevoir de nouveaux produits offrant des garanties spécifiques contre les défaillances électroniques.
À long terme, cette crise pourrait précipiter l’instauration de régulations européennes plus strictes concernant les systèmes d’assistance à la conduite. Une harmonisation des normes de validation logicielle, accompagnée d’exigences accrues en matière de tests en conditions réelles, pourrait améliorer la fiabilité des systèmes. Toutefois, cela pourrait également instituer une barrière à l’entrée supplémentaire, renforçant ainsi le pouvoir des grands acteurs de l’industrie au détriment des plus petites entreprises.