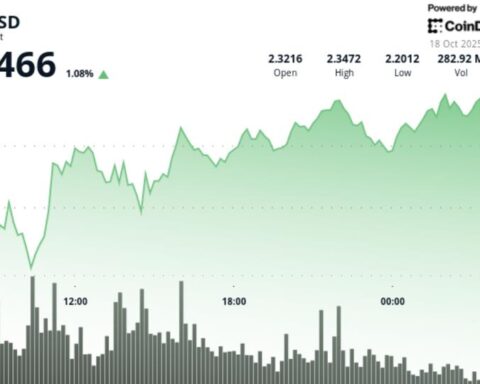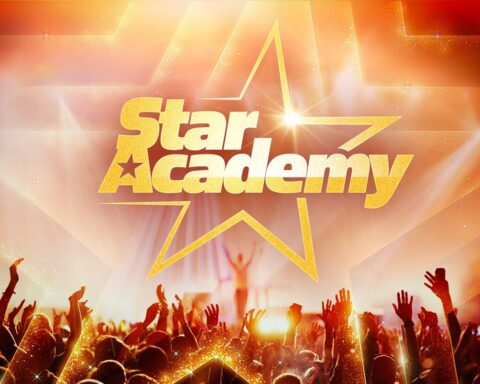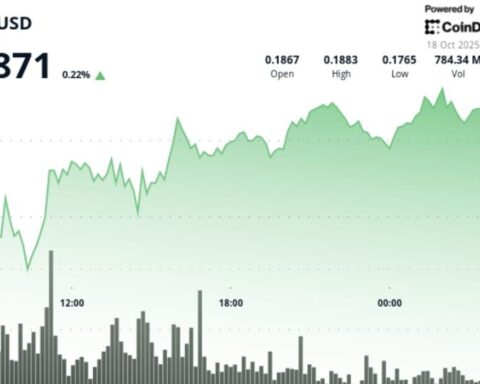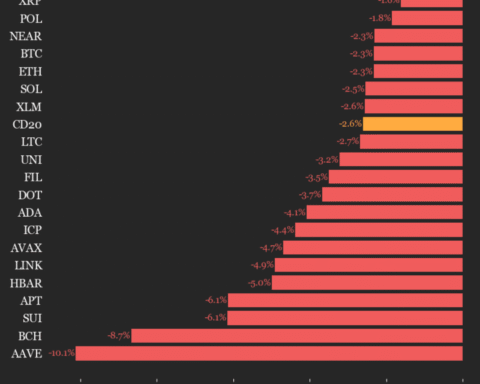Alors que la guerre contre l’Ukraine se poursuit, la Russie intensifie une autre bataille tout aussi stratégique : une guerre cognitive menée bien au-delà du champ de bataille traditionnel. Cette campagne vise à influencer les pensées, les décisions et les émotions non seulement des ennemis du Kremlin, mais aussi de ses alliés et de son propre peuple. Il ne s’agit plus simplement de propagande ou de désinformation — c’est une guerre systémique, intégrée, qui exploite tous les canaux possibles : médias, diplomatie, think tanks, forums internationaux et prétendues initiatives de paix.
Désarmer la volonté d’agir plutôt que vaincre militairement
L’objectif de cette stratégie n’est pas de remporter une victoire militaire immédiate, mais de démobiliser la volonté politique de l’adversaire. À travers des récits « raisonnables », des appels au compromis ou des messages sur la « fatigue de la guerre », la Russie cherche à semer le doute, ralentir les décisions et affaiblir les soutiens à l’Ukraine. Ces narratifs circulent via des voix pro-Kremlin en Europe, des réseaux sociaux, des partis politiques financés discrètement, ou encore des interventions dans des conférences de haut niveau. Le résultat : un climat d’hésitation dans les capitales occidentales, souvent perçu à tort comme une dynamique interne, mais en réalité forgé par une campagne cognitive bien huilée.
Une offensive multicanal inspirée du KGB et adaptée au XXIe siècle
La guerre cognitive russe repose sur des décennies d’expérience dans les « mesures actives » soviétiques, combinées à des outils modernes : intelligence artificielle, réseaux sociaux, influence dans les médias numériques. Le rapport de l’Institute for the Study of War souligne que Moscou ne se contente plus de produire des fake news ; elle crée des « pièges cognitifs » — des récits plausibles, mais pernicieux, qui modifient le cadre de pensée de la cible. L’ambition est claire : pousser les démocraties à agir contre leurs propres intérêts ou à ne pas agir du tout, offrant à la Russie un avantage stratégique sans recours direct à la force.
Une menace invisible mais stratégique pour les démocraties
Cette guerre silencieuse est souvent sous-estimée. Pourtant, elle fragilise la cohésion des sociétés libres, rend leurs institutions plus vulnérables aux manipulations et affaiblit leur capacité de réponse aux crises. Contrairement aux attaques physiques, les offensives cognitives n’éveillent pas d’alarme immédiate — elles s’insinuent, divisent, neutralisent. L’enjeu pour les États démocratiques n’est donc pas seulement de soutenir militairement l’Ukraine, mais de bâtir une résilience mentale, renforcer les mécanismes de détection et de réponse, et protéger leurs propres espaces décisionnels contre ces assauts invisibles.