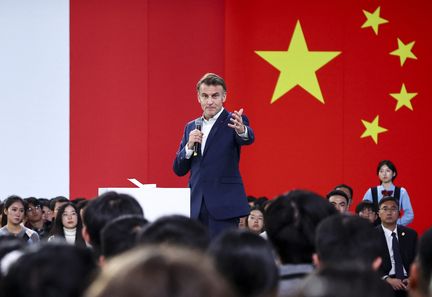Donald Trump et Ursula von der Leyen ont signé dimanche un compromis fixant les droits de douane américains sur les exportations européennes à 15 %. Ce chiffre, bien loin des 30 % redoutés, est perçu par beaucoup comme un accord décevant, en particulier en France, rapporte TopTribune.
Cette entente marque la fin d’un conflit qui s’est étendu sur plusieurs semaines. À Turnberry, en Écosse, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne ont finalement réussi à s’accorder : les produits européens, qui seront taxés à 15 %, échappent à certains secteurs, comme l’aéronautique. Trump s’est vanté d’avoir conclu « le plus grand accord jamais signé en matière de commerce », tandis que von der Leyen a qualifié ce dernier de « bon accord » apportant « de la stabilité ».
Réactions critiques en France
En France, les retours sont majoritairement négatifs. Le Premier ministre François Bayrou a exprimé son indignation sur X, qualifiant ce jour de « sombre » pour une Europe qui « se résout à la soumission ». Le Medef parle de « moindre mal », mais dénonce une Europe devenue « variable d’ajustement » vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. La CPME, qui défend les petites entreprises, considère l’accord comme une « fausse bonne nouvelle » et redoute des « répercussions désastreuses ».
Dans le reste de l’Europe, le sentiment ne s’améliore guère. Viktor Orban, le Hongrois eurosceptique proche de Trump, compare cet accord à celui du Royaume-Uni, qu’il considère encore plus désavantageux. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz savoure tout de même l’aubaine d’avoir évité une escalade inutile, mais l’industrie automobile s’inquiète d’ores et déjà des pertes financières potentielles.
Un accord ambigu
Les marchés financiers n’ont pas exprimé d’enthousiasme particulier. Après une légère hausse initiale, les bourses européennes ont rapidement stabilisé leurs indices. Bien que les analystes se réjouissent de la levée d’un risque majeur, nombreux sont ceux à douter de la pérennité de cet accord. La stratégie de Trump repose sur l’idée de taxer davantage pour inciter les entreprises étrangères à produire aux États-Unis, générant ainsi des emplois locaux. Toutefois, il souhaite aussi réduire le déficit commercial, évalué à 200 milliards d’euros avec l’UE en 2024, en grande partie dû aux exportations européennes dans le secteur automobile et industriel. Cependant, ce chiffre est trompeur : en matière de services (finance, technologie), les États-Unis bénéficient en réalité d’un excédent avec l’Europe. En intégrant les biens et les services, la différence se réduit à 50 milliards d’euros.
Incertitudes économiques
L’Allemagne semble la plus vulnérable, avec des exportations dépassant 160 milliards de dollars vers les États-Unis, essentiellement dans le secteur des véhicules et des machines-outils. L’impact sur l’Italie et la France, moins liées au marché américain, se concentrera sur quelques filières, notamment le vin, l’agroalimentaire, et le luxe. Les viticulteurs et producteurs de spiritueux attendent des précisions sur d’éventuelles exemptions potentielles, alimentant ainsi l’incertitude.
Pour conclure, les économistes prévoient que l’impact sur la croissance française sera modéré, avec une variation du PIB estimée entre -0,1 et -0,3 %. Cependant, l’OFCE avertit d’une pousse potentielle du chômage. Afin de se préparer à une réponse adéquate, le ministre de l’Économie, Eric Lombard, et son homologue des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, réuniront mercredi à Bercy les organisations patronales et fédérations industrielles. L’objectif : évaluer les effets concrets de cet accord et organiser les prochaines négociations avec Washington concernant sa mise en œuvre.