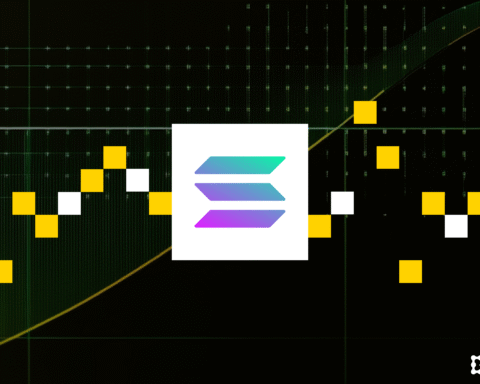La controverse autour de la « taxe Zucman » et son impact sur l’exode des fortunes
La ministre française des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a récemment exprimé son rejet de l’implémentation de la « taxe Zucman », un impôt proposé sur la fortune des ultrariches. Cette taxe, fixée à un taux de 2% pour les actifs dépassant 100 millions d’euros, ne figurera pas dans le budget pour 2026 présenté au Parlement. Pour justifier cette décision, elle a cité des exemples du Royaume-Uni, où, selon elle, des mesures fiscales similaires auraient conduit au départ de 1 400 ménages riches, entraînant un exode de 110 milliards de livres de capitaux, rapporte TopTribune.
Cette affirmation, selon laquelle la réforme fiscale britannique aurait causé un exode massif, mérite d’être examinée plus en profondeur. La réforme en question concerne le statut fiscal des « non-doms », c’est-à-dire des étrangers vivant au Royaume-Uni tout en ne déclarant pas leurs revenus étrangers. Cela a permis à des personnalités comme Akshata Murty, épouse de l’ancien Premier ministre Rishi Sunak, d’échapper à une imposition sur de tels revenus.
Le changement dans la législation a mis fin à cet avantage fiscal après une durée de résidence de quatre ans, contre quinze ans antérieurement. De plus, les foyers concernés peuvent désormais être assujettis à l’impôt sur les successions après avoir séjourné dix ans au Royaume-Uni. Selon les prévisions de la ministre des Finances, Rachel Reeves, cette réforme pourrait rapporter jusqu’à 12,7 milliards de livres sterling aux finances publiques britanniques sur les cinq prochaines années, en raison de la taxation accrue des grandes fortunes.
Cependant, la réaction des ultrariches face à ces nouvelles mesures a été significative. Des figures telles que le milliardaire égyptien Nassef Sawiris ont déjà annoncé leur intention de quitter le Royaume-Uni pour l’Italie, tandis que Lakshmi Mittal, un autre magnat, envisage également de partir. Néanmoins, il reste difficile de quantifier l’ampleur réelle de cet exode, les chiffres fournis par Amélie de Montchalin s’appuyant davantage sur des estimations que sur des données précises. Le nombre avancé de 110 milliards de livres semble basé sur des extrapolations, sans preuves tangibles de sorties de capitaux correspondant à cette somme.
Selon les médias britanniques, bien qu’environ 4 400 dirigeants d’entreprise aient quitté le pays l’année dernière, il est important de noter que ces départs ne sont pas nécessairement attribuables à la nouvelle réforme. Des études évoquent que 12 à 25 % des 74 000 « non-doms » pourraient envisager de partir, mais ces chiffres doivent être nuancés. L’Office for Budget Responsibility (ORB) a clairement indiqué que les informations fiables concernant les départs font défaut, et le délai d’élaboration des statistiques officielles complique encore davantage la situation.
Des experts comme l’économiste Arun Advani, qui a coécrit une étude sur la fiscalité et la migration des ultrariches, notent que la mobilité liée à l’imposition pourrait être moins prononcée que ce que l’on croît communément. En France, Gabriel Zucman, à l’origine de la proposition de cette taxe, a critiqué les assertions de la ministre, les qualifiant de basées sur des déclarations sans fondement solide provenant de gestionnaires de fortune intéressés.
Quentin Parrinello, directeur des politiques publiques à l’Observatoire européen de la fiscalité, souligne également que les « non-doms » se distinguent des ménages ciblés par la taxe Zucman, car ils entretiennent des liens moins forts avec leur pays d’accueil. Ainsi, ils pourraient être plus enclins à émigrer. En revanche, le projet de Zucman inclut une clause stipulant que l’impôt continue de s’appliquer pendant cinq ans après un éventuel départ, limitant ainsi les incitations à l’exil.
Enfin, plusieurs économistes de renom exhortent les autorités françaises à adopter ces mesures fiscales afin de montrer l’exemple aux autres nations. Ils soutiennent que l’application de cette taxe pourrait même s’étendre à dix ans après un départ, renforçant ainsi l’idée que la fiscalité peut être un outil puissant pour garantir une contribution équitable des plus riches à la société.