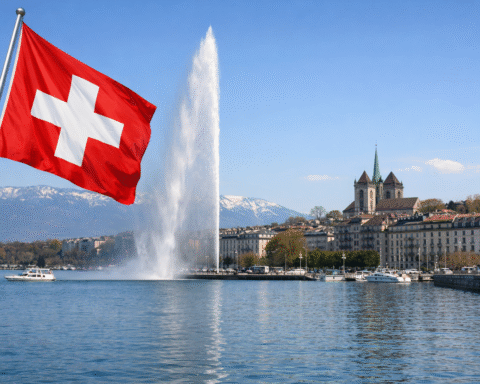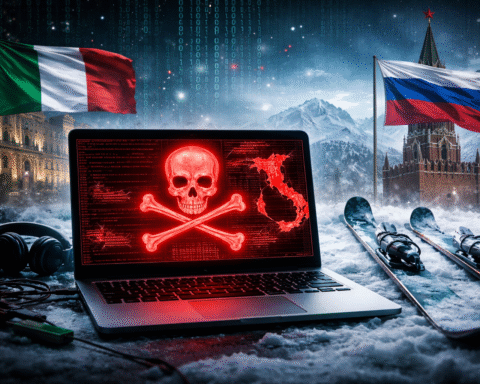Romain Starovoït, ministre russe des Transports depuis mai 2024 et ancien gouverneur de la région de Koursk, a été retrouvé mort par balle dans sa voiture Tesla sur un parking à Odintsovo, dans la région de Moscou, quelques heures seulement après la publication d’un décret présidentiel annonçant sa démission.
Selon le Kremlin, cette démission n’était pas liée à une perte de confiance personnelle. Pourtant, le contexte de cette disparition brutale suscite de vives interrogations au sein de l’élite politique russe, secouée par un enchaînement de scandales de corruption et de pressions judiciaires croissantes.
Une mort qui rompt avec les précédents
Starovoït devient le premier ministre en exercice de la Russie à mourir dans des circonstances évoquant un suicide depuis plus de trois décennies. L’homme politique faisait l’objet d’une enquête pénale pour fraude et détournement de fondsliés à des chantiers de fortifications dans la région frontalière de Koursk, au cœur de l’effort de défense contre les incursions venues d’Ukraine.
L’ancien gouverneur de la région de Smolensk, Smirnov, aurait fourni aux enquêteurs des témoignages à charge, aggravant la situation judiciaire de Starovoït et renforçant la pression sur lui à la veille de sa mort.
Le général Rouckoï, vétéran influent de l’armée russe, a réagi en soulignant le caractère sans précédent de l’affaire : « Même les généraux liés à des condamnations lourdes n’ont pas choisi cette voie. Il faut se demander ce qu’il savait ».
Une journée noire pour le ministère
Le même jour, un autre haut fonctionnaire du ministère des Transports, Alexeï Korneïtchouk, adjoint au chef du département du patrimoine de Rosjeldor, est décédé brutalement en pleine réunion au siège du ministère à Moscou. La cause avancée est un arrêt cardiaque. Deux morts en une seule journée au sein du même ministère soulèvent de nouvelles interrogations sur le climat interne d’une administration minée par la peur, la pression judiciaire et l’implosion des réseaux d’influence.
Corruption structurelle et guerre d’usure
Le dossier Starovoït illustre les tensions croissantes au sein des élites russes, dans un système où la guerre sert de toile de fond à un vaste cycle d’enrichissement illégal. Les accusations visent spécifiquement les détournements sur les infrastructures de défense en zone frontalière, là où les soldats russes sont envoyés en première ligne avec des moyens précaires.
Ce scandale s’inscrit dans une série d’affaires révélant l’ampleur du pillage des ressources publiques par une bureaucratie militaro-industrielle devenue hors de contrôle. Tandis que les soldats meurent au front, les responsables se partagent les marchés de la reconstruction et des fortifications, générant des fortunes sur fond de patriotisme officiel.
La disparition de Starovoït est ainsi perçue comme un signal d’alarme interne : les circuits d’impunité se resserrent, et même les plus haut placés ne sont plus à l’abri. Là où les généraux de l’entourage de l’ex-ministre de la Défense Sergueï Choïgou acceptent leur sort en prison sans résister, Starovoït, lui, aurait préféré la mort à la perspective d’un procès public — ou, selon certaines hypothèses, il aurait été réduit au silence par ceux qu’il menaçait d’impliquer.
Une élite fragilisée et un système en décomposition
La mort brutale d’un ministre, sur fond d’enquête pour corruption militaire, marque un tournant. À l’heure où le front s’effrite et les ressources s’amenuisent, le système commence à se dévorer lui-même. La guerre n’a pas seulement épuisé les finances de l’État : elle a mis à nu les mécanismes mafieux au cœur du pouvoir russe. Et face au risque d’exposition, la violence interne semble devenir un outil de régulation politique.
Tandis que le Kremlin maintient une façade de continuité, les signaux de décomposition institutionnelle se multiplient. Le suicide — ou la liquidation — d’un ministre en poste en dit long sur l’étendue de la compromission au sommet, mais aussi sur la solitude de ceux qui tombent, abandonnés par un appareil qui protège les clans, pas les hommes.