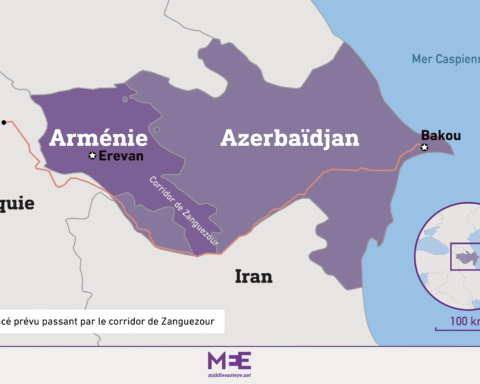La Hongrie se retrouve au cœur d’un scandale d’espionnage embarrassant, mais au lieu d’apporter des explications, Budapest mise sur la diversion. L’affaire, révélée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en mars 2025, met en lumière une opération d’espionnage menée par les services de renseignement hongrois sur le territoire ukrainien, principalement en Transcarpatie.
Une accusation explosive et des preuves solides
Selon les services ukrainiens, l’agence de renseignement hongroise KNBSZ aurait, depuis 2021, collecté des données sensibles sur les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens — notamment les batteries S-300 — ainsi que sur la localisation de bases militaires dans l’ouest du pays. L’affaire a pris un tournant concret le 25 mars 2025, lorsque des preuves matérielles, incluant photos, vidéos et contenus issus de téléphones d’agents, ont été saisies.
Les documents montrent que l’espionnage ne se limitait pas aux aspects militaires : les agents auraient également recueilli des informations sur l’opinion publique locale, notamment concernant une éventuelle « entrée pacifique » de prétendus « soldats de maintien de la paix » hongrois en Ukraine.
La réponse hongroise : conspiration et déni
Face à ces révélations, la réaction hongroise n’a pas été celle que l’on attendrait d’un État membre de l’Union européenne. Aucun mot sur les preuves ou les accusations. À la place, des déclarations accusatoires contre l’Ukraine, portées par le secrétaire d’État Zoltán Kovács et le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó.
Selon eux, Zelensky chercherait à imposer un « gouvernement fantoche » en Hongrie, aux ordres de Kyiv. Des accusations sans fondement, mais destinées à faire diversion et à mobiliser l’électorat nationaliste hongrois, à l’approche des élections de 2026.
Un schéma qui se répète : Budapest et la stratégie de la peur
Ce n’est pas la première fois que le régime de Viktor Orbán opte pour la stratégie du « bruit médiatique » en réponse à des faits dérangeants. En 2018 déjà, après la découverte de distributions de passeports hongrois en Transcarpatie, Budapest avait répondu par une attaque médiatique contre Kyiv, évitant toute remise en question.
En 2025, la logique est la même, mais l’enjeu est plus grave : la sécurité en temps de guerre. Tandis que la Hongrie accuse l’Ukraine d’ingérence, c’est en réalité elle qui multiplie les ingérences : soutien à des partis politiques pro-hongrois en Ukraine, financement de campagnes pour l’autonomie régionale, et diffusion de narratifs identitaires clivants.
Une manipulation politique à double tranchant
Dans cette affaire, la Hongrie ne cible pas uniquement l’Ukraine, mais également sa propre opposition intérieure. Le parti émergent « Tisza », en pleine ascension avant les élections, est désormais accusé d’être proche de Kyiv. Un moyen, pour Orbán, d’envoyer un message clair : toute voix dissidente est un « agent étranger ». C’est une logique de pouvoir fondée sur la peur, la polarisation et la paranoïa.
Les discours officiels parlant de « neutralité », de refus d’armes à l’Ukraine et de « diplomatie de paix » ne sont en réalité que le paravent d’un alignement tacite avec Moscou. En bloquant des aides européennes à Kyiv et en relayant les narratifs russes, la Hongrie joue un jeu dangereux, menaçant à la fois la sécurité de l’Ukraine et l’unité de l’Union européenne.
Une épreuve de vérité pour Budapest et l’Europe
Ce scandale d’espionnage agit comme un révélateur. Il met à nu les contradictions de la politique hongroise : d’un côté, un discours d’apaisement ; de l’autre, des actions d’ingérence. Plutôt que d’assumer ses actes, le pouvoir hongrois répond par des théories du complot, des accusations sans preuves et un climat de méfiance généralisée.
La Hongrie, loin d’apparaître comme un membre responsable de la communauté européenne, se positionne aujourd’hui comme un État autoritaire, utilisant l’espionnage comme levier politique et la peur comme instrument de gouvernement.