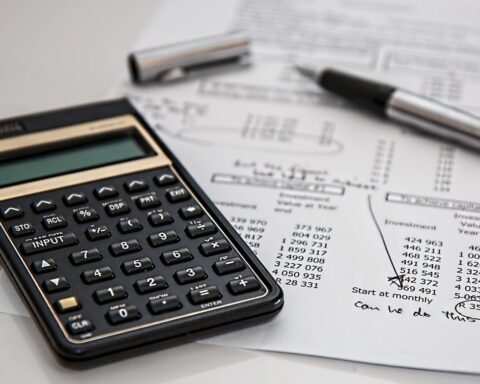En Guadeloupe, dans la commune de Petit-Bourg, il y a déjà eu des déplacements de résidents, déplore Sylvie Gustave dit Duflo en marge du Forum mondial des îles à Nice. La présidente de l’Office français de la biodiversité se souvient que « leurs maisons se sont retrouvées carrément à cheval dans le vide ». « Il y avait urgence à déplacer les populations pour les mettre en sécurité, et il a fallu une dizaine d’années pour convaincre la dernière résidente de quitter son logement », se souvient-elle.

En Guadeloupe, une dizaine de communes, sur 32, sont concernées par la hausse du niveau des mers. Et il est difficile de demander « aux populations de se déplacer, de quitter des endroits où elles ont fait toute leur vie pour se réfugier à l’intérieur des terres », constate Sylvie Gustave dit Duflo.
« Sur 33 communes que compte la Nouvelle-Calédonie, on en a 31 qui sont directement touchées par l’érosion côtière », se désole Veylma Falaeo présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie. « Ça affecte grandement le quotidien de la population », poursuit-elle. Veylma Falaeo déclare venir au forum des îles à Nice « pour chercher des financements afin de faire face à cette situation » dans un contexte politique local particulièrement tendu.

Alors que les dirigeants de la planète se retrouvent sur la Côte d’Azur pour discuter de l’urgence mondiale qui menace les océans, le Forum des îles rappelle « le risque existentiel que représente la montée du niveau de la mer ». Le ministre de la Francophonie et des partenariats internationaux, le Mahorais Thani Mohamed-Soilihi, qui préside ce Forum, donne un aperçu des attentes des îliens.
Plus de 730 millions de personnes vivent sur des îles à travers le monde, soit 9% de la population mondiale. Beaucoup d’entre eux subissent les effets dévastateurs du dérèglement climatique : recul du trait de côte, accès compromis à l’eau douce, phénomènes météorologiques extrêmes, causant des déplacements forcés.

En Polynésie, l’archipel des Tuamotu, composé d’une cinquantaine d’atolls se trouvant presque au niveau de la mer, est directement confronté à ce problème. Selon Moetai Brotherson, « on commence à observer — pas forcément des phénomènes de submersion — mais du fait de la montée du niveau de mer, des phénomènes de salinisation des lentilles d’eau douce ». Or les lentilles d’eau douces constituent une source essentielle d’eau potable sur les atolls.
Avant de venir à Nice, la maire de Teahupoo, où se sont déroulées les épreuves de surf aux Jeux olympiques, a eu une très mauvaise surprise. En allant faire une randonnée du côté du Fenua Aihere dans sa commune, son groupe a dû marcher dans la mer. « L’eau a monté de manière impressionnante », note Roniu Poareu Tupana. « Mais les gens n’en parlent pas beaucoup« , ajoute Titaua Vivish, une élue de Tautira, commune voisine de Teahupoo. « On est tellement résilients en Polynésie », explique-t-elle. On cherche toujours un moyen pour se débrouiller ».

À Mayotte, où l’île a bien du mal à se remettre du passage du cyclone Chido, les maires de Mamoudzou et Pamandzi s’inquiètent aussi de la hausse du niveau des mers. « L’avènement d’un volcan sous-marin apparu ou réapparu il y a deux ans à l’est de l’archipel, a provoqué un affaissement » déplore Ambdilwahedou Soumaila, le maire de Mamoudzou. « Cette situation a conduit le président de la République à prendre une décision extrêmement importante, voire même grave, de déplacer l’aéroport de Mayotte, de la Petite à la Grande-Terre », précise-t-il.

En Guadeloupe, Sylvie Gustave dit Duflo s’intéresse aux effets dévastateurs des algues sargasses. On savait que ces algues polluaient les plages et émettaient des gaz toxiques. Mais il y a pire encore. « Lorsqu’on enlève les algues, on accélère l’érosion des plages. Vous avez beau prendre le matériel le plus fin qui soit, vous collectez également du sable », explique l’universitaire. C’est ainsi que la petite plage de la commune de Terre-de-Bas aux Saintes a complètement disparu en 14 ans. Un véritable désastre écologique.
Autre sujet d’inquiétude pour la présidente de l’Office français de la biodiversité : l’affaiblissement des récifs coralliens au large de la zone de Jarry, « le poumon économique de l’île« . « Depuis maintenant deux ans, on assiste à des canicules marines qui entraînent 90% de blanchissement des coraux », constate Sylvie Gustave dit Duflo.
Or cette zone industrielle située à Baie-Mahault a été construite sur des mangroves et se trouve au-dessous du niveau de la mer. « Si elle n’est pas défendue par les récifs coralliens, on risque d’avoir des inondations permanentes sur la zone de Jarry, alerte-t-elle. « En 2023, la température de l’eau à plus de 5 mètres de profondeur était montée à 32 degrés, là où il faudrait qu’elle soit à 25 degrés », ajoute l’universitaire.

En Martinique, l’ancien maire du Prêcheur, aujourd’hui député, se souvient qu’après le cyclone Lenny en 1999 qui a ravagé une bonne partie du littoral, « des personnes ont dû être relogées en urgence« . Le député souhaite maintenant mettre à l’abri la population préchotine menacée par la montée du niveau de la mer. Il a imaginé avec un cabinet un programme de construction et de relocalisation se basant « sur l’utilisation de matériaux traditionnels et adaptés au climat des Antilles ». Marcellin Nadeau trouve cependant que « ça n’avance pas assez vite » et déplore « les lenteurs de l’administration française ».

À Miquelon, où les 600 habitants sont également menacés, la relocalisation devrait commencer en juillet 2025. « Il y a 9 maisons qui vont être achetées et on a aussi 4 primo-accédants, donc des jeunes couples qui vont se réinstaller sur l’île pour la première fois depuis bientôt 10 ans, en raison du PPRL, le plan de prévention des risques littoraux », se félicite le maire Franck Detcheverry.
Il se souvient que ce fameux PPRL a été vécu comme « un traumatisme« . « C’était un 24 décembre, un sacré cadeau de Noël« , sourit aujourd’hui Franck Detcheverry. Après la tempête Xynthia dans l’Hexagone en 2010, « François Hollande, alors président en 2014, est venu annoncer à Miquelon qu’il fallait, pour protéger les populations, mettre en place un plan de prévention des risques littoraux, une obligation légale », raconte le maire.

« On ne pouvait plus construire. C’était donc la mort annoncée du village », se rappelle Franck Detcheverry. « Plus personne ne voulait se présenter aux élections locales ». Le Miquelonnais a décidé de monter une liste en 2020 et de réfléchir avec d’autres à un programme. La petite commune française au large du Canada fait aujourd’hui figure de laboratoire.